Culture / Mais quel prix peut-on accorder au Nobel de littérature?
Une fois de plus, le plus convoité des prix littéraires mondiaux a suscité, avec la consécration d’Annie Ernaux, des grincements de dents relevant de l’idéologie, autant sinon plus que de la qualité de l’œuvre. La droite française eût préféré Houellebecq, la gauche s’est sentie confortée par le choix de l’Académie suédoise, mais les critères d’élection de celle-ci, et jusqu’à sa crédibilité, sont plus que jamais discutés. Après Bob Dylan, Dario Fo ou Patrick Modiano, Annie Ernaux a-t-elle vraiment la «dimension Nobel»? Or qui définit celle-ci et comment? Le ver de la politique et d’une certaine «morale» n’a-t-il pas été dans le fruit dès la fondation du prix ? Et la littérature là-dedans? Cherchez l’innocence...
A l’annonce, le 6 octobre dernier, de l’attribution du Prix Nobel de littérature à Annie Ernaux, j’avoue ne pas m’en être réjoui, pour des motifs à vrai dire peu littéraires (j’avais apprécié les premiers livres de cet auteur, ensuite un peu refroidi par leur «sociologisme » et leur ton frotté de ressentiment) mais plutôt par ce que représentait le personnage dont me restait, sur l’estomac, l’attaque haineuse lancée contre son confrère Richard Millet, taxé de fascisme dans une fameuse tribune du Monde, et bientôt voué à un lynchage médiatique caractérisé, à vrai dire moins unanime qu’on ne l’a dit mais aboutissant bel et bien à la démission de Millet de son poste éminent aux éditions Gallimard.
Or l’œuvre d’Annie Ernaux ne valait-elle pas mieux que les positions publiques «vertueuses» de l’égérie gauchiste? C’est la question qu’ensuite je me suis posée en voyant déferler, contre elle, dans les médias et sur les réseaux sociaux, le même genre de propos fielleux et sans rapport direct avec ses livres mais dictés par ses options politiques: son antisionisme radical la posant en ennemie d’Israël ou ses accointances avec Mélenchon, lequel en d’autres temps, soit dit en passant, conspuait un Soljenitsyne pour des raisons, là encore, purement idéologiques.
Sur quoi je me rappelle les heures de lecture que j’ai passées à lire Une journée d’Ivan Denissovitch, La Maison de Matriona, Le Pavillon des cancéreux et L’Archipel du goulag, avec l’impression d’achopper à la littérature universelle, et comparant cet immense souvenir à ce qui m’est resté, l’autre soir, des 37 pages du dernier opus d’Annie Ernaux, Le jeune homme, paru en juin dernier, je m’interroge décidément sur ce qu’on peut dire la «dimension Nobel».
Or, qui décide de celle-ci, et comment la cerner, quelle Autorité «scientifique» pourrait-elle le faire «en toute objectivité»?
L’instance de consécration suprême, feuilleton…
Le Prix Nobel de littérature, qu’on l’admette ou pas, reste aujourd’hui, plus de 120 ans après sa première attribution (en 1901, au poète et philosophe-académicien Sully Prudhomme, que personne ne lit plus depuis des lunes), et pour reprendre un concept pompeux de la sociologie littéraire actuelle, l’instance de consécration suprême pour un auteur vivant.
Sans parler de la somme que le prix rapporte à celui-ci (environ 1 million d’euros), le Nobel assure au lauréat, et à son œuvre, une notoriété mondiale à forte valeur symbolique et plus encore, selon le vœu même d’Alfred Nobel: la reconnaissance effective d’un «puissant travail idéal», conformément à la morale typique de l’humanisme patriarcal du début du XXème siècle, possiblement optimiste – raison pour laquelle on écarta un Tchekhov, un Zola ou un Ibsen, jugés trop négatifs… – , bientôt frotté de patriotisme nationaliste ou de régionalisme (l’historien Theodor Mommsen et le poète félibrige Frédéric Mistral), ensuite plus ouvert au scepticisme critique de l’époque (avec le Suisse Carl Spitteler ou Anatole France), à l’image des mentalités en évolution.
Autant dire que la morale (on dirait aujourd’hui l’éthique), autant que la politique (les académiciens suédois préfèrent le terme cravaté de diplomatie), ont interféré dès le début avec les jugements d’ordre purement littéraire, au point de «raconter», d’une élection à l’autre, une histoire des mentalités et des mouvances intellectuelles ou esthétiques qui ont «travaillé» nos sociétés et nos élites lettrées au XXème siècle.
Favorable parfois à des auteurs persécutés dans leur pays, mais parfois aussi à des écrivains jugés complices de régimes autoritaires, les juges de Stockholm n’ont cessé de mêler les critères littéraires, esthétiques, éthiques et politiques, en dépit de leurs dénégations, et comment pourrait-il en être autrement, s’agissant d’un collège de clercs soumis à milles influences, lobbyings et autres pressions, sous-traitant des centaines de propositions et se chamaillant entre eux jusqu’à la veille de la Décision?
On sait ainsi que le Comité Nobel de cinq experts, issus de l’Académie et pilotant la chasse au Lauréat, actionne chaque année un réseau mondial de pairs universitaires ou de spécialistes reconnus (parfois d’anciens lauréats) et autres institutions, de sorte à récolter un premier lot de quelque 350 propositions, dont ne sortiront finalement que cinq noms, l’ensemble des académiciens se trouvant consultés en bout de course, on imagine dans quel beau désordre! D’où pas mal de couacs, de «loupés» avérés, et quelques épisodes corsés frisant le scandale...
Le couac Sartre (en 1964) est emblématique: admirablement conséquent, le grand écrivain-philosophe tiers-mondiste envoie promener l’Académie suédoise en lui reprochant d’être par trop eurocentrée et strictement occidentaliste.
A preuve: que la Suède détienne plus de prix (8) que l’Asie entière, mais c’est l’effet Sartre qui provoquera l’élection compensatoire (en 1968) du Japonais Kawabata, avant d’autres ouvertures tous azimuts.
Un autre couac a fait date: l’élection bicéphale d’Eyvind Johnson et Harry Martinson, estimables représentants de la littérature prolétarienne suédoise, préférés par leurs pairs complaisants à Saul Bellow, Graham Greene ou Nabokov, dont la «dimension Nobel» paraissait pourtant plus évidente, comme celle de Virginia Woolf, écartée au profit de Pearl Buck, évidemment plus «vendeuse» quant à elle.
Du côté des «loupés», on distinguera, là encore, les exclus «infréquentables » pour motifs politiques ou «moraux», tels Louis-Ferdinand Céline (l’un des deux plus grands auteurs français du XXème siècle, mais gravement antisémite) et Ezra Pound (pour sa défense du fascisme mussolinien), ou encore Lawrence Durrell jugé trop «érotique», et les «oubliés» ou les «refusés» récurrents, à commencer par Marcel Proust dont la cathédrale de mots est restée inaperçue dans les brouillards du nord, avant une procession de grands noms refoulés, tels ceux de Bertolt Brecht et Stefan Zweig ou Robert Musil (question de ne pas déplaire au susceptible Adolf Hitler, déjà chiffonné par l’élection de Thomas Mann), plus récemment de Vladimir Nabokov ou de Jorge Luis Borges, de Milan Kundera ou de Salman Rushdie, etc.
Comme un miracle, pourtant...
Fait amusant en somme: que les «purs littéraires», qui ont avalé leur monocle de travers à l’annonce du prix Nobel de littérature à Bob Dylan, rejoignent les détracteurs de cette institution qui se réclament du «wokisme» ou de je ne sais quelle idéologie alternative – il existe désormais un contre-Nobel alternatif à dominante féministe, sans parler d’Annie Ernaux…
Mais justement: Annie Ernaux. Je m’en étais donc détourné, après avoir apprécié Les armoires vides, La Place et Les Années, et son dézinguage de Richard Millet m’a plus encore éloigné d’elle, mais depuis quelque temps j’y suis revenu, d’abord avec son dernier écrit publié cette année, Le jeune homme, très incisif et développant la belle idée d’une double initiation amoureuse entre une quinqua et un garçon de trente ans son cadet, et dans la foulée j’ai découvert Passion simple, qui a fait plus que m’intéresser, qui m’a touché tout personnellement et par sa substance incandescente et par son écriture au couteau; et demain ce pourrait être, pour chacune et chacun, la traversée de cette œuvre offerte par les 1'000 pages d'Ecrire la vie, rassemblant les récits de son «je» pluriel et des éléments de son journal intime. Par conséquent: merci le Nobel.
En attendant qu’un super-logiciel définisse la «dimension Nobel» et assure le job d’une façon parfaite, on peut certes accumuler les griefs contre les académiciens suédois, ou à l’inverse reconnaître, comme l'a fait l’historien de la littérature François Comba, que ceux-ci ont tout de même «élu», sur plus d’une centaines d’auteurs, une cinquantaine d’œuvres «incontournables», constituant un fonds de découvertes inépuisable, de Selma Lagerlöf (Suède, 1909) à Knut Hamsun (Norvège, 1920), Hermann Hesse (Suisse, 1946) ou William Faulkner (USA, 1949), Ivo Andric (Yougoslavie, 1961) ou Samuel Beckett (Irlande, 1969), Gabriel Garcia Marquez (Colombie, 1982) ou Naguib Mahfouz (Egypte, 1988), Imre Kertesz (Hongrie, 2002) ou Doris Lessing ( Royaume-Uni, 2007), entre autres.
Enfin, merci au Prix Nobel de littérature de nous avoir fait découvrir, en 2013, la formidable nouvelliste canadienne Alice Munro, sottement décriée par un Bret Easton Ellis (visiblement aussi jaloux que mauvais lecteur en l’occurrence), et merci au Nobel d’avoir élu, contre toute attente, en 2020, la poétesse Louise Glück, dont je ne saurais dire si elle a vraiment plus la «dimension Nobel» que dame Ernaux (ce dont je me fiche finalement), mais qui, avec ses recueils, nous invite à un fascinant voyage à travers le temps et nos vies, les affects du cœur et les voies de l'esprit, tout baignés de ce que Shakespeare appelait le lait de la tendresse humaine, profondeur et beauté d’un regard sur le monde – valeurs sans prix…





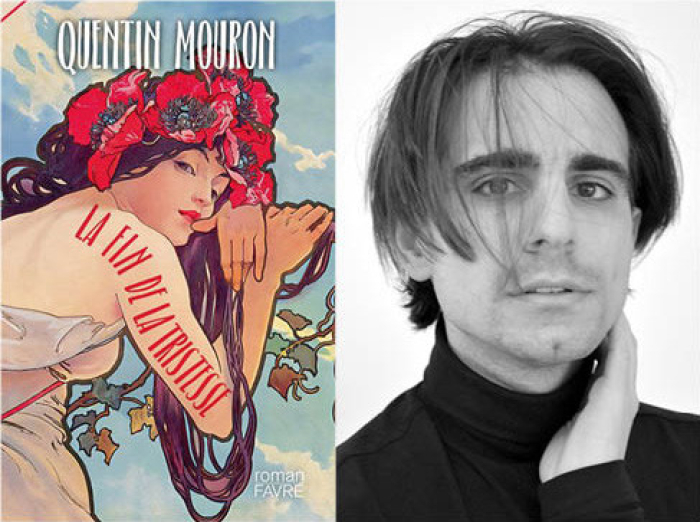
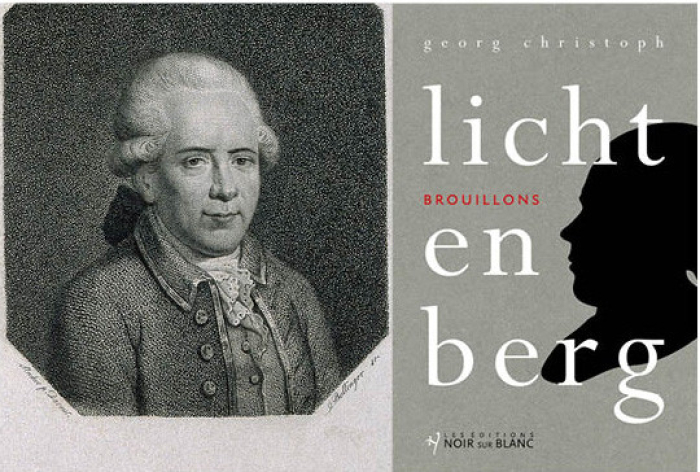

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire