Culture / Quand un lévrier très stylé nous escorte au cœur de l’Europe
Dans son nouveau roman très singulier, «Un Galgo ne vaut pas une cartouche», Jean-François Fournier, qui fait rimer truculence et désespérance, s’improvise Tour Operator, accompagné d’une adorable levrette, d’une virée dans l’espace-temps d’un vieux continent sous perfusion gastro-érotico-artistique. Loin de Bruxelles, pour notre bonheur!
«L’Europe à laquelle je rêve est celle des cultures et pas du tout celle des Etats-nations, des technocrates ou de l’argent», me disait Denis de Rougemont il y a cinquante ans de ça, lorsque, dans son grand jardin de la campagne genevoise, il m’avait reçu afin de répondre à mes questions sur le terrorisme européen de l’époque.
Amorçant alors son grand virage écolo, celui qu’un André Malraux considérait comme l’un de ses contemporains les plus intelligents, m’avait impressionné par la compréhension qu’il manifestait à l’endroit des extrémistes italiens ou allemands, qui ne manqua de scandaliser certains lecteurs du journal Construire qui m’envoyait, le fameux «hebdomadaire du capital à but social» dont Charlotte Hug avait fait, à l’enseigne de la Migros, une publication culturelle de premier ordre et de très grande diffusion.
Or je n’aurai cessé de penser à la réflexion du grand auteur de L’Amour et l’Occident ou de Penser avec les mains, entre tant d’autres ouvrages, en lisant le nouveau roman de Jean-François Fournier illustrant les multiples aspects, flamboyants ou désespérés, de la culture européenne en son noyau génial, contrastant pour le moins – ou plus exactement pour le pire – avec ce qu’en ont fait les ploutocrates de la technocratie globale.
L’éditeur Olivier Morattel a-t-il raison de parler crânement d’un «grand roman européen» à propos d’Un Galgo ne vaut pas une cartouche, si l’on se rappelle les chefs-d’œuvre de Thomas Mann ou de Robert Musil? Disons que, plus modestement, cette suite de variations sur quelques thèmes fondamentaux apparaît bel et bien comme un roman interrogeant les tenants du génie créateur à l’occidentale, ainsi qu’une célébration fervente de l’art et de la littérature, et que telle est certes sa «grandeur», à distinguer de la platitude et de la camelote surfaite au goût du jour…
Le grand saut
Le premier saut, physique et métaphysique, marquant le passage du réel à la fiction, ou la liaison plus ou moins dangereuse entre désir incarné et fantasme, se trouve figuré, dans la filiation d’un Hemingway ou d’un Montherlant, par la corrida imaginaire mise en scène par un écrivain allemand au double prénom germanique (Ludwig ou Ernst) dans une pension crade de Barcelone où bohèmes et catins voisinent, et tout de suite le verbe net et chatoyant du connaisseur s’arrache au magma dégoûtant du quotidien avec les termes précis et fleuris de l’art tauromachique qui voient El presidente (surnom donné au plumitif teuton par le patron de la pension) se réapproprier les mouvements des chicuelinas et autres novilladas préludant à l’estocade du novillero, et que je te balance de l’arrucina ou de la muleta pour faire vrai, et l’on a beau savoir que la scène de l‘écrivain en «habit de lumière» devant son écran relève du selfie: on y croit, de même qu’on est disposé à croire qu’il est prêt à écrire son «grand roman taurin» même s’il bute sur le mur de la réalité lamentable d’un comité de lecture qui refuse, à Munich (en Bavière, jawohl, ville fameuse pour sa bière), son dernier manuscrit qu’il tient, lui, pour un chef-d’œuvre; et là ça fait si mal qu’un autre saut va s’imposer…
Auparavant, cependant, à part le show de la parodie de corrida, le lecteur (et la lectrice par inclusion) aura commencé de «taster» des agréments variés de la boisson (un Vega sicilia ne se refuse pas entre deux cigares, même au titre de citation brève, avant les nomenclatures plus détaillées) et de la chair explosive d’une dame passant par là, après que sera apparue la levrette baptisée Canela par Ludwig (à cause de la rousseur du bout de ses oreilles), nébuleuse merveille blanche que l’artiste peintre d’à côté, un certain Rainer, adoptera après le vol plané final de l’écrivain. Enfin, tout ça ne se raconte pas: c’est à lire, c’est à lire qu’il vous faut!
Donc un écrivain fasciné par la tauromachie, puis un peintre jouant lui aussi sur le mélange des sens et des sangs, qui de Barcelone nous emmène à Vienne (avec d’autres vins dans la foulée, d’autres références courant de Goya à Schiele, d’autres citations d’Ovide ou de Thomas Bernhard) et s’éclate au poker où il perd Canela, puis un saxophoniste «extra» qu’on retrouve à Prague avec la levrette s’adaptant à tous les fauteuils et sofas de ce monde où il fait bon flemmer, puis une victime d’inceste (il en faut forcément dans un roman d’aujourd’hui) qui exorcise le monstrueux souvenir par l’art et le journalisme, puis un nègre nègre – un vrai nègre littéraire noir qui se dit lui-même «nègre nègre» sans complexe, tant il est vrai que le roman de Jean-François Fournier, auteur complexe assurément, n’en est pas moins un roman-gigogne sans complexe.
Cependant la lectrice (et le lecteur par inclusion) se demande si tout ça, littéralement truffé de clichés culturels voire sociétaux apparents, n’est pas en somme téléphoné? Ce Fournier n’est-il pas qu’un snob provincial affublant ses personnages de fringues marquées, Chanel à celle-ci et Pucci Gucci à celui-là? Et ne touche-t-il pas de pots de vin de certaines caves qu’il flatte même indirectement? A ces objections j’ose répondre avant lui et en russe affirmatif: niet.
Car c’est à l’auteur d’Un Galgo ne vaut pas une cartouche qu’il incombe de répondre, à lui et à Canela.
Les trois chapitres finaux de ce roman à dégaine de poupée russe, à savoir Suicide blonde, Love supreme et Ali, avant l’épilogue où s’exprime Canela en langage humain, ressortissent bel et bien au grand roman européen fictif et sporadique des poètes en vers ou en prose dont un Peter Altenberg, dûment cité, est un bon exemple à la fois méconnu et significatif.
L’Europe est là, personnelle et mal coiffée, comme elle est là chez Peter Handke ou Charles-Albert Cingria – Fournier lui vrille un clin d’œil –, Robert Walser ou, au cinéma, Daniel Schmid et Fredi M. Murer, ces conteurs de la forêt des émotions vives, Rainer Werner Fassbinder le mauvais garçon tout cuir au cœur de tendron ou Cesare Pavese à qui la difficulté de vivre tenait lieu de métier.
Une mélancolie qui a du chien
L’auteur d’Un Galgo ne vaut pas une cartouche s’avance d’abord masqué, même s’il se signale illico par son style, il donne en somme dans le mariage pour tous littéraire dont les personnages seront tous (et toutes, car les femmes y joueront un rôle crucial) des anges, à commencer par la douce Canela surgie aux abords d’un claque de Barcelone, et c’est par la voix d’un de ses avatars qu’un maître d’écriture avéré, qui vient de proférer d’utiles vérités sur la lecture, conclut que «le monde n’est pas suffisant pour nous et ne doit jamais le devenir».
De fait, un monde où l’on abuse des enfants, un monde où l’on croit laver son honneur en punissant son chien point assez performant à la chasse au lapin, un monde où l’on répond à la terreur d’Etat par le massacre des innocents, un monde fait à l’image d’un Dieu méchant ne nous suffit pas, les gars.
«Tu sais, dit le maître au disciple, la lecture est une incroyable petite musique qui ne fait pas seulement résonner des mots, un style, les idées d’un auteur, voire les idées tout court. Elle instille aussi dans ton cerveau un parfum indescriptible et insaisissable, quelque chose que j’ai mis très longtemps à appeler par son nom, le bonheur».
Et le même à propos de l’écriture: «Comment accepter d’écrire sans atteindre la perfection? J’ai envie de tuer les mauvais auteurs. Moi-même je ne me pardonne rien: il n’est pas rare que j’éprouve une pulsion suicidaire en relisant mes propres textes».
Le type se nomme (peut-être) Pierre-François Tournier (Michel est au jardin, dira-t-on comme la femme de Marcel Aymé le lendemain de la mort de celui-ci), c’est peut-être un grand écrivain de théâtre ou de cinéma au vu de sa dégaine (costume de lin blanc et panama), mais un clic et tu te retrouves sur YouTube où t’attend le démoniaco-angélique Michael Hutchence du groupe australien INXS en plein «live» de Suicide blonde, quelques années avant qu’on ne le retrouve pendu tout nu comme un galgo et cuité d’alcool et de substances connues de ceux auxquels le monde ne suffit pas.
Le monde selon le Valaisan Fournier (et tout Valaisan est un peu un Sicilien maffioso virtuel de la vieille Europe) n’est pas une apologie kitsch de la défonce suicidaire, même si le thème de l’autodestruction est inscrit sur le tableau magnétique de la cuisine du plus beau de ses personnages de l’occurrence, une Dominique qui a sa sainte et sa rue à Paris, où elle finira d’ailleurs par se jeter du huitième dessus: «Donner sa vie à ce qui n’existe pas», ou encore: «Faire périr tout ce qui est en moi».
On ne fera pas de sur-interprétation en voyant, chez Canela, une cousine du Lévrier de la Commedia de Dante, grand mystère de la théopoésie, ni non plus un emblème européen de transport poétique rappelant celui de la compagnie d’autobus Greyhound connue de tous les fans de littérature américaine (Fournier en est) en cavale sur le terrain. Et pourtant, s’il y a du dandy à la Thomas de Quincey chez l’Auteur en question qui a sûrement lu De l’assassinat considéré comme un des beaux arts, l’auberge espagnole de son dernier roman, grand ouverte sur le monde qui n’existe pas de la poésie, est aussi le miroir proustien qui lit en chacun de nous et nous faire dire, en lisant, ce qui nous manque pour notre bonheur…




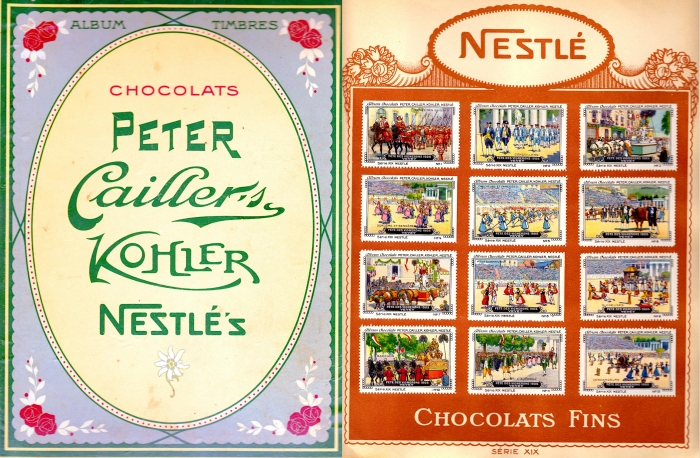

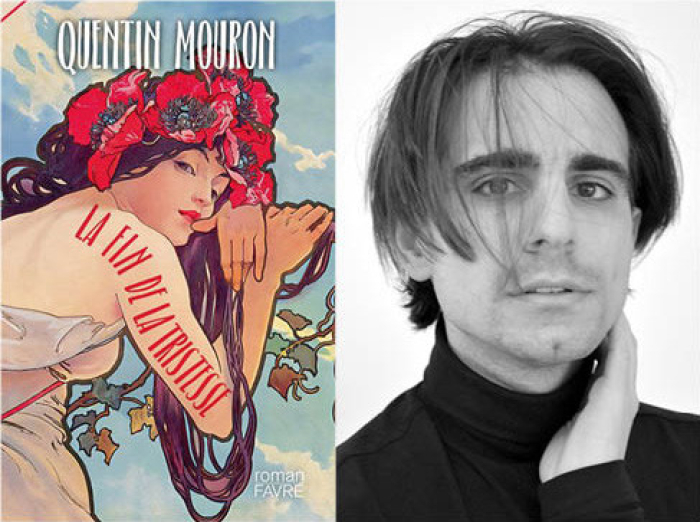
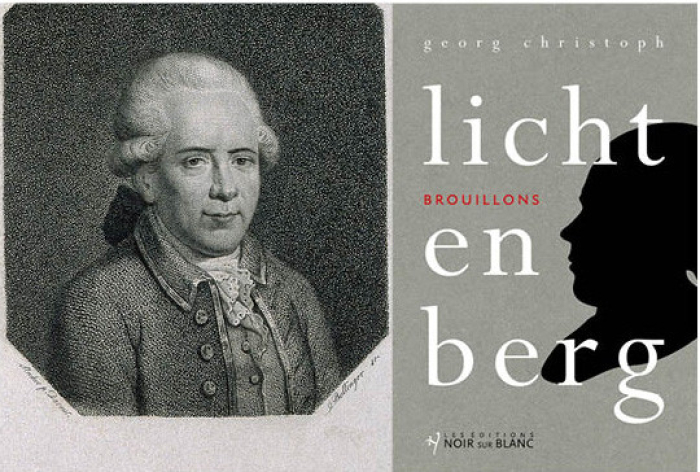
VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire