Culture / Un grand film et une série top nous arrivent via Netflix
Les puristes râleront peut-être, mais la plateforme américaine nous vaut bel et bien la découverte du dernier film de Jane Campion, «The Power of the Dog», exceptionnelle transposition d’un roman de Thomas Savage plus fascinant encore, et d’une série alémanique des meilleures, «Neumatt».
Devrons-nous désormais «faire avec» l’idée que de bons films, voire des chefs-d’œuvre de cinéma, ne se découvrent plus «au cinéma» précisément, dans les grandes largeurs de salles restituant toutes leurs dimensions visuelles et sonores aux ouvrages projetés devant la communauté d’un public, mais dans le format réduit d’une «niche» privée, lucarne de télé ou petit écran d’ordinateur?
C’est la question que je me suis posée ces jours en «visionnant», sur la plateforme de Netflix, le magnifique dernier film de Jane Campion, intitulé The Power of the Dog, déjà multi-récompensé, et la série alémanique Neumatt, dont je ne sais si elle transitera par nos diverses chaînes nationales alors que Netflix lui assure déjà une distribution mondiale.
Dans l’un comme dans l’autre cas, j’avoue que j’ai été ravi d’accéder si directement à un film d’une qualité exceptionnelle, certes découvert dans une dimension réduite, mais que j’ai pu détailler sur mon laptop et revoir même trois fois de suite, non sans apprécier aussi le documentaire disponible sur la plateforme, consacré au tournage du film; de même que je me suis plu à m’attarder sur les huit épisodes de la série helvétique – la meilleure que j’aie vue pour ma part jusque-là – en me documentant parallèlement sur sa réalisation et ses interprètes.
Bref, après les deux ans de restrictions sanitaires qui nous ont éloignés des salles obscures, allons-nous peu à peu renoncer à la magie de celles-ci ou des projections galvanisant des centaines ou des milliers de spectateurs? Je me rappelle à l’instant tant d’inoubliables moments, dont les soirs fabuleux devant l’écran géant de la Piazza Grande, au festival de Locarno!
Reste du moins «la chose», combien appréciée, une fois encore, en l’occurrence, même si la question relative à son mode d’accès reste pertinente…
Avant The power of the Dog: Le pouvoir du chien…
De nombreux commentateurs, ici et là, ont déjà relevé, à propos du dernier film de la réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion (lauréate à Cannes de la Palme d’or en 1993, pour La Leçon de piano), que The Power of the Dog est un aperçu dramatique de la domination masculine, à la fois misogyne et homophobe, autant que du refoulement sexuel fauteur de comportements névrotiques, dans une Amérique blanche encore ensauvagée (cela se passe au Montana en 1925) plus ou moins plombée par le puritanisme – mais ces composantes évidentes en font-elles un film «militant» pour autant? Ce serait simplifier son propos que de l’affirmer, même si Jane Campion développe bel et bien, jusqu’à les exacerber les traits critiques les plus vifs du roman de Thomas Savage, Le Pouvoir du chien qu’il vaut la peine de lire après avoir vu le film pour en découvrir le contenu, humainement plus complexe et plus nuancé en dépit de la fidélité de l’adaptation pour l’essentiel.
Ledit contenu «essentiel» tient, à mes yeux, plus qu’à une étude critique «progressiste» de mœurs obsolètes: à l’approche douloureuse, mais non du tout «doloriste», de plusieurs destinées individuelles «empêchées» par les circonstances sociales ou familiales, sur fond de déplacement de société. En clair dans le film de Jane Campion: après le retrait des vieux parents, deux frères dirigeant un ranch riche d’immenses troupeaux, le grand Phil aîné, teigneux et persifleur, visiblement hanté par une fureur latente, et le cadet George, plus débonnaire et taiseux, tous deux restés célibataires jusque-là. Sur quoi survient LA perturbation, avec LA tentatrice biblique fameuse, sous les traits de Rose, veuve du docteur Johnny Gordon, qui tient une petite pension-restau avec son fils Peter, délicat et raffiné voire efféminé dans ses manières de studieux futur docteur.
Le drame se noue dès la rencontre, à un repas des frères et de leurs cow-boys chez Rose dont le fils est immédiatement taxé de «chochotte» par Phil, lequel se montre d’autant plus homophobe qu'il couve la honte d’un amour secret. Or, George prenant la défense de Rose, puis épousant celle-ci, la montée aux extrêmes de ce que René Girard appelle la rivalité mimétique s’engage, qui va faire agir Phil en sale con (dans le film surtout), Rose subir d’atroces humiliations – scène odieuse d’une invitation mondaine – George faire le gros dos et le tendre Peter fomenter une vengeance pour ainsi dire «sanitaire», sinon «scientifique»…
Tout cela (toujours dans le film) magistralement campé dans l’espace-image et les intensités sonores ou sensibles, sensuelles ou affectives: Phil immédiatement écrasant par le claquement de ses pas et le cinglant de ses regards (un Benedict Cumberbatch à vous glacer le sang, l’âme et les tripes), George non moins présent mais comme «par défaut», en silences et décisions aussi sûres que sans fracas (Jesse Plemons également impressionnant), Rose proprement déchirante dans ses tribulations successives (Kirsten Dunst époustouflante de vérité) et Peter (Kodi Smit-McPhee) aussi surprenant de grâce inquiétante dans le film que dans le livre…
Quant au Pouvoir du chien de Savage, précisément, il nous en dit évidemment beaucoup plus sur les tenants historiques et sociaux et sur les développements individuels de cette sombre et splendide histoire, éclairant les dissonances sociales liées au déplacement des bourgeois riches de la côte est dans ces grands espaces où classes et races se mélangent parfois avec violence, laquelle rejaillit forcément sur les Indiens, et «creusant» le personnage de Phil autant que celui du premier mari de Rose, ce docteur Gordon qui fait figure plus que les autres de «personne déplacée», le seul en outre à voir que Peter, taxé de «tantine» par Phil, recèle en lui une force plus fondamentale que celle de son persécuteur refoulant son désir en «mec qui assure»…
Du bel artisanat label suisse, «socialement concerné», voire LGBT
Le grand art est une chose, comme le prouvent le roman de Thomas Savage et le film de Jane Campion, et l’artisanat, la qualité technique, la bienfacture d’un produit de grande consommation, autres choses, de même que le génie se distingue du talent et celui-ci du savoir-faire efficace. Ces distinctions me semblent importantes à rappeler, tant pour rendre justice aux œuvres d’art qui sortent de la norme, que pour reconnaître le mérite d’ouvrages moins ambitieux mais qui se démarquent du magma de la (sous) culture de masse.
A cet égard, la série Neumatt, réalisée par le Fribourgeois Pierre Monnard et la Zurichoise Sabine Boss en dialecte (!), diffusée avec succès sur la chaîne alémanique avant de passer sous la coupe de Netflix (où elle sera doublée en 30 langues pour toucher 120 pays), intéresse, et séduit tout autant, à la fois par sa thématique, très actuelle, et la qualité de sa réalisation et de son jeu d’acteurs, dans le droit fil d’un nouveau cinéma «socialement concerné» souvent plus rigoureux et généreux, dans son approche de la réalité, que ne le furent celles des réalisateurs plus idéologisés des années 60-70…
En l’occurrence, Neumatt traite – non sans schématisme dans la typologie de ses personnages, mais avec tendresse –, le thème de l’agriculture traditionnelle en butte à une rationalisation urbaine agressive, le scénario étant marqué dès le début par le suicide du père de famille écrasé sous les difficultés financières.
En huit épisodes, la série développe les thèmes directement liés aux statuts particuliers des protagonistes: la difficulté de vivre des agriculteurs, et c’est ici le sort de la veuve du suicidé, campée par la remarquable Rachel Braunschweig (déjà très présente dans L’Ordre divin de Petra Volpe) qui nous touche; le transit des jeunes vers les villes, qu’a vécu le fil aîné Michi (Julian Koechlin, très convaincant lui aussi), consultant dans une entreprise de pub, amant d’un collègue Black et addict à la coke; la situation des mères célibataires vécue par la sœur de Michi (Sophie Hutter) et le défi de la reprise des exploitations, ici relevé par le brave gay rejoignant finalement son frère cadet en formation d’agriculteur, etc.
Et qui donc se plaindrait que Netflix fasse découvrir Neumatt au-delà de nos pâturages?
«The Power of the dog», Jane Campion, sur Netflix, 128min.
«Neumatt», Pierre Monnard et Sabine Boss, sur Netflix, 8 épisodes de 47min.




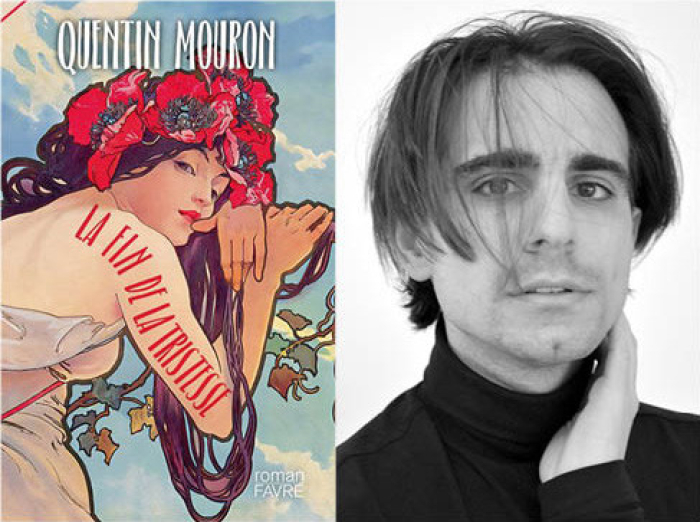
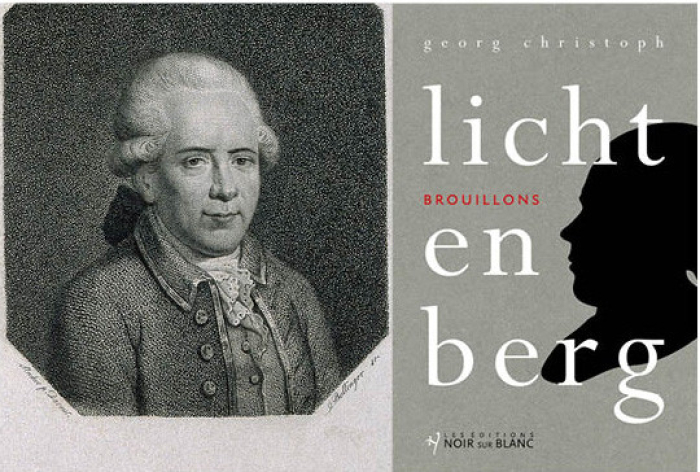


VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire