Culture / Quand les hirondelles d’Ossorguine résistent au chaos du monde
A l’enseigne de La Bibliothèque de Dimitri, salutaire opération de sauvetage du trésor littéraire de L’Age d’Homme, «Une rue à Moscou» de Michel Ossorguine (Mikhaïl dans la présente réédition), représente un fleuron relativement méconnu des fameux Classiques slaves dirigés par Jacques Catteau et Georges Nivat. Comme dans «Vie et destin» de Vassili Grossman, les ténèbres de la tragédie russe s’humanisent sous le regard d’un écrivain impliqué et solidaire, qui oppose son chant du monde au poids de l’Histoire. A (redécouvrir) en ces temps de folie belliqueuse relancée…
D'entre tous les écrivains russes de la première moitié du XXème siècle, la figure lumineuse et solitaire de Michel Ossorguine rayonne d'équilibre et d’empathie, contrastant avec les visages souvent tourmentés de ses contemporains. Peu connu jusque-là (seul Une rue à Moscou fut traduit en français il y a plus de cinquante ans de ça, chez un petit éditeur, mais restait introuvable jusqu’en 1973, date de la première édition à L’Age d’Homme), Michel Ossorguine n'a pourtant pas été épargné par la tourmente historique, son goût inaliénable de la justice l'ayant poussé, tout au contraire, à militer sur tous les fronts où il estima devoir défendre la liberté.
C'est ainsi que, né en 1878 à Perm, il commença par lutter contre le régime tsariste dans les rangs du Parti social-révolutionnaire. Condamné à mort une première fois, puis libéré, exilé en Italie, voyageant de là en France où il se livra au journalisme, il revint en Russie dès 1916, adhéra à la Révolution de Février, mais s'éleva contre celle d'Octobre et, en 1919, passa une nouvelle fois à deux doigts de la mort, séjournant quelque temps dans la sinistre fosse du «vaisseau de la mort» de la Loubianka (prison de la Tchéka) qu'il décrit dans les deux livres auxquels le lecteur de langue française a désormais accès: Saisons, son autobiographie, et Une rue à Moscou.
Expulsé d'Union soviétique en 1922, réfugié à Paris jusqu'en 1940, puis finissant ses jours dans une petite maison située au cœur de la France occupée, Michel Ossorguine semble n'avoir gardé aucun ressentiment à l'égard d'un régime qu'il a certes combattu, acceptant comme une composante de l'âme et de l'histoire de son peuple bien-aimé le dernier état, catastrophique, de la révolution trahie.
Aussi peu marxiste que peut l'être un individualiste ennemi des systèmes simplificateurs, ayant éprouvé la vérité de ses opinions au trébuchet de l'expérience et des souffrances humaines, il nous a laissé, avec Une rue à Moscou, le témoignage artistique le plus extraordinaire qui soit sans doute, recouvrant la période de 1914 aux années 1920 – exceptionnel en cela qu'il prend le parti des humains contre celui des idées, celui des destins particuliers contre celui des concepts abstraits.
Une journée merveilleuse
Roman de presque cinq cents pages serrées divisé en tout petits chapitres, Une rue à Moscou s'ouvre sur une merveilleuse journée, dans la maison d'angle d'une ruelle connue sous le nom de Sivtzev Vrajek, domicile d'un vieil ornithologue savant, célèbre dans le monde entier pour ses travaux.
C'est le temps du retour des hirondelles, et la délicieuse Tanioucha, petite-fille du professeur, apparaît à la fenêtre, qui va éclairer de son sourire jusqu'aux pages les plus tragiques du livre. Le soir, tout un monde d'amis et de connaissances afflue dans la maison de Sivtzev Vrajek – que l'auteur nous présente d'emblée comme le centre de l'univers –, l'on converse et l'on écoute les dernières compositions d'un musicien de grand talent, Edouard Lvovitch.
Il y a là un étudiant ratiocineur, l'une des premières victimes de la guerre toute proche, un savant biologiste, le jeune Vassia préparateur à l'université, un jeune officier plein d'avenir (et l'on verra duquel!) du nom de Stolnikov, la grand-mère Aglaya Dmitrievna, et bien d'autres personnages encore que nous suivrons dans leur destinée.
De fait, tandis qu'Edouard Lvovitch exécute au piano son improvisation sur le thème du «Cosmos», la vie, elle, poursuit son œuvre féconde et destructrice à la fois. Pour annoncer la guerre, Ossorguine décrit alors une bataille rangée de fourmis: «Comme un invisible ouragan, comme une catastrophe universelle, une force divine, irrésistible et destructrice traversa l'espace, inconnu même à l'esprit de la fourmi la plus avisée». Et d'enchaîner aussitôt après: «Les armées des fourmis ne furent pas les seules à périr»...
Et l'on entre dans le tourbillon. Mais que le lecteur n'imagine pas que le mouvement du livre va s'accélérer, pour céder au pathétique. Non: patiemment, posément, Ossorguine agence sur la muraille chaque élément de son immense fresque, laquelle comptera des visions d'une horreur insoutenable, pondérées cependant par le contrepoint des zones lumineuses de la vie reprenant ses droits.
La duperie compliquée et grandiose
De quoi est faite l'Histoire? A en croire Michel Ossorguine, qui en parle assez longuement dans Saisons, ce ne sont pas les historiens brassant leurs papiers poussiéreux qui nous renseigneront les mieux. Le «bruit du temps», dont parle Ossip Mandelstam, n'est pas à écouter dans les bibliothèques ou les archives, mais c'est dans la rue, dans les cours intérieures des maisons, dans les trains et sur les places qu'il faut lui prêter l'oreille. Et c'est ce que fait le romancier.
A cette guerre, ainsi, toutes les justifications a posteriori seront données, tandis que les milliers d'Ivan, de Vassili et de Nikolaï lancés contre des milliers de Hans et de Wilhelm n'ont eu à se satisfaire que de mots d'ordre: «Des mots simples, faciles à prononcer, ainsi qu'un certain nombre de belles expressions, les mêmes dans toutes les langues, pour remplacer la pensée...»
«De cette façon, continue le romancier, grâce à une purification méticuleuse, les turpitudes et les mensonges des ronds-de-cuir se trouvaient, en dernier lieu, transformées en bel héroïsme et en larmes pures. Quant aux gens bornés, ils parlaient de simple duperie, ce qui était injuste: la duperie était très compliquée et grandiose…»
Plus compliquée et plus grandiose, encore, car née du peuple, et non plus seulement orchestrée par les puissants de ce monde, sera la duperie de la Révolution, et la vision qu'Ossorguine nous en donnera, multipliant les points de vue, saura nous apprendre, par le détail, à replacer chaque élan légitime et chaque erreur dans le contexte dramatique d'alors: «Des deux côtés, il y avait des héros, des cœurs purs, des sacrifices, des hauts faits, de l'endurcissement, une noble humanité non livresque, de la cruauté bestiale, la crainte, les désillusions, la force, la faiblesse, le morne désespoir. Il eût été beaucoup trop simple, et pour les survivants et pour l'histoire, qu'il existât une vérité unique ne combattant que contre le mensonge. Car il y avait deux vérités et deux honneurs luttant l'un contre l'autre. Et le champ de bataille était jonché des cadavres des meilleurs et des plus braves.»
Le peuple russe en fresque
Concentré sur une vingtaine de personnages, Une rue à Moscou déploie à vrai dire la chronique du peuple russe tout entier durant ces années terribles. Si toutes les classes sociales ne sont pas représentées par Ossorguine (point de bourgeois ni d'aristocrates, par exemple), il nous invite néanmoins à suivre les faits et gestes d'une poignée de braves gens, parmi lesquels il s'en trouvera de plus vulnérables que les autres – ou de moins chanceux, tout simplement –, qui succomberont à la première vague d'événements.
Il en va ainsi du beau Stolnikov, les jambes sectionnées par un obus, homme-tronc monstrueux qui finira par se jeter du haut d'une fenêtre; et d'autres qui, lors des années de famine, «s'arrangeront» comme ils pourront avec le nouveau régime, tel le misérable Zavalichine, devenu bourreau de la Tchéka en sorte de toucher de plus abondantes rations.
Or Michel Ossorguine ne juge pas, et n'accuse jamais. Ce n'est pas «omnitolérance» de sa part, car on sent bien la sourde colère qu'il entretient à l'endroit des «grosses légumes», mais cela participe bien plutôt de son choix de décrire et d'expliquer le sort et les réactions d'une humanité moyenne prise dans un engrenage qui la dépasse.
C'est là justement que réside l'immense intérêt d'Une rue à Moscou, sans compter la foison de détails observés par l'auteur. Le roman s'achève, après l'audition de l'Opus 37, dernière œuvre d'Edouard Lvovitch dans laquelle le génial musicien (on pense à Chostakovitch) concentre les aboutissants de la tragédie: «Le sens du chaos est né. Le sens du chaos!» Mais le chaos peut-il avoir un autre sens que l'attente du retour des hirondelles?






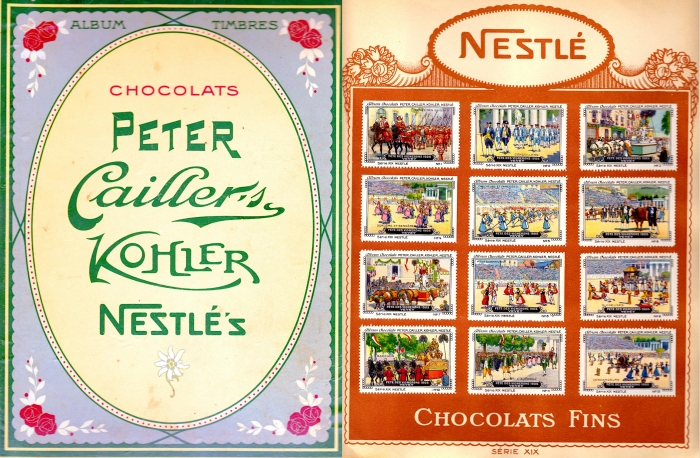

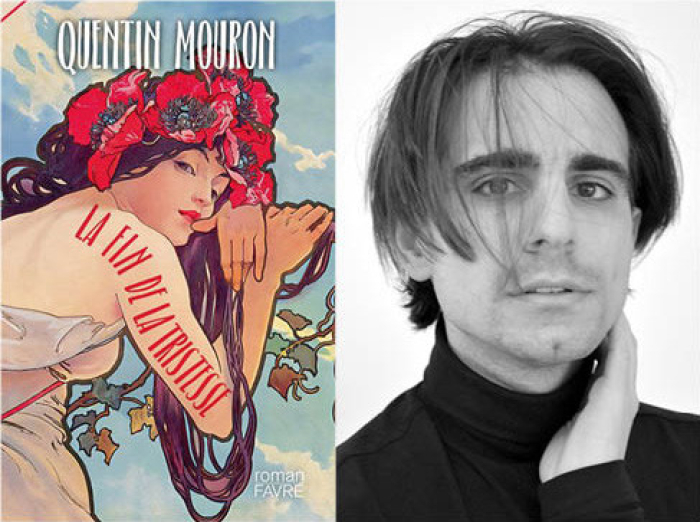
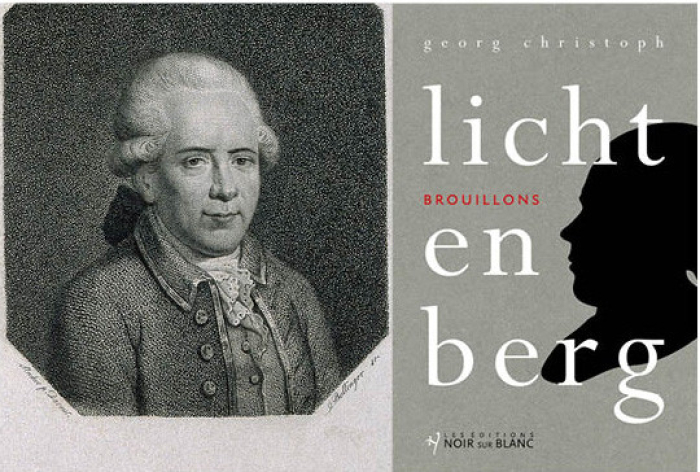
VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire