Culture / Quand Jo et Jerry nous la jouent âge tendre et tête de gondole
Coïncidence: deux auteurs genevois signent, au même moment, deux romans «américains», chacun dans sa catégorie. Joël Dicker se revisite lui-même avec «L’Affaire Alaska Sanders», pour une enquête étroitement liée à celle qui lui valut son premier (phénoménal) succès; et Jean-François Duval, dans le plus original de ses romans, décape et revivifie le mythe des beatniks avec «LuAnne, sur la route de Neal Cassady et Jack Kerouac», en donnant (notamment) la parole à la fille fleur Marylou du roman culte «Sur la route» dont il a rencontré le modèle. Deux livres peu comparables apparemment, mais qui ont plus d’un point commun et peut-être des plus importants?
Les voies de la littérature sont décidément très variables, et la parution simultanée de deux livres de deux auteurs genevois de générations différentes mais également passionnés par le livre et l’écriture, la culture américaine et la vie des écrivains, peut être l’occasion, sans comparaisons abusives, d’apprécier des voies différentes dans la façon d’approcher le monde et de traduire ses perceptions et autres émotions, qui se rejoignent cependant dans leur soubassement affectif et sensible.
Pour «la faire court», selon l’expression courante, je dirai que Joël Dicker et Jean-François Duval sont également amoureux: amoureux de l’amour, amoureux de l’amitié et amoureux de la liberté. Cela paraît «nunuche» comme départ d’une chronique littéraire, mais c’est mon sentiment profond après lecture de ces deux livres également imprégnés d’amour, d’amitié et d’aspiration à la liberté manifestée de façons certes très variées, dans les deux romans, mais avec autant d’intensité candide.
Voilà le mot lâché: candeur. Candeur de Marcus Goldman, l’écrivain «prodige» qu’on peut dire le double romanesque de Joël Dicker; et candeur de LuAnne Henderson, inspiratrice de la Marylou de Kerouac, en tout cas dans le personnage qu’en reconstruit Jean-François Duval à partir de nombreux éléments oraux qu’il a glanés de vive voix.
Candeur et pureté, ajouterai-je. Pureté du jeune mec qui croit que la vie d’écrivain est la plus formidable qui soit. Pureté de la nana qui vole d’aventure en aventure sur ses ailes de Lolita Peace & Love. Malgré des crimes carabinés et des intrigues retorses: pureté limpide du feuilleton selon Dicker. Malgré frasques de voyous, coucheries multisexuelles, drogues et déprimes: pureté joyeuse des personnages de Duval.
Quand Joël via Marcus écrit le roman de Goldman signé Dicker…
C’est entendu: Joël Dicker en fait trop. Vraiment too much, Jo. Non mais visez cette sortie: ces devantures envahies, ces présentoirs à foison, ces piles un peu partout, et partout son effigie de gendre idéal devenu, multimillionnaire, son propre éditeur contrôlant donc toute la chaîne, et plus encore que vous ne l’imaginez…
Parce que le festival continue dès que vous passez le seuil de son dernier livre forcément voué au succès, si forcément que c’est annoncé à la fin du roman, lequel paraît (fictivement) en 2011 et se trouve aussitôt en voie d’adaptation à Hollywood – ce qu’on appelle une mise en abyme caractérisée à dédoublement diachronique pour ainsi dire «quantique», puisque le roman de Dicker que vous allez lire est le roman que Marcus Goldman a écrit quasiment en même temps qu’il menait, avec son rugueux ami le sergent de la criminelle Perry Gahalowood, l’enquête sur l’assassinat de la ravissante Alaska Sanders, Miss Nouvelle-Angleterre rêvant de faire du cinéma avant d’être étranglée puis dépecée par un ours noir – mais là j’en dis déjà trop…
Or dès les premières pages, l’auteur de L’Affaire Alaska Sanders (Jo Dicker qui tient la main de Marcus Goldman), rappelle à la fois sa gloire et les déboires liés à celle-ci (le coup de la panne d’inspiration paralysant soudain l’écrivain écrasé par son succès), le million d’exemplaires de son premier roman (G comme Goldman, qui n’est paru que dans l’imagination du binôme), suivi du triomphe de La Vérité sur l’affaire Harry Quebert (dont il n’est plus seulement l’un des protagonistes mais l’auteur), la lectrice et le lecteur – déjà au parfum ou nouveaux venus – étant invités à partager l’enthousiasme qu’a soulevé la lecture de La Vérité sur L’affaire Harry Quebert, et la parole du flic bourru fait office de conclusion de rapport: Marcus Goldman est le Top Gun des lettres américaines, point barre, et vous comprenez in petto que Big Jo est son copilote…
Ceci dit, et blague à part: le dernier Dicker est, c’est le cas de dire, une affaire qui roule à tous égards, littérature comprise dans le mulktipack.
Vous prétendez que ce que fabrique Joël Dicker n’est pas de la littérature, après les adoubements successifs du grand proustien Bernard de Fallois, du magistral Marc Fumaroli du Collège de France et de l’Académie française lui collant son Prix? Vous affirmez qu’un auteur qui raconte des histoires pleines de personnages relève d’une esthétique dépassée par le Nouveau Roman et les dernières conquêtes de la Déconstruction? Vous relevez le manque de «style» de cet écrivain que Blaise Pascal, aussi grave que vous, dirait probablement adonné au seul «divertissement»? Vous concluez, en policiers du littérairement correct, que le succès ne prouve rien? Et comment ne pas vous donner raison? Et tort à la fois, vu que la littérature est faite de tout ça: Pif le chien ou Petzi à vos cinq ans, le Club des cinq à vos dix ans, et ensuite L’île au trésor, Dickens, les romans-photos des années 60 et les mangas des années 90, Bob Morane et Jack London, Le Mouron rouge et Boris Vian, que des bonheurs de lecture.
Et n’est-ce pas à cela que ramènent, aussi et sans prétention, les romans de Joël Dicker? Sûrement pas un styliste, mais un storyteller imbattable et, dans L’Affaire Alaska Sanders, un ingénieur-architecte du roman policier dont la construction temporelle et les effets de réel participent en somme aux rebonds de l’intrigue, un auteur mûri dont les thèmes très personnels se réaffirment avec des nouvelles avancées: la passion amoureuse et ses délires sur fond de classe moyenne américaine propre-en-ordre, l’amour et l’amitié qui «baignent» et que plombent (heureusement!) défaillances et trahisons. Très résumée: l’histoire d’un crime parfait bonnement machiavélique, ses dommages collatéraux dramatiques, une erreur judiciaire et ce qu’elle implique de connaissance des rouages du Système explorés par l’auteur avec la redoutable minutie qui est la sienne, en toute candeur, mais combien rouée et rôdée en son professionnalisme, n’est-ce pas?
Le mentir vrai de Jerry Duval fait florès
Certains livres ont ce qu’on pourrait appeler «la grâce», sans référence mystique pour autant mais par l’espèce d’aura qui en émane, ou par leur façon douce et persuasive à la fois de vous emmener vous ne savez trop où, peut-être au bout du monde ou peut-être au fond de vous-même, en tout cas vous y allez, vous vous laissez faire comme en enfance quand on vous racontait une histoire et que plus rien d’autre n’existait alors après le sésame d’«il était une fois»…
Or cette fois, en suivant LuAnne sur la route avec Neal Cassady et Jack Kerouac, ce n’est pas tant mon enfance mais toute une part de notre jeunesse qui m’est revenue par la grâce du dernier roman de Jean-François Duval, instaurant aussitôt une sorte de magie qui tient, plus qu’à son thème (le premier underground culturel américain des années 60-70), à sa tonalité affective et «musicale».
Cette tonalité m’a immédiatement évoqué, pêle-mêle, l’adorable «trio fatal» de La fureur de vivre (James Dean, Nathalie Wood et Sal Mineo), futur «film culte» datant de 1955 mais que je n’ai découvert qu’à mes seize ans au cinéma Colisée des hauts de Lausanne, nos propres premières amours et révoltes de boomers oscillant plus tard entre militantisme politique et libération sexuelle, passions musicales et littéraires, tels en somme qu’on les retrouve dans le roman non moins «culte» de Jack Kerouac intitulé Sur la route et paru en 1957 – découvert bien plus tard en nos contrées…
Cependant je me garderai du ton de l’ancien combattant raseur pour évoquer le roman de Jean-François Duval, dont la «grâce» devrait toucher toutes les générations tant sa LuAnne – d’abord quasi nymphette par son âge, mais très vite entraînée dans un tourbillon – incarne, plus que la fureur: l’appétit de vivre et l’impatience de partager les aventures de la joyeuse bohème littéraire du moment aux formidables incarnations, en les personnes de Neal Cassady le viveur indomptable, Jack l’écrivain et Allen le poète, notamment.
De cette Amérique-là, qu’on a dit de la contre-culture au tournant de 68, Jean-François Duval est un connaisseur de longue date et non seulement par les écrits ou les films puisqu’il a rencontré Allen Ginsberg, Charles Bukowski ou LuAnne Henderson en sa soixantaine, et signé déjà plusieurs ouvrages de spécialiste. Or le romancier de Boston Blues (2000, Prix Schiller) sur la base de lectures référentielles indiquées en fin de volume, parvient ici à l’exploit d’effacer, pour ainsi, dire, la masse des documents consultés ou des témoignages enregistrés dans un récit à plusieurs voix d’une parfaite fluidité et, surtout, d’une vivacité à la fois généreuse, lucide et tendre.
Quoi du roman dans ce dialogue entre Jerry (le pseudo transparent de l’auteur) et LuAnne, dont les propos sont partiellement repris d’un entretien de son vivant? Précisément: cette «grâce» d’une fiction plus vraie que nature (Ginsberg saluait lui-même ces mensonges qui disent le vrai mieux que certains rapports même fidèles), qui doit beaucoup au magnifique personnage de LuAnne tenant à la fois de la petite fille folâtre et de la femme à qui on ne la fait pas, de la jeune amante sans préjugés et, d’une certaine manière, de la compagne de bon conseil auprès de ces grands fous artistes, parfois infantiles et parfois dangereux (surtout l’incontrôlable Neal) qu’elle accompagne sur la route dans leur épique équipée – tous à poil à tel moment mythique…
A relever alors, dans la foulée, le travail de «musicien» opéré par Jean-François Duval – reporter au long cours bien connu pour ses entretiens et la qualité de son écoute – sur les multiples registres vocaux de sa narration, autant que sur la reconstruction quasi cinématographique de la suite des séquences du roman, qu’on a parfois l’impression de vivre en 3D.
Bref, la très sympathique (et parfois pathétique) saga serait à détailler dans ses multiples aspects «réels» ou «fictifs», avec les malicieuses retouches faites par LuAnne ou Jerry au mentir-vrai antérieur du roman de Kerouac, mais à chacune et chacun de «prendre la route» et de se trouver, à son tour, possiblement touché par telle «grâce»…
«L'Affaire Alaska Sanders», Joël Dicker, Editions Rosie&Wolfe, 574 pages.





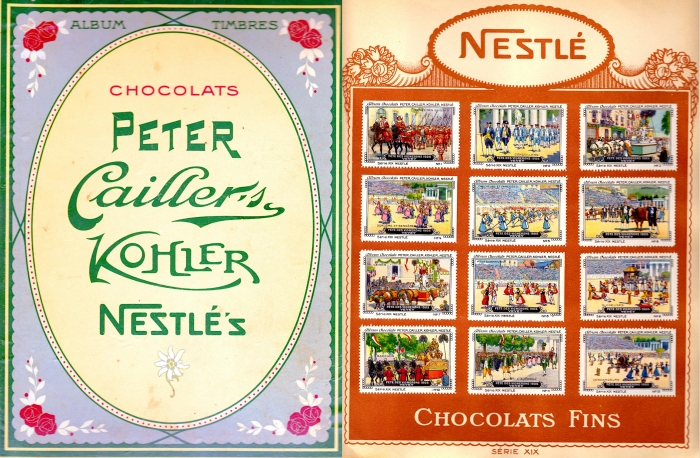

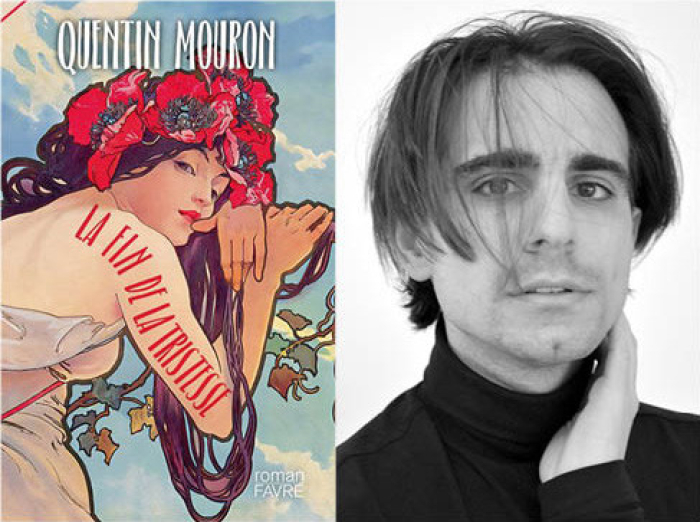
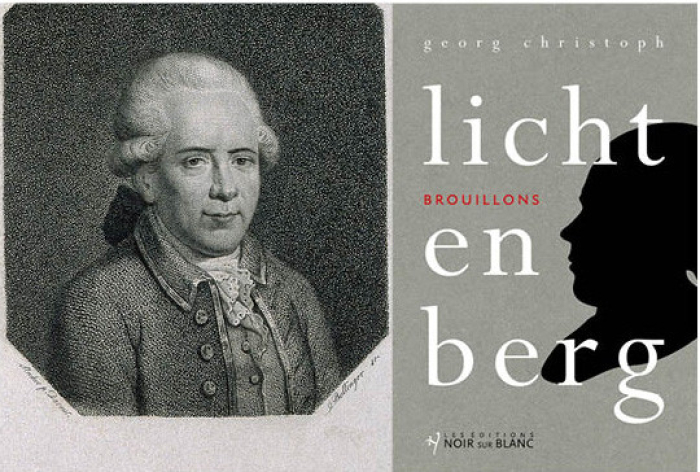
VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire