Culture / Le Temps selon Pascal Quignard est comme un grand jardin de mots
Lier le proche et l’universel, le détail et tout le toutim, au gré de nos pauvres ou riches heures, est le propre du génie poétique. Celui-ci surabonde au fil des pages des «Heures heureuses», constituant le douzième volume du «Dernier royaume», grand voyage autour de la chambre d’échos du monde où musiques et pensées, présent immédiat et passés mêlés vont de pair face à la merveille du vivant et au silence intemporel de la mer – poids du monde et chant du monde.
Lorsqu’on lui demandait l’heure, la voyageuse étonnante (non moins qu’étonnée, cela va sans dire) qu’était Ella Maillart répondait: «il est maintenant», mais que voulait-elle dire? Je n’en sais trop rien, n’ayant jamais rencontré la fumeuse de pipe en question ni d’ailleurs beaucoup lu de ses récits de voyage «cultes» qui me semblaient manquer de charme et de chair et auxquels je préférais celui de Lina Bogli intitulé En avant! dans sa traduction française d’Anne Cuneo, mais cette réponse péremptoire et d’une apparente sagesse stoïcienne, ou peut-être zen, m’est restée sans que je sois sûr de sa signification ni de la sincérité de sa locutrice. Parce que maintenant c’est quoi et c’est quand? Célébrer l’ici et le maintenant vaut-il mieux que sonder le naguère et le jadis? Et qui, n’en déplaise à notre regretté compère Roland Jaccard, voudrait se cantonner dans le «monde d’avant» au motif que le présent devient inhabitable et non seulement à Bakhmout ou à Gaza?
Sur quoi, relevant d’un deuil, en rémission d’une maladie mortelle ou au bord de l’abîme du temps, vous lisez: «Il est l’heur».
Dans la profusion des nouveaux livres, l’autre jour, entre prix littéraires de l’automne et autres romans à succès «incontournables» voués à un oubli prochain, ce discret ouvrage blanc à titre bleu vous a fait signe et l’ouvrant vous êtes tombé sur ces lignes relevant de l’ici et du partout, du jadis et du maintenant de tout le temps: «L’amour est la seule motivation, immotivée, qui se rapporte directement à l’élan de la vie. Il est l’heur. Qui est aussi mal-heureux qu’il croit? Qui est aussi heureux qu’il l’avait espéré? L’annonce d’une maladie mortelle qui nous frappe délimite soudain l’ombre du paradis.»
Aux infos le même soir il était question de l’enfer de Gaza. Après celui de l’atroce razzia du 7 octobre (une date qu’on a dit «historique» le jour-même), la vengeance invoquant les temps bibliques et la mort invoquée de «droit divin», Yaweh jetant l’anathème sur la tribu et l’exclusion engendrant l’exclusion, puis revenant à votre tout petit «moi» vous vous êtes rappelé La mort d’Ivan Illitch de Tolstoï, ou le film Vivre de Kurosawa: la story de celui (ou de celle) qui apprend qu’il (elle) est condamné (e) par «la faculté» et qui se demande comment vivre le reste de son temps accordé?
Alors Pascal Quignard d’enchaîner les mots qui délivrent, les mots qui exorcisent les maux: «L’annonce d’une maladie mortelle qui nous frappe», et c’est évidemment pour nous toutes et tous, même loin de la guerre, «délimite soudain l’ombre du paradis». Cette étrange ombre portée autour de nous consacre ce qui va être perdu mais en le consacrant elle le fait resplendir. Ce relief merveilleux et subit importe plus que le seul décompte des jours qui restent à vivre. Il est curieux qu’on puisse dire de ce décompte qu’il s’agit d’une sorte d’Eden. La ligne que porte cette ombre inscrit la frontière d’un monde perdu dans le réel, déposant cette ombre sur l’étendue de plus en plus diminuée des jours, la mort apporte aussi un lieu ou du moins met en place un rivage; un espace qu’on ne peut plus franchir; une espèce de lumière pâle, faible, s’élève sur cette étendue sublime où vient se concentrer le plus beau, du moins le préféré de ce qui fut vécu. Quelques morceaux de paysages, dans cette menace qui soudain gagne tout, supplient particulièrement le ciel».
Entre minutes heureuses et Riches Heures
Quant au «maintenant» d’Ella Maillart, il est daté ce matin, et c’est un paysage à ma fenêtre donnant sur les hauts du Grammont et leur première neige. Nous sommes le 23 novembre 2023, jour dédié à Sainte Catherine, dite «la pisseuse» parce qu’il pleut souvent à la fin novembre, et l’Almanach cite quelques dictons en ribambelle: «Pour la sainte Catherine tout arbre prend racine, le feu est à la cuisine, l’hiver s’achemine, l’hiver s’aberline, il faut faire la farine, le cochon couine, les sardines tournent l’échine», etc. Sainte Catherine est la patronne des jeunes filles, mais aussi des étudiants et des philosophes, donc il y en a pour tout le monde, autant que dans le jardin de mots de Pascal Quignard dont une série (le romancier-essayiste est un story tailor et plus encore un serial poète) intitulée Dernier royaume, amorcée en 2001 avec Les Ombres errantes, représente à mes yeux l’une des plus fabuleuses lectures du monde que nous offre un auteur contemporain de langue française.
L’on pense immédiatement aux «minutes heureuses» de Baudelaire, dont notre cher Georges Haldas a relancé la formule dans ses épiphanies familières, en pénétrant dans cette nouvelle donne de l’immense dédale cartographié par l’Auteur, sur une scène comique mettant en scène les courtisans de Napoléon III qui dansent le soir comme de petits automates autour d’un piano actionné à la manivelle par le chambellan de l’empereur, dont l’ennui s’exprime par la question fameuse («Quelle heure est-il?») en attendant onze heures pile ou le couple impérial ira, l’heure c’est l’heure, se pieuter.
Romancier à jet continu, autant qu’il est philologue érudit ès humanités classiques et maître de son archet au violoncelle, mémorialiste de tous les siècles (l’Antiquité mutiple, le Moyen Age, Montaigne, Bakhmout et Gaza annoncés par la saint Barthélémy et la Shoah, sans oublier le Japon ou la Chine et les oiseaux d’Emily Dickinson) et confident tout personnel de ses lecteurs invités dans le jardin de mots et de maux de son enfance, Pascal Quignard peuple son «royaume» d’innombrables «pipoles» historiquement crédités (badge vérifiable sur Wikipedia) dont il extrait autant de biographèmes significatifs.
Et c’est la passion vertigineuse de La Rochefoucauld, les transes du psychanalyste hongrois Sándor Ferenczi aboutissant à la publication de Thalassa, «le plus beau des livres que la psychanalyse a suscités», amorcé en 1914 et composé «à l’intérieur de la guerre», dont le titre hongrois plus explicite de «Catastrophes au cours de l’évolution de la vie sexuelle» nous relie à «ce qui existe en nous obscurément depuis la nuit des temps», laquelle renvoie plus en douceur au sommeil de Cendrillon qui ne comprend plus rien quand elle se réveille, cent ans plus tard, dans son corps de vingt ans…
Donc Cendrillon «la fille des cendres», Jacques Esprit et Giordano Bruno dont le corps est devenu flamme au Campo de’ Fiori pour avoir dit que l’histoire humaine n’occupait plus le centre du temps, et plus que toutes et tous cette amie, cette Emmanuelle de malheur qui a fait son bonheur secret sans partage sexuel mais en fusion et en effusion tenant là aussi de la merveille – bref le roman de la vie avec son putain de cancer de merde, tranfigurée par la poésie.
Si l’enluminure domine la phrase et les images, les liaisons sémantiques ou plastiques inouïes de la prose éminemment poétique de Pascal Quignard – et le rapprochement avec les Riches Heures du Duc de Berry se fait d’ailleurs explicitement dans un chapitre -, la part de l’ombre n’en est pas moins constante, une fois encore, sous les moires de l’étincelante surface océanique.
Le grand Ramuz écrivait un jour «Laissez venir l’immensité des choses». Et le non moins épatant Charles-Albert Cingria de nuancer: «Ça a beau être immense: on préfère voir un peuple de fourmis pénétrer dans une figue». Et Pascal Quignard à propos des extases et de la mort de sainte Thérèse d’Avila: «Il faut laisser des années vides dans la chronique du temps. Il faut laisser des espaces vierges dans les forêts, le long des barbelés des champs, sur les flancs des collines, sur les plateaux des falaises»… Et encore: «Soustraire l’existence à la logorrhée, au baratin, à la circulation sans fin des voix et des préceptes, à la meute, au verbum, au fourrage. Il faut laisser au bout des labours des déserts, des bouquets d’arbres, des taillis, des buissons, des touffes de chardons, des plages blanches, des bords de mer ou de lacs sauvages. Il faut s’écarter du pogrom»…
Et enfin: «La Nature est peut-être la plus belle forme du temps, plus profonde que la langue et plus vaste que l’Etre»…




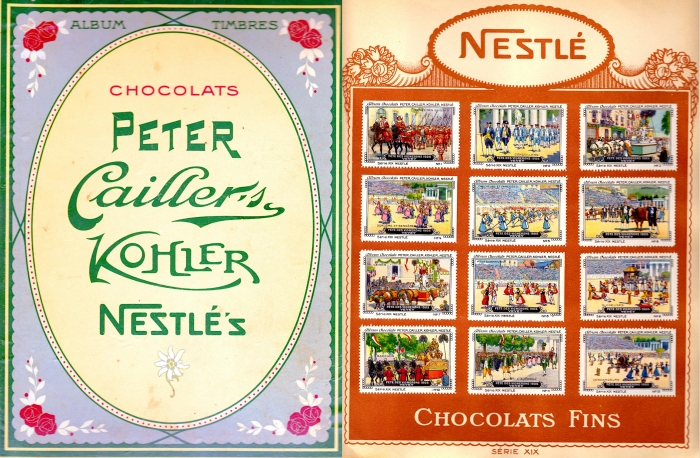

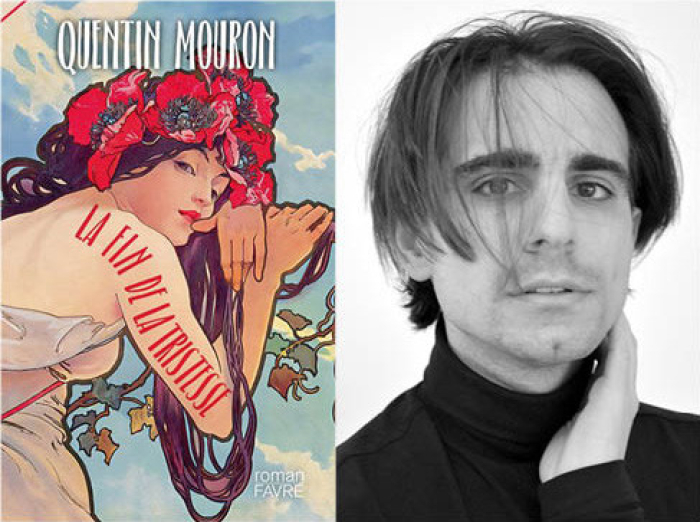
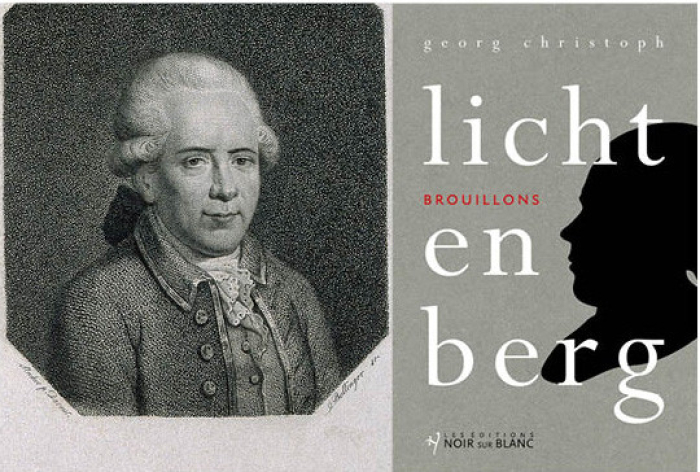
VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire