Culture / Keller et Walser ont toujours de la Suisse dans les idées…
Coup double de fringante volée aux éditions Zoé, avec la parution d’une première édition complète des «Gens de Seldwyla», nouvelles emblématiques de Gottfried Keller, et la version originale des fameuses «Promenades avec Robert Walser» de Carl Seelig, dans une nouvelle traduction en français «fédéral» et une mise en perspective éclairante.
«La Suisse n’existe pas», proclamait le slogan culturel de Ben Vautier visant à prouver le contraire à l’expo de Séville, en 1992, dans un bel élan d’avant-garde béni par l’officialité et l’élite la plus chic, et l’on sourit au rappel de ce qui semble aujourd’hui une bravade «choc» passée de mode en lisant deux livres d’une totale fraîcheur qui sentent la Suisse à plein nez: la terre et l’herbe qui faisait rêver Nicolas Bouvier quand il se trouvait au Japon, la campagne et la ville qui se sont chamaillées pendant des siècles, les petites largeurs cantonales et l’appel du large qui a fait faire le tour du monde à l’institutrice Lina Bögli avant Cendrars et Ella Maillart, les cafés du Niederdorf zurichois et leur Keller Stube voisinant avec l’Odéon de Dada et de Joyce, ou l’arrière-pays des sublimes collines d’Appenzell où Robert Walser n’en finissait pas de promener son parapluie, etc.
Gottfried Keller et Robert Walser, tout différents qu’ils fussent, étaient en somme du même bois «suisse» qu’un Ramuz, et tous trois, en poètes «réalistes», auraient sans doute trouvé loufoque une formule telle que «la Suisse n’existe pas», malgré le «quelque chose» de vrai qu’il y a là-dedans, comme il y a du vrai dans l’affirmation de Ramuz selon laquelle la «littérature suisse n’existe pas» ou, balancée l’an dernier par un Michel Thévoz, celle que «l’art suisse n’existe pas»…
Arguties que tout ça? Paradoxes mondains ou contradictions bavardes? Plutôt: composantes d’une réalité riche et souvent contradictoire, bonnement présente dans la «conversation» de Walser.
Quand la marche est une démarche
Rousseau dit quelque part qu’il n’a jamais si bien pensé qu’en marchant, je ne sais plus qui affirmait que le meilleur de la littérature romande était sorti de la cinquième rêverie du solitaire en question, et c’est vrai que la promenade, de Jean-Jacques à Philippe Jaccottet, en passant par Gustave Roud célébrant la marche en plaine ou Charles-Albert Cingria le perpétuel itinérant, fait chez nous autres figure de véritable démarche poétique, avec quelque chose de spécifiquement suisse qu’on retrouve chez Walser autant que, cinquante ans plus tard dans les balades des deux compères Baur et Bindschedler de Gerhard Meier, ou plus récemment dans les longues trottes d’un Daniel de Roulet ou d’un Jean Prod'hom.
Mais quoi de «spécifiquement suisse» en cela? Disons que la constante proximité de la nature y va de pair avec un brassage de culture au sens le plus large, où le dialogue joue parfois un rôle majeur.
A cet égard, les Promenades avec Robert Walser, consignées dans un récit au charme savoureux, constituent un modèle du genre, autant par leur contenu littéraire et humain que par le «montage» très particulier élaboré par Carl Seelig.
Lucidité et mémoire d’un «zéro» social
Lorsque Carl Seelig, chroniqueur littéraire et poète zurichois dans la quarantaine, dont la fortune personnelle lui a déjà permis d’aider financièrement plusieurs auteurs, se pointe pour la première fois à la maison de santé cantonale d’Appenzell Rhodes-Extérieures, à Herisau, Robert Walser, âgé de 58 ans, au «visage enfantin tout rond, fendu comme par la foudre, les joues un peu rouges, les yeux bleus et une courte moustache dorée», lui apparaît avec sa cravate de travers et ses dents en mauvais état, et tout de suite un détail noté en dit long: alors que le médecin-chef Otto Hinrischen, qui a autorisé cette première promenade, fait mine, en bon paternaliste, de fermer le dernier bouton de la veste de son pensionnaire, celui-ci se rebiffe en dialecte bernois «mélodieux»: «Non, celui-ci doit rester ouvert!»
On voit le tableau. En outre Seelig a été averti par la sœur aînée de Walser: Robert est «extrêmement méfiant». Alors de préciser dans son premier récit que «le silence fut la passerelle étroite sur laquelle nous nous sommes rejoints». Mais dans une autre lettre la version sera un peu différente, selon laquelle Walser et lui se sont tout de suite parlé naturellement et beaucoup.
On voit ainsi illico que le récit de Carl Seelig est construit, fidèlement sans doute pour l’essentiel mais correspondant au regard – très intelligent, sensible et cultivé d’ailleurs – du compagnon de route qui s’implique lui-même et souvent pour le meilleur.
Le «montage» de Seelig brasse la matière de ces balades en détaillant à la fois les charmes du paysage, la beauté de telle vieille façade ou de telle servante bien fessue, le menu des repas toujours bien arrosés, engloutis après des dizaines de bornes à pied à ne cesser de parler, et le résumé très vivant voire dialogué de ces conversations où l’on parle de tout: des nuages («ils ont un air d’amitié, comme de bons camarades silencieux, tout de suite grâce à eux le ciel s’anime, s’humanise», de la tyrannie à l’époque de la montée du nazisme, de Staline juste après sa mort («J’ai toujours été dégoûté par l’encens qu’il exigeait qu’on répande autour de lui»…), de la beauté («la beauté vraie, la beauté du quotidien, se révèle plus subtilement dans la pauvreté et la simplicité», du tourisme croissant («On voyage beaucoup trop aujourd’hui. Les gens partent en troupeaux dans les pays étrangers et se comportent avec un sans-gêne absolu, comme s’ils étaient chez eux»), de l’intervention américaine en Corée («orgueil imbécile, arrogant, cupide, en quoi le combat pour la liberté d’un grand peuple d’ancienne culture concerne-t-il les Américains?»), de la souffrance parfois fertile pour l’écrivain («sans l’expérience de l’échafaud et de la Sibérie, Dostoïevski n’aurait pas pu écrire»), des écrivains et des livres qu’il a aimés (Keller et Goethe viennent en tête, Eichendorff ou Gotthelf quand il ne sermonne pas), etc.
La mémoire de Walser, que Seelig dit justement «prodigieuse», lui permet de raconter de nombreuses anecdotes significatives remontant à sa jeunesse et à ses innombrables rencontres et lectures, et le «ton» si particulier de l’écrivain se retrouve dans les observations du promeneur. Mais Carl Seelig n’est pas en reste, qui s’intègre parfaitement dans ce «tableau» avec des portraits de femmes d’exception, notamment.
Dès leur première promenade, Walser évoque ses débuts d’écrivain couronné d’insuccès, si l’on ose dire, qui doit beaucoup à sa méfiance instinctive envers les chapelles littéraires et la «lèche» qui lui donne la nausée. Du même coup, parlant de ses années les plus productives (sept ans à Berlin après sept ans à Zurich, et ensuite sept ans à Bienne, il critique les «années honteuses» vécues par «la plupart des écrivains» pétris de haine après la Première Guerre mondiale, alors que selon lui la littérature doit rayonner de bienveillance: «On décernait les prix littéraires à de faux sauveurs ou au premier maître d’école venu». Or son propre «déclin» est lié selon lui à son refus de s’aplatir ou de donner des leçons. Mais c’est sans aigreur qu’il reviendra, durant ces vingt ans de promenades, sur le fait qu’il se considère comme un raté social, et chaque fois que Carl Seelig proteste en lui rappelant la considération qu’il s’est acquise auprès des meilleurs auteurs (d’un Kafka ou d’un Hesse, notamment), Walser s’énerve comme l’impatientent les éloges et autres commémorations, nouvelles publications de ses œuvres et prix littéraires que Seelig cherche à lui obtenir.
Rejet de toute littérature qui rappellerait l’exil de Rimbaud? Non, le cas est tout différent. Humilié de toujours, mais à la fois résigné dans sa mélancolie; taxé de schizophrénie et se laissant en somme faire, Walser ne se plaint pas. Il est vrai qu’il n’écrit plus, alors qu’on lui a proposé un arrangement qui le lui permettrait, mais lui-même refuse tout privilège par rapport aux autres pensionnaires de l’institution: comme eux il s’astreint aux plus humbles travaux consistant à plier des bouts de carton et à trier des ficelles…
Un écrivain «à l’oral»
Cela étant, sa parole est bel et bien la prolongation de ses écrits, et ce qu’il dit recoupe souvent et prolonge ce qu’on a lu dans ses romans.
Le 28 janvier 1934, au cours d’une longue marche qui conduit les promeneurs de Saint-Gall à Rorschach, Walser raconte comment il a composé ses Rédactions de Fritz Kocher, à Zurich, dans la rue où Lénine a vécu, et pourquoi il n’a pas «réussi» à s’imposer comme écrivain: «D’emblée, mes débuts littéraires ont dû donner l’impression que je me moquais du bourgeois, comme si je ne le prenais pas tout à fait au sérieux. On ne me l’a jamais pardonné. Voilà pourquoi je suis toujours resté un zéro tout rond, un gibier de potence». Et dans L’Institut Benjamanta, le plus magique de ses romans - qu’il dit préférer d’ailleurs aux autres pour sa «fantaisie poétique» -, son double romanesque dira exactement la même chose. Mais Walser ne se flatte pas pour autant d’avoir été «une sorte de vagabond», n’écrivant jamais pour séduire le public et se «fichant du beau monde», buvant énormément durant ses années berlinoises et se rendant «assez impossible» au lieu d’imiter un auteur adulé à la Hermann Hesse.
Or le paradoxe est que c’est ce personnage d’inadapté qui lui a valu de devenir un «auteur culte» après sa mort – une figure clinquante qu’il aurait détestée -, du genre «perdant magnifique» complaisamment célébré par la jeunesse occidentale des années 60-80, alors qu’il estime que «rien de grand ni de durable n’est jamais sorti d’une existence vagabonde» et défend les petits-bourgeois en lesquels il voit les gardiens de la civilisation.
Les anarchistes de salon, ou les «fans» d’un Walser «rebelle» bondiront à la découverte de réflexions qui n’ont rien de «réactionnaire» pour autant: «Même si sa stupidité peut parfois énerver, le petit-bourgeois n’est pas pour autant, tant s’en faut, aussi insupportable que l’homme de lettres qui croit qu’il est de son devoir de donner des leçons de morale au monde entier»…
A préciser, enfin, que les Promenades avec Robert Walser ne sont pas forcément la meilleure introduction à l’œuvre de celui-ci, mais en constituent un complément inappréciable, auquel la postface d’un triumvir (Lukas Gloor, Reto Sorg et Peter Utz) ajoute des informations inédites révélatrices, notamment sur l’ambivalence de la prise en charge littéraire de Walser par Seelig, à la fois louable et abusive après la mort de l’écrivain, tant il est vrai qu’à l’inverse de Max Brod «sauvant» l’œuvre de Kafka contre la volonté de celui-ci, Carl Seelig a failli détruire les inédits de Walser qu’il s’était pour ainsi dire appropriés…
Walser renard, et Keller hérisson
La coïncidence de la parution des Promenades avec Robert Walser et des dix nouvelles réunies dans Les Gens de Seldwyla de Gottfried Keller offre une sorte de «multipack» suisse aux résonances multiples qu’il m’a paru intéressant de signaler ensemble à la lectrice et au lecteur.
L’essayiste anglais Isaiah Berlin faisait une distinction, valable pour les écrivains et les artistes autant que pour les savants (ainsi que le souligne le physicien Freeman Dyson) entre hérissons et renards. Les premiers, tout concentrés, «creusent» leur œuvre sur place, tels un Ramuz ou un Gottfried Keller, précisément; et les seconds, tels un Cingria, un Bouvier ou un Walser, grappillent avant de revenir au terrier avec leur prise.
Cela étant, le hérisson Keller a pas mal de points communs avec le renard Walser, à commencer par une «suissitude» à la fois centrale et périphérique, ou plus précisément un solide ancrage dans le «village» populaire, la nature et les usages d’une humanité vue d’un œil à la fois très réaliste et très sensible à la féerie.
Je ne parlerai ici que de la première des nouvelles de cette nouvelle édition complète des Gens de Seldwyla – intitulée Pancrace le boudeur et très walsérienne de tournure mais avec une verve «flamande» propre à Keller: l’histoire d’un garçon terriblement bougon foutant le camp de son trou de province pour courir les monde, comme tant de Suisses migrants, et revenant au pays avec la peau du lion qu’il a héroïquement affronté et occis…
En 1952, le grand passeur que fut Walter Weideli présentait un choix de nouvelles tirées des Gens de Seldwyla, traduit en bon français un peu lisse par Charly Clerc sous le titre de Trois justes, dans une préface qui situait bien l’œuvre de Gottfried Keller dans l’histoire politique et sociale de notre pays, en ces termes immédiatement sympathiques : «Nous sommes entre amis et il fait bon se trouver plusieurs à aimer les mêmes choses», avant de préciser que «si un poète nous parle plus précisément de notre pays et de nous-mêmes, gens de ce pays, de nos mœurs, de nos désirs et de nos limites, nous l’écoutons avec une attention toute particulière, je dirais presque avec reconnaissance».
Et de conclure comme on n’ose plus le faire aujourd’hui. «Je vous souhaite d’aimer Gottfried Keller». Ce qui vaut évidemment pour Robert Walser dont le même Weideli avait admirablement ressaisi le ton et la touche de l’écriture dans sa traduction de L’Homme à tout faire, peut-être la meilleure introduction à l’univers walsérien où se découvre bel et bien cette fameuse Suisse qui-n’existe-pas…

Carl Seelig, «Promenades avec Robert Walser», traduit par Marion Graf. Editions Zoé, 221 pages.

Robert Walser, «L'homme à tout faire», traduit par Walter Weideli. L’Âge d’Homme, Poche Suisse, 282 pages.




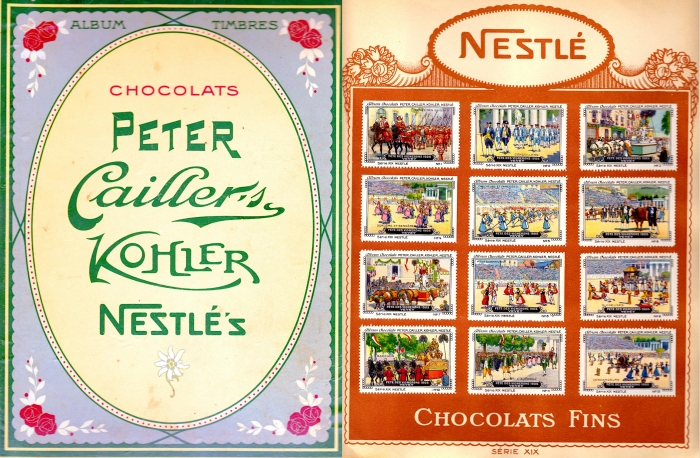

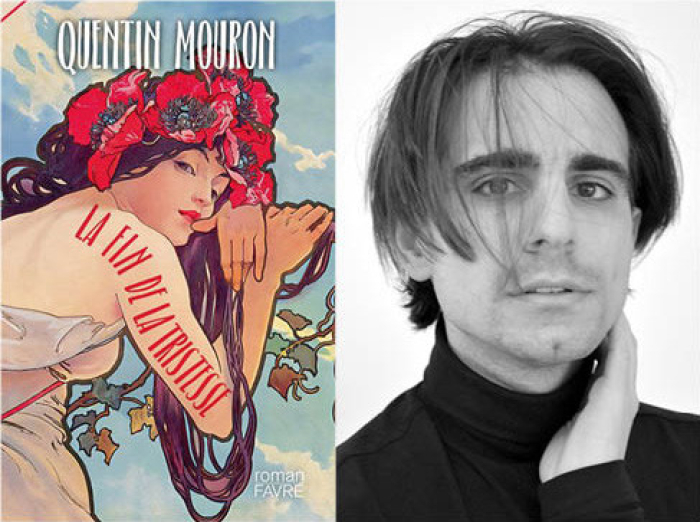
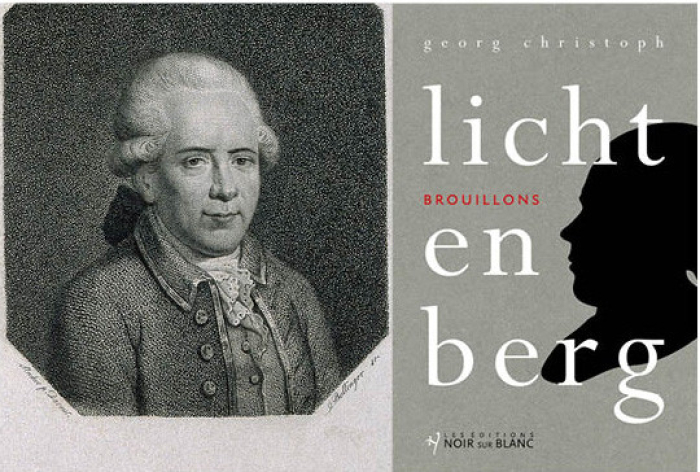
VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
1 Commentaire
@Michel Rossinelli 07.07.2021 | 00h18
«Merci à Jean-Louis Kuffer pour cette irrésistible invitation à la lecture de Gottfried Keller et de Robert Walser en ses promenades et en ses oeuvres !»