Culture / Miguel Bonnefoy enlumine la légende vécue des siens
Fabuleuse reconnaissance en filiation, «Le rêve du jaguar», dernier roman du jeune Franco-Vénézuélien déjà couvert de prix, est à la fois un grand roman familial à la Garcia Marquez (ou à la Cendrars) et un cadeau princier à la langue française, dont l’écriture chatoie de mille feux poétiques accordés à mille histoires d’amour. A lire illico presto!
Un bonheur de lecture à peu près sans pareil de nos jours marque la découverte du dernier roman de Miguel Bonnefoy, intitulé Le Rêve du jaguar et gratifié l’automne passé de deux grands prix littéraires, lesquels s’ajoutent à ceux qui ont marqué la reconnaissance immédiate de ses ouvrages précédents. A ceux-là, nul doute que vous reviendrez fissa si vous les avez loupés jusque-là, comme c’est le pendable cas du soussigné. On en veut plus! en attendant le probable chef-d’œuvre à venir, car ce gars-là, se dit-on en pariant sur l’avenir (comme lui d’ailleurs le reconnaît avec modestie dans ses interviouves) a l’étoffe d’un grand écrivain.
Dès les premières pages, ainsi, de ce roman à la fois picaresque et poétique, son jaguar nous prend par la gueule et ne nous lâchera pas avant le dernier paragraphe de la saga nous ramenant au premier, sur le parvis d’une église dédiée à San Antonio où une mendiante muette au prénom de Teresa découvre un nouveau-né enveloppé dans un lange contenant, comme un premier message de repentance et de recours à un possible amour à venir, une petite rouleuse à cigarettes de métal argenté aux jolies gravures…
Mais où nous emmène donc ce galopant galopiau avec son début de feuilleton à la Dickens? Où l’auteur a-t-il déniché l’histoire de ce gosse mendiant à deux ans, apprenant tôt à se défendre et dont nous savons déjà qu’il aura plus tard en ces lieux une rue à son nom, d’abord mal aimé par sa mère d’adoption qui l’armera pourtant mieux qu’aucune autre contre les aléas de la vie, lui offrira son premier cadeau (la petite machine à se rouler des cibiches) et son premier conseil après un vol de pirogue commis à ses dix ans: ne vole pas alors que tu as des ailes pour devenir quelqu’un – travaille!
Quand les clichés et le kitsch valdinguent…
Vais-je pécher par «spoiling» en dévoilant ici, avec plus de détails, la «story» d’Antonio Borjas Romero, premier grand personnage du Rêve du jaguar? Se poser la question revient à penser que «raconter l’histoire» suffirait à la gâcher en lui ôtant l’effet de surprise. Or la surprise de la vraie littérature est-elle là? Le «pitch» d’un roman, ou le résumé plus étoffé de ses épisodes, suffisent-ils à en rendre compte? Essayez donc de proposer le «scénar» de ce roman à ChatGPT et vous verrez le résultat…
Or, si l’on pourrait dire que tous les ingrédients d’un feuilleton à stéréotypes et clichés «téléphonés» sont réunis a priori dans l’histoire du petit Antonio, nous savons (par Youtube) que le grand-père de Miguel Bonnefoy, cardiologue et chirurgien illustre, fait pratiquement partie du domaine public vénézuélien, l’extraordinaire personnage offert sur un plateau à son petit-fils plumitif ayant déjà fait l’objet de deux bios documentées.
Est-ce dire alors que cette histoire relève d’une resucée opportuniste? Et s’agissant de la non moins fascinante moitié d’Antonio, Ana Maria Rodriguez, devenue première femme médecin de sa région, en quoi relève-t-elle de la littérature et pas du documentaire journalistique à nuance féministe?
Toute la question de l’alchimie romanesque est là, et sans celle-ci, «raconter l’histoire» d’Antonio et d’Ana Maria, puis de leur fille Venezuela et de leur petit-fils Cristobal (double narratif de l’auteur) aurait pu se limiter à de la romance au goût du jour comme il en ruisselle sur Netflix et consorts.
A ce propos, comme j’aurai regardé les huit premiers épisodes de la série colombienne tirée de Cent ans de solitude qui vient d’être programmée sur la plateforme en question en même temps que je lisais Le Rêve du jaguar, je n’ai pu m’empêcher de me demander ce qu’elle ajoutait au roman, ou ce qui lui manquait pour l’égaler; et à l’inverse, ce qui fait du roman de Miguel Bonnefoy bien plus qu’un canevas de série télé…
Pour en revenir au Rêve du jaguar, il faudrait à vrai dire, idéalement, «oublier» que sa base est fondée sur des «faits réels», et lire le roman comme nous avons lu L’île au trésor dans l’enchantement de nos lectures d’enfance ou de jeunesse, en toute innocence, comme les livres dont le jeune Cristobal va lui-même se gaver avec passion.
Reste à préciser encore, en quelques mots, ce qui fait valdinguer les stéréotypes de genre et les clichés dans ce roman dont l’auteur ose évoquer la scène de son jeune protagoniste installé sur un tabouret, dans une gare routière surpeuplée, et priant les passants de lui raconter la plus belle histoire d’amour qu’ils connaissent, pour en remplir un carnet qu’il offrira à son amoureuse – plus kitsch tu meurs? Mais pas du tout! Vous y croirez comme à la transformation du crapaud en prince dans les contes ou comme au miracle qui empêche Michel Strogoff de devenir aveugle, comme au Transsibérien de Cendrars qui répond, à l’impudent lui demandant s’il l’a vraiment pris: que t’importe, si mon poème te l’a fait prendre!
Car tout est là: les mots de Michel Bonnefoy, ou plus exactement son art de trouver un mot pour un autre (règle des trouvères), son véritable génie de la formule, de la métaphore inattendue, et la beauté sidérante qui se dégage de ses phrases. Et sous les mots, le sens, le savoir et la saveur qui en est le fruit. Tout au long du roman, sans trace de pédantisme, documentée mais mine de rien, la lecture du monde opérée par Miguel Bonnefoy en appelle à tous les sens, autant qu’à tous les «instituteurs» et tutrices de passage, conformément à la leçon d’Ana Maria à son petit-fils: ah bon, tu veux écrire? Mais «si tu veux devenir écrivain, écoute ceux qui ne le sont pas». Ce que le fiston a si bien entendu qu’il en tirera une mélodie rien qu’à lui…
Du cendrier à l’étoile, de l’individuel au collectif
Friedrich Dürrenmatt disait qu’il faut écrire «entre le cendrier et l’étoile», et c’est ce qu’on pourrait dire aussi de la position du romancier Bonnefoy, sensible également à «l’effet papillon» qui fait que des événements apparemment infimes peuvent déclencher des tornades.
Côté «cendrier», le romancier pratique un art constant du détail révélateur, qui caractérise les objets autant que les personnages de l’épique traversée de années et des lieux: du village-dépotoir lacustre à palafittes où pataugent les enfants nus (alors que des panneaux volés le long d’une route proclament «Pas de bonheur sans Chevrolet») à ce qui deviendra, au temps de la ruée vers l’or noir, la cité tentaculaire de Maracaibo; et pour les étoiles, il suffit de lever les yeux au ciel immense des Caraïbes dont les pluies diluviennes laissent sur les prés des myriades de perroquets morts tandis qu’affluent les langoustes comme les sauterelles de la Bible…
La plupart des personnages de ce roman sont hauts en couleurs, non moins qu’en douleurs, alors que le thème de la résilience marque les destinées personnelles d’Antonio et d’Ana Maria, pour la première des trois générations évoquées, et le transit des années va de pair avec celui de l’ascension sociale des protagonistes, jusqu’aux plus hautes sphères de la médecine, mais ni l’un ni l’autre ne seront des mandarins coupés de la vie des gens, au contraire: tous deux seront sympathisants des révoltes sociales marquant les décennies, dont l’instabilité est symbolisée par la succession de 32 constitutions…
Fils lui-même d’un ancien militant de l’extrême-gauche chilienne soumis à la torture sous Pinochet, Miguel Bonnefoy ne s’exprime jamais, dans Le Rêve du jaguar, en idéologue partisan, qu’il s’agisse de la cause des femmes (l’une de ses priorité manifestes) ou des révolutions successives, dont il tire un bilan où pèse lourdement la corruption des uns et des autres.
Qu’il évoque l’accession du jeune Antonio à la maturité sexuelle, dans la maison de passe au beau titre de Majestic, le retour subit de son père disparu dont il ne découvrira l’identité que bien plus tard, sa rencontre d’Ana Maria et leurs études communes, l’oncle avocat au soutien «sévère mais juste», la venue au monde de Venezuela et le refus de la jeune fille de suivre les traces prévues par les siens, rêvant de Paris avant de s’exiler en France, entre autres tribulations liées parfois aux soubresauts de la politique, le romancier parvient à concilier l’observation nuancée et sympathique de tous les personnages du premier plan, dans le mouvement général d’une société en mutation. Des pages particulièrement remarquables sont ainsi consacrées aux révoltes et aux réformes du monde agricole et à la succession des gâchis et autres avancées, sur fond d’instabilité chronique combien actuelle…
Le souffle d’une fable picaresque
Au demeurant, jamais le roman ne cesse d’être porté par une sorte de souffle de légende qui l’arrache à l’anecdote seulement sociale ou politique, sans se désincarner pour autant. Par-delà le probable «mentir vrai» du romancier jouant de malice inventive, la vérité poétique du romancier vaut sans doute celle des biographes «pour l’essentiel». Il y a là – sous l’effet d’une espèce de grâce unificatrice («Le poète est celui qui unifie», me disait un jour Pierre Jean Jouve), une fusion de l’affectif personnel et de la tendresse collective, de la conscience tragique et de l’élan vital des persévérants, de l’éthique religieuse quoique sans référence confessionnelle aucune, et de l’esthétique littéraire la plus poreuse et le plus généreuse, dans la filiation évidente du réalisme magique cher à Garcia Marquez – un vrai miracle que scelle finalement la musique tout à fait originale et combien prometteuse encore de Miguel Bonnefoy .

Miguel Bonnefoy. «Le Rêve du jaguar». Editions Rivages, 2024. 294p. Prix Femina et Grand Prix du roman de l’Académie française.




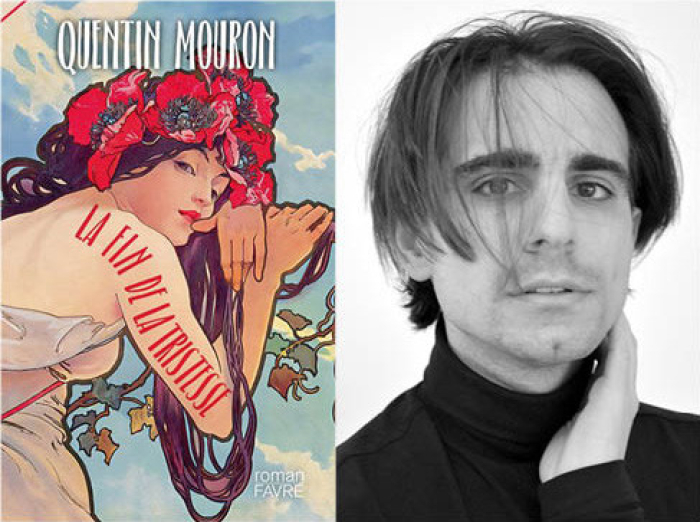
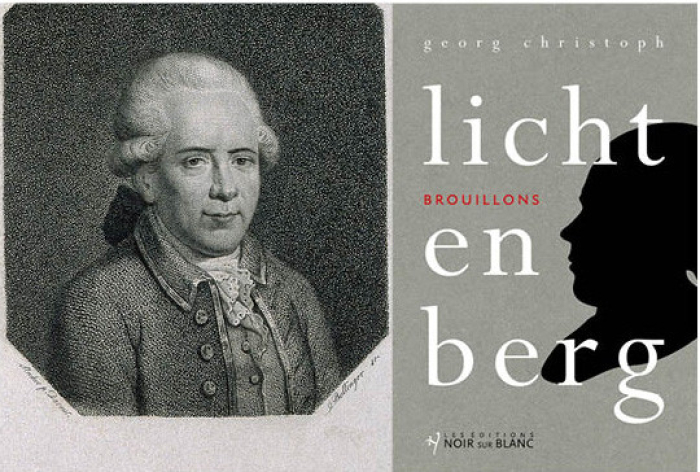

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire