Culture / Le beau roman qui ressaisit un accompagnement vital
Un voisinage banal que la maladie transforme en relation aussi profonde que superficielle en apparence: c’est la trame du nouveau livre de Catherine Lovey, intitulé «histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir» et gratifié du Prix Dentan 2024. Un roman-miroir qui nous renvoie à chaque page à nos vies et aux liens se tissant avec notre trop souvent lointain prochain.
Nous sommes entourés de gens auxquels rien ne semble devoir nous attacher, et pourtant nous nous attachons à eux sans trop savoir pourquoi, comme la narratrice de l’histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir s’attache à son voisin de palier, ce Monsieur Sándor à la fois présent et distant, apparemment consentant à tous les accommodements sociaux, pas vraiment sympathique au premier abord quoique courtois, platement ouvert au monde en sa situation de conseiller financier voyageant beaucoup même en temps de pandémie et qui, en sa qualité de personnage de roman, nous intrigue et nous attire à notre tour, lecteurs, par les surprises constantes qu’il nous ménage autant qu’à la narratrice.
De celle-ci, nous ne saurons pas grand-chose, sinon par ce qu’elle raconte de cet homme dont elle apprend bientôt qu’il est d’origine hongroise, que son expérience juvénile du communisme l’a blindé contre certaines illusions «idéalistes» et autres mensonges de l’idéologie «politiquement correcte», mais on verra que rien n’est vraiment si convenu que ça chez lui, pas plus que chez la narratrice dont les préjugés plutôt progressistes n’excluent pas une plasticité d’adaptation relevant de l’empathie, voire d’une croissante affection dont on ne saurait dire qu’elle relève de la pitié inspirée par le délabrement physique et l’affaiblissement réel de celui-là même qui, crânement, voudrait faire comme si de rien n'était.
Comme une sismographie romanesque
De quoi parle exactement l’histoire de l’homme qui ne voulait pas mourir, qu’introduisent deux exergues éclairants: le premier tiré du mémorable Journal de l’auteur hongrois Sándor Márai, et l’autre d’une des plus belles nouvelles de Tolstoï, La Mort d’Ivan Illitch?
De notre façon de réagir à l’annonce de notre disparition prochaine, telle que la vit, entre panique et compulsion, fuite et confrontation, ledit Ivan Illitch? Certes, mais d’une autre façon, qui serait celle d’un Monsieur bien sous tous rapports confiant en la médecine actuelle et semblant d’abord «dans le déni», comme on dit, «positivant» et restant très actif «dans sa partie», faisant en somme «avec» en toute dignité virile, du moins en apparence.
Comme beaucoup de nos contemporains, ce Monsieur Sándor a l’air d’être au courant de ce qui lui arrive et sait à quoi riment les thérapies successives qui lui sont proposées – Internet fait de nous tous des semblants d’experts –, collaborant plus ou moins avec les jeunes médecins forcément compétents – rassurons-nous – qui le «gèrent», mais l’aspect médical du récit est à vrai dire très secondaire en dépit de relevés précis, et c’est essentiellement par la narratrice que nous en sommes informés.
Du vrai sujet de l’histoire de l’homme qui ne voulait pas mourir, qu’on pourrait dire la part secrète ou mystérieuse des relations humaines en interaction, l’exergue de Sándor Márai, tiré du Journal de 1946, donne alors une idée plus juste: «C’est terriblement difficile de connaître la vérité sur nous-même; sur notre nature, nos tendances, nos désirs. C’est quasi impossible. A ce propos règne une brume abyssale et dense que le rayonnement de l’intelligence ne réussit pas à percer».
Et pourtant, c’est bien à relever le défi de cette «impossibilité» présumée, c’est à dissiper un peu de cette «brume abyssale» que s’emploie Catherine Lovey avec autant de tact que de pénétration sensible, sans jamais quitter le socle solide de la réalité. Son roman est ainsi pleinement incarné, ses situations explicites et symboliques sans lourdeur, ses personnages de plus en plus précisément silhouettés. Il y a quelque chose de l’objectivité réaliste d’une Alice Rivaz dans sa façon de camper la narratrice, femme autonome d’aujourd’hui dont la propre fragilité s’affermit à mesure que celle de son voisin le rend plus dépendant à son corps défendant, mais la «brume», l’ambigüité, l’incertitude, les flottements, parfois un malentendu, de soudaines surprises, une constante réserve de part et d’autre et son dépassement, le dévoilement lié à l’accompagnement physique concret, constituent la substance vive, à la fois émouvante et subtilement éclairée par l’intelligence du cœur – Sándor Márai serait le premier à reconnaître le pouvoir de celle-ci –, de ce roman illustrant une relation « itale» en train de se tisser.
Les «personnes vitales» qui nous accompagnent
Il est dit de Monsieur Sándor qu’il n’est pas sentimental, et Thomas Bernhard ne l’était pas du tout non plus. Mais c’est bel et bien à celui-ci que j’ai pensé, et à la notion de «personne vitale» qu’il a introduite dans ses récits autobiographiques, concernant plus précisément le grand-père du grand écrivain autrichien, en lisant le chapitre de cette histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir évoquant la tante du protagoniste, avec laquelle celui-ci a entretenu ce qu’on peut dire une relation «vitale».
Définir celle-ci n’est pas possible mais chacune et chacun de nous devrait avoir sa «personne vitale», pas forcément modèle ou mentor, relevant de l’amour ou de l’affinité élective mais de façon peut-être secrète ou momentanée, comme ce Monsieur Sándor, après la mort de la sœur de sa mère, «reconnaît» l’importance dans sa vie de cette femme et comme, aussi, l’on constate que Sándor lui-même devient important pour la narratrice du roman, laquelle est traitée aussi comme une «personne vitale» à l’approche de la mort.
Dans Les révélations de la mort, le philosophe russe Léon Chestov a montré l’importance cruciale de la grande confrontation imposée au personnage de Tolstoï et au protagoniste du plus beau film d’Akira Kurosava, intitulé Vivre (Ikiru, 1952) et traitant le même sujet que La Mort d’Ivan Illitch. Pourtant c’est essentiellement «du côté de la vie» que Catherine Lovey développe son roman d’un accompagnement, où chacune et chacun reconnaîtra peut-être une «personne vitale» – ce qu’on appelle parfois un ange gardien, ou ce voisin qui deviendra peut-être «une sorte de proche important»…
Attention: vos heures sont comptées
Il y a de quoi pleurer, c’est sûr, à voir quelqu’un qu’on aime en prise avec une maladie aussi sournoise que le cancer – entre autres cadeaux empoisonnés de la vie –, et surtout si la personne fait mine de s’accrocher en planifiant, par exemple, comme ce Monsieur Sándor, un voyage en Australie dont il est rapatrié en catastrophe, ou bien la personne vous cache qu’elle ne peut plus ingurgiter même un bol de soupe ou elle vous tombe dans les bras en essayant de se lever.
Vous avez lu Mars de Fritz Zorn (un premier coup pour le cancer), avant Une cuillerée de bleu d’Anne Cuneo, vous avec lu Le Protocole compassionnel d’Hervé Guibert (et de deux pour le sida), vous avez lu plus récemment La mort seul à seul du Hongrois Péter Nádas (l’infarctus comme si vous y étiez), et chaque fois c’est vu «du dedans» par l’intéressé, alors que cette histoire de l’homme qui ne voulait pas mourir est celle aussi «du dehors», des accompagnants: celle qui raconte et deux ou trois amies gravitant solidairement autour du malade en même temps que la narratrice, écoresponsable sur les bords, s’inquiète avec quelques militants du sort d’un bosquet d’arbres citadins en voie d’éradication intempestive (les lois de l’immobilier sont une autre maladie), et c’est de l’état du monde que parle donc aussi ce roman qu’on pourrait dire un récit des temps de la pandémie, qui vous tend son miroir.
Arriverez bout au bout de la journée, verrez-vous le prochain Noël ou les couleurs de l’automne de l’année suivante? Aurez-vous autour de vous des parents et enfants, des amis, des amantes ou des amants qui vous passeront des morceaux de jazz avant votre «dernier repas» évoqué par l’abbé Brel, et faites-vous assez attention aux modulations quotidiennes du carpe diem, à la beauté des choses d’ici-bas où tout n’est pas Gaza, ou à ce que murmurent les arbres du bosquet d’à côté?
Voilà ce qu’en somme vous raconte, par le truchement d’un petit livre aux grandes largeurs de rêverie grave et légère à la fois, cette histoire de l’homme qui ne voulait pas mourir offerte aux vivants…





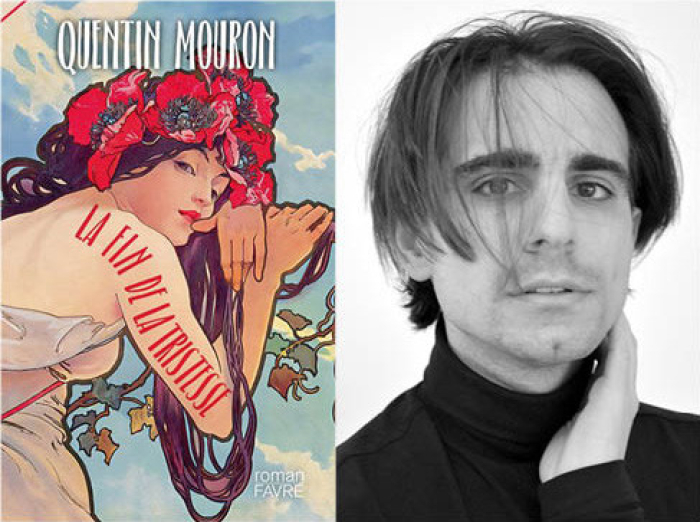
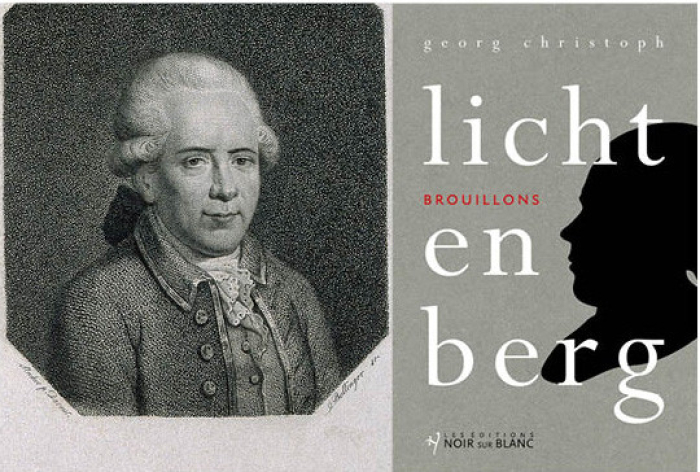

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire