Culture / Le petit pays où le temps s’arrêta
Dans son premier roman, enfin traduit en français, le romancier biélorusse Sacha Filipenko met en scène l’état comateux de son pays, piégé dans une faille temporelle par un président autocrate et nostalgique de l’URSS. Ecrit en 2016, «Un fils perdu» était alors un cri d’alarme. A la lumière de ces deux dernières années, c’est désormais un appel tristement actuel et teinté de désespoir contre la résignation politique, et un hymne tendre à la société civile.
Les lecteurs familiers de la littérature en temps troublés connaissent la méthode: un récit politique et social en forme de fable pour dénoncer sans le dire, et aussi pour inscrire l’universalité de la lutte pour la liberté d’expression bien au-delà des frontières. Nous avons déjà évoqué ici les bestiaires (Le Pingouin et Les Pingouins n’ont jamais froid d’Andreï Kourkov, on notera aussi Les Cobayes, du Tchèque Ludvík Vaculík et La Guerre des Salamandres de Karel Čapek...).
Le roman du Biélorusse Sacha Filipenko, né quelques années avant la dislocation de l’URSS, a deux particularités: la métaphore filée est ici médicale; et il est paru en 2016, autant dire dans le monde plus ou moins libre de l’après-guerre froide.
Œuvre d’histoire? Non... Dans son préambule à la traduction française d’Un fils perdu, publiée cette année, le romancier l’affirme: son seul souhait, que son récit cesse enfin d’être d’actualité.
Sacha Filipenko, en décrivant l’inertie autocratique de son pays, la Biélorussie, n’a pas fait preuve non plus d’un talent de visionnaire. Il a traduit en mots et en fiction la réalité du «petit voisin» de la Russie, bloqué dans une faille temporelle depuis son indépendance, au début des années 1990. L’histoire de Francysk, le protagoniste, est fictive; le pays et la temporalité statufiée dans lesquels elle s’inscrit sont bien réels, le sont toujours. Il fallut les événements de 2020, d’énièmes élections truquées et des manifestations monstres dans tout le pays, réprimées dans le sang, puis un statu-quo de terreur, pour que l’Europe entrouvre seulement les yeux.
Goodbye, Lenin! sans subterfuge
Le récit débute en 1999. Francysk a seize ans, une petite amie, des copains de lycée, il étudie la musique et s’inquiète de ne pas être reçu à son examen final. Alors qu’il se rend à un concert en plein air pour fêter la fin d’année, une averse éclate. Un mouvement de foule, une dantesque bousculade, se déclenche dans un tunnel du métro où tout le monde se réfugie et se retrouve piégé par les grilles restées closes. «Des milliers de personnes se ruaient droit sur lui. Du sud, du nord, de la droite, de la gauche. Comme si tous les oiseaux migrateurs du monde venaient se rassembler là.» Cette scène, tout en chairs et en os écrabouillés, saisissante, est digne d’un tableau de Jérôme Bosch, et scinde le roman en deux. «Chaque fois c’était le même son étouffé, caractéristique: comme une bulle de cellophane qu’on eût crevée.» Francysk tombe dans un profond coma, des centaines de personnes sont tuées. Le journal expliquera que «la cause de la catastrophe est une pluie violente... ayant éclaté au mauvais moment...»
Le sommeil de Francysk durera dix ans et occupe la majeure partie du roman, un roman du coma et de l’immobilisme qui pourtant est porté par une écriture pleine de souffle, de soubresauts et de délicatesses. «(...) la chambre s’emplissait d’air frais. Celui d’une ville tombée dans le coma quelque temps avant Francysk. Celui d’une ville dont l’unique véritable attraction touristique était un ciel d’une couleur totalement singulière.»
Dans cette ville, dans ce pays tombés dans le coma, où toute voix dissidente est peu à peu et de plus en plus violemment forcée au silence, la figure de la résistance est incarnée par Elvira Alexandrovna, la grand-mère de Francysk, qui ne quittera pas son chevet. Sacha Filipenko renvoie la révolte contre la fatalité à la sphère privée, intime et familiale, puisqu’elle se trouve éliminée de l’espace public.
Son copain de lycée, Stass, rend visite à Francysk et profite du huis-clos de la chambre d’hôpital pour parler franchement: «Tout le pays roupille, alors toi aussi, pionce tranquillement! On n’a jamais connu une telle vie de merde.» Une franchise aussitôt réduite au silence par peur qu’on l’ait entendue...
Il faut nous imaginer, lecteurs, plonger dans un coma de dix ans, et se réveiller sans que rien n’ait changé dans notre pays, dans notre ville, dans notre gouvernement, dans notre quotidien, si ce n’est une ou deux avancées technologiques. C’est ce qu’essaie de faire comprendre Stass à son camarade, incrédule à l’idée d’avoir dormi si longtemps. Ce n’est pas possible, la photographie du président qui trône dans sa chambre est toujours la même...
«En fait, pendant que tu roupillais ici, tout a un peu changé. Pas beaucoup. "Un peu", c’est le meilleur terme. Car, en revanche, énormément de choses de notre enfance sont revenues! Alors, la vie a un peu changé. Rien de radical, mais tout de même.»; «On joue tous du même pipeau. Le grand orchestre d’un petit pays.»
Stass lui fait le tableau de la dictature biélorusse, millésime 2006: «Plus Stass parlait, et moins Francysk comprenait. Mauvais plan. Sans doute valait-il mieux sortir du coma à l’Ouest. Dans un petit pays où tout est limpide et sensé. Où les événements correspondent à la logique et au cours éternel des choses. Ce que racontait Stass était impossible à admettre, impossible à comprendre.»
Impossible de ne pas songer à Goodbye, Lenin!, le miroir inversé de cette histoire: dans le film de Wolfgang Becker, un fils veut cacher à sa mère, sortie elle aussi du coma, la chute du Mur et la fin de la RDA. Ici, nul besoin de subterfuges. Le Bloc de l’Est s’est effondré, la Biélorussie est devenue indépendante... sur le papier. En réalité, le pays fait des bonds dans le passé, il a, pour paraphraser la célèbre formule, changé pour que rien ne change.
Le grand frère et la fosse à purin
L’indépendance de son pays, c’est justement ce que questionne Sacha Filipenko. Question brûlante à la lumière récente et crue des élections biélorusses de 2020, et de l’invasion de l’Ukraine, autre «petit frère», par la Russie.
Le nom de la ville où est plantée la narration, et celui du président, ne sont pas écrits noir sur blanc. Cela donne au récit une valeur universelle qui porte, au-delà des frontières biélorusses, à tous les pays de l’ex-URSS aujourd’hui encore inféodés à Moscou (ou que Moscou tente de ramener à elle). Ici et là affleurent d’ironiques comparaisons Est/Ouest, dignes, encore une fois, de la période de la guerre froide. «Les films occidentaux» sont le référentiel adopté pour juger d’un lieu ou d’une situation. On entend plusieurs personnages songer que «dans les films de l’Ouest, ce n’était pas comme ça...».
Mais hors de ces incursions occidentales dans l’imaginaire populaire, la Biélorussie est tout entière et uniquement tournée vers «le grand voisin», qui lui impose sa langue, sa politique, son statut de vassal, la Russie.
En témoigne un autre emportement de l’ami Stass: «Pour nos grands frères, en fait, nous ne sommes pas un peuple, mais une fosse à purin entre eux et leurs voisins. L’important, c’est qu’on n’entre pas dans l’Union européenne, l’important c’est que les armées occidentales, grand Dieu, ne stationnent pas près de leurs frontières. La politique est une affaire importante! Il faut s’y montrer attentif et prudent! Ils sont forcés de se montrer tellement attentifs et prudents que, juste pour s’assurer une sécurité illusoire, ils sont capables de transformer le pays voisin en avant-poste. Ils soutiennent une dictature, et alors! Qu’est-ce que ça peut foutre?»
Et qu’est-ce que ça peut foutre, que de jeunes romanciers portent la voix, dans toute l’Europe, de ces «fils perdus» pour leur pays et pour leurs familles, exilés, emprisonnés, abattus? «Ce livre, au fond, est une encyclopédie des prétextes, un dictionnaire des motifs qui poussent les Biélorusses à quitter leurs maisons natales», écrit Sacha Filipenko dans son avant-propos.
Couronné par le prix Rousskaïa Premia, le roman a été la cible d’une vive censure: «La critique s’est abattue sur moi, dont le principal grief tenait en quelques mots: ça n’existe pas. (...) Quant à la Bibliothèque nationale de la république de Biélorussie, il lui a été recommandé instamment de ne pas enrichir ses fonds avec Un fils perdu.»
2006 en fiction, 2016 au temps de l’écriture, 2020 à l’heure de la révolte, ou 2022, quand menace le rendormissement forcé, la Biélorussie gravite toujours dans l’orbite serrée de la Russie, et s’enlise, jour identique après jour, dans l’ornière temporelle. Pour combien de temps, encore?
«L’année s’achevait en cartes postales envoyées aux prisonniers et en nouvelles sanctions adoptées par le continent contre le président réélu. La situation se stabilisait. La poussière retombait à sa place.»
Un coma irréversible comme celui de Francysk, aboutit, une fois sur des millions, à un miracle.





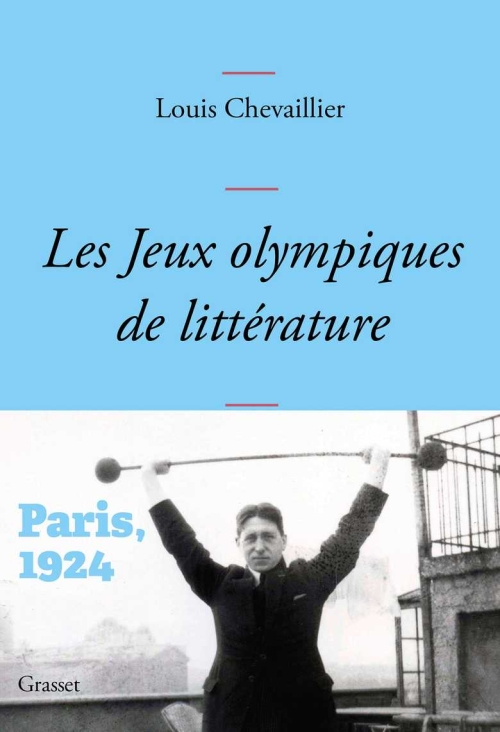



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire