Actuel / «On est beaucoup plus égalitaires aujourd'hui qu'au siècle dernier»
Dans un pays riche où on a tendance à oublier que la pauvreté affecte, aujourd’hui encore, plus d’un habitant sur dix, Anne Bottani met en scène des femmes de différentes époques presque toutes issues de milieux très modestes. Des femmes qui cherchent à investir leur infime marge de liberté. Dans son recueil paru aux éditions de l’Aire en 2018 sous le titre «Désirs et servitudes», l’auteure dépeint ses héroïnes à travers une écriture dont la simplicité, le dépouillement et la justesse correspondent parfaitement à l’esprit de ses personnages. Avec un goût certain pour les petites et grandes transgressions jubilatoires.
 Anne Bottani © DR
Anne Bottani © DR
BPLT: L’entourage social pourrait apporter un soutien dans des situations difficiles. Or, dans plusieurs de vos histoires, il ne fait au contraire qu’aggraver la détresse de celle qui s’est écartée des normes très rigides en lui jetant l’opprobre. Observez-vous encore cette absence de solidarité, cette manière d’enfoncer davantage ceux qui sont déjà en difficulté, dans la Suisse d’aujourd’hui?
A.B: Et bien oui, quand on commence à avoir des problèmes de précarité, ça entraîne des conséquences en cascade. Les gens qui fréquentent par exemple des associations comme Français en jeu ou Lire et écrire ne connaissent même pas l’existence des offres culturelles gratuites telles que les Estivales, comme si une précarité en entraînait une autre. Dans mon livre, le principe à l’œuvre est celui du bouc émissaire. La société se sent plus forte en excluant les gens qui dévient de ses normes.
Vous ne précisez pas où se passent les histoires de votre recueil, mais on sent un fort ancrage rural et catholique. Vous êtes-vous inspirée du Valais?
Oui, parce que c’est de là que je viens, je me suis inspirée des histoires que ma grand-mère racontait. Quand elle était jeune, on en avait fini avec ces histoires de filles-mères qu’on met au ban de la société, mais on continuait à en parler comme si c’était actuel tellement on était marqué. Il y avait une double exclusion, par la société et par les parents, comme dans des sociétés musulmanes. Parce que la famille se sentait exclue de la société à cause du comportement de l’élément déviant.
Est-ce que le souci du qu’en dira-t-on imprègne fatalement la vie des villageois?
Oui, ma maman ne retournerait pour rien au monde au Val d’Anniviers tellement c’était horrible que chacun sache tout de tout le monde. Il y avait un côté négatif, le jugement porté sur les comportements déviants, mais aussi un côté positif, une forme d’implication, de souci de l’autre.
Avez-vous un exemple?
Ma grand-maman avait un accès privé à une fontaine. Les présidents de village lui ont demandé si elle acceptait de laisser d’autres gens y accéder. En échange, elle a reçu un robinet. Mais elle avait tellement honte de ce privilège qu’elle le cachait sous un chiffon.
Vous présentez les humbles comme des personnes plus honnêtes que les gens aisés. C’est ce que vous avez observé?
Au début, il y a des gens qui ont refusé l’AVS, parce qu’ils avaient le sentiment de ne pas mériter cet argent. Peut-être qu’il y a une méfiance par rapport à des décisions qui viennent d’en haut et qu’ils ne comprennent pas. Les plus riches considèrent qu’ils font partie de ceux qui ont droit aux privilèges. On avait une tante qui était fière d’avoir toujours bossé dans des grandes familles, comme si ça avait des retombées sur elle.
Vous décrivez un univers où les classes sociales sont très cloisonnées et où la pauvreté se transmet d’une génération à l’autre. Qu’est-ce qui pourrait faire office d’ascenseur social?
L’éducation. Ça a été le cas de mon père qui est devenu enseignant, puis inspecteur scolaire. Au milieu du vingtième siècle, les hommes qui avaient gravi l’échelle sociale ne supportaient pas l’idée que leur femme travaille. Mais les connaissances spécifiques confèrent aussi un statut social. Les paysannes du début du vingtième siècle étaient mieux considérées que leurs filles, parce qu’elles avaient des tâches et des compétences utiles. La génération suivante, née en 1930 ou 40, disposait d’aspirateurs, de frigos, du confort de base. Ces femmes avaient donc moins de boulot et un rôle moins important. Passer l’aspirateur demande peu de savoir-faire. Le statut social ne dépend pas seulement de ce qu’on gagne, mais aussi de l’importance accordée à une tâche. Les accoucheuses par exemple maîtrisaient les savoirs de la vie et de la mort. J’ai toujours eu le sentiment que ma grand-mère et les autres femmes du village dirigeaient les hommes. Elles tenaient les choses en main, déterminaient ce qu’il fallait faire, à quel moment.
Malgré la quête de transgressions commune à beaucoup de vos personnages, on est frappé par l’acceptation, la résignation face à l’ordre établi, même s’il est très injuste. Est-ce que cela fait partie de l’éducation, du conditionnement de cette classe sociale?
Je crois que les femmes étaient conditionnées comme dans les pays musulmans aujourd’hui. Il fallait aller à la messe, le curé notait qui était présent. Elles développaient des stratégies pour échapper à toutes ces contraintes.
Et le diktat de l’apparence, n’est-ce pas aussi une forme de conditionnement?
Quand on parle de mon livre, on relève le conditionnement lié au catholicisme parce qu’il paraît un peu exotique, mais le conditionnement de l’apparence est tellement fort, les images stéréotypes tellement envahissantes qu’on n’en a même plus conscience. La nouvelle dont l’héroïne se fait corriger les seins, puis les fesses m’a été inspirée par une copine de ma fille qui avait économisé pour se payer cette opération à l’âge de 18 ans. Les gens le font sans même avoir l’impression qu’on les influence. Pourtant c’est dangereux, ça coûte cher, ça rate souvent. Maintenant, on observe aussi un contre-courant.
Vous utilisez à dessein un vocabulaire très simple et dès qu’il y a un mot un peu moins courant, vous soulignez que l’héroïne n’en connait pas le sens. Peut-on considérer que vos personnages partent dans la vie avec un triple handicap, le manque de moyens économiques, le manque d’instruction et des carcans moraux très stricts?
Les carcans oui pour la plupart, le manque de moyen oui, le manque d’instruction, je n’en suis pas si sûre. Ça dépend de comment on définit l’instruction. À travers mes personnages, j’ai voulu rendre hommage au bon sens de ma mère, de ma grand-mère.
En quoi les femmes sont-elles plus affectées par la pauvreté que les hommes?
Si tu viens d’une famille pauvre, en tant que femme, tu bosses plus. Trois fois plus même si tu as épousé un alcoolique, comme ma grand-mère. Traditionnellement, l’homme travaillait la vigne, produisait du vin, avait une cave qui était un haut lieu de sociabilisation et buvait du vin. Si un homme était travailleur et qu’il ne buvait pas, cela suffisait à l’accepter comme mari. Ma grand-mère, interrogée par mon oncle sur sa vie sexuelle, affirmait n’avoir eu aucun plaisir; elle faisait son devoir pour assouvir les besoins d’un homme.
Plus on avance dans le temps, moins on perçoit le rang social des protagonistes. Pensez-vous que les écarts sociaux se soient atténués au cours des 170 dernières années?
Oui, clairement. Malgré les grandes disparités économiques, au niveau de l’accès à la culture, aux loisirs, au sport, on est beaucoup plus égalitaires.
Votre recueil comporte une seule nouvelle dont les protagonistes sont issus d’un milieu très aisé. Est-ce que la proportion, une histoire sur quatorze, correspond à la proportion de représentants de la haute bourgeoisie par rapport à la classe moyenne inférieure?
Je voulais montrer que les servitudes ne dépendent pas que du statut social. Le désir d’enfant est propre à beaucoup d’êtres humains.
D’où vous est venue l’idée de ce recueil?
J’ai commencé par écrire La marque rouge, histoire véridique de mon arrière-grand-mère qui s’est suicidée parce que sa fille ne voulait pas la prendre à la maison.





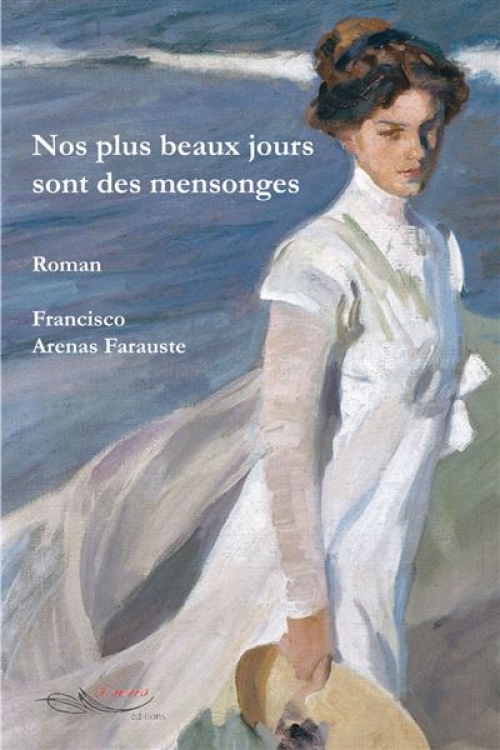



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire