Culture / L’Amérique de Trump risque-t-elle de comploter contre elle-même?
Une fiction historico-politique mémorable de Philip Roth, «Le complot contre l’Amérique», évoquant le flirt du héros national Charles Lindbergh, «présidentiable», avec le nazisme, et deux autres romans récents de Douglas Kennedy et Michael Connelly, incitent à une réflexion en phase avec l’actualité. Est-ce bien raisonnable?
Que peuvent les écrivains en temps de crise? Que nous disent les romanciers des temps que nous vivons? Qu’attendons-nous des poètes? La littérature n’est-elle que ce qu’on en dit avec le dédain du bourgeois ou du populo: «que de la littérature»? Que du divertissement à faire «cartonner» les auteurs vendeurs et à combler la lectrice et le lecteur en dociles moutons? Ce qu’on disait gravement de l’«engagement» dans les années 60-70 a-t-il encore le moindre sens? Et s’il en était d’autres formes, aujourd’hui, qui coupent court à toute idéologie pour affronter plus crânement «cela simplement qui est»?
Telles étaient les pompeuses questions qui me semblaient s’imposer en ce début d’année de «toutes les incertitudes», entre guerres et génocides, révolutions supposées ou avérées et recompositions évidentes, continuant de lire un tas de nouveaux livres captivants (et dire qu’il y en a pour prétendre que plus rien de bien ne se publie!), et notamment, à côté d’un extraordinaire roman de l’Américaine Joyce Carol Oates (86 balais dans son armoire magique), intitulé Boucher (Editions Philippe Rey, 2024) et consacré aux faits et méfaits d’un médecin gynéco-psychiatre aux effrayantes pratiques de bigot génial usant et abusant du «matériel» féminin, et du merveilleux dernier roman de Pascal Quignard, Trésor caché, poursuivant son immense rêverie poético-mélancolique: trois livres de trois autres romanciers américains ressortissants aux genres distincts quoique parents du thriller socio-politique (Michael Connelly), de la conjecture historique (Philip Roth) et de la dystopie d’anticipation (Douglas Kennedy ) invitant «par la bande» et en pleine pâte romanesque à s’interroger sur les liens de notre présent avec le passé proche et le futur point trop lointain…
L’inspecteur Bosch fait la nique à Trump…
Ladite réflexion pourrait s’amorcer avec un attentat qui aurait pu aboutir, en ce «lieu de rêve» que figure Malibu, à un massacre de masse perpétré, lors d’un jour de fête rassemblant les foules, par un activiste déjà fiché pour sa participation à l’attaque du Capitole, mais que le fameux inspecteur Bosch, tel Zorro, arrivant de justesse, aurait empêché – et ce haut fait serait donc survenu avant le retour au pouvoir de Donald Trump, dont on sait qu’il n’a eu de cesse d’amnistier les «patriotes» de la même espèce que le terroriste en question…
Or l’épisode, tiré du dernier roman paru de Michael Connelly, intitulé À qui sait attendre, trouve ces jours une nouvelle résonance en relation avec les prises de position et autres gestes provocateurs du nouveau Président et de son entourage – le fameux «salut nazi» de Musk l’agité – où certaine inquiétude paraît de mise; et ce n’est pas céder à une panique gratuite de «complotiste», alors même qu’un homme politique aussi riche d’expérience et responsable que Dominique de Villepin exprime bel et bien ladite inquiétude, que de relancer une réflexion sur les tentations extrémistes qui ont germé au sein de la démocratie américaine, ainsi que les a évoquées le grand romancier Philip Roth (1933-2018) dans son roman conjectural intitulé Le complot contre l’Amérique, paru en 2004 et qu’on devrait peut-être (re)découvrir…
Les leçons du passé…
Après la magistrale trilogie que forment Pastorale américaine, J’ai épousé un communiste et La Tache, Philip Roth se sera livré plus intimement, avec Le complot contre l’Amérique, par le détour paradoxal d’une saisissante fiction historico-politique qui voyait les Etats-Unis tomber sous la coupe d’un président pro-nazi en la personne de l’héroïque aviateur Charles Lindbergh…
Les plus grands romans tiennent souvent à un sentiment fondamental, ressenti par un individu avec une intensité particulière, et dont l’expression, enrichie par une somme d’observations nuancées, fait ensuite figure de vérité générale. Dès la première phrase, ainsi, du Complot contre l’Amérique, Philip Roth inscrit ce qui est à la fois le plus fictionnel et le plus directement autobiographique de ses romans (le narrateur se nommant Philip Roth), sous le signe de telle dominante émotionnelle: «C’est la peur qui préside à ces mémoires, une peur perpétuelle. Certes, il n’y a pas d’enfance sans terreurs, mais tout de même: aurais-je été aussi craintif si nous n’avions pas eu Lindbergh pour président, ou si je n’étais pas né dans une famille juive?»
À préciser aussitôt, cependant, que ce roman d’une narration toute calme et précise, ne tire aucun effet spectaculaire de cette peur d’enfant, qui reste le plus souvent latente, pour mieux ressurgir en certaines circonstances dramatiques. Du moins nourrit-elle certaines questions qu’on imagine l’enfant se poser avant de s’endormir: et si les vilains gestes, de rejet ou de mépris, que j’ai vu subir mes parents, si bons et si justes, se trouvaient soudain autorisés voire recommandés? Et si la haine entrevue ici et là se généralisait?
Or, en dépit de la fiction historique (dès la Convention républicaine de Philadelphie, en 1940, qui voit Lindbergh choisi pour candidat à la présidence) et de l’ancrage particulier des Roth (dans leur quartier juif de Newark désormais bien familier à ses lecteurs), de telles questions retentissent dans l’esprit et le cœur du lecteur de manière immédiate.
Et si la Suisse avait basculé dans le nazisme? Et si nos parents si bons et si justes avaient été antisémites? Pourquoi ne pas l’imaginer quand on lit, sous la plume de ce héros par excellence que figurait alors Charles Lindbergh, que l’Allemagne nazie menait, en 1939, «la seule politique cohérente en Europe», et que les Juifs, aux Etats-Unis, constituaient «le danger numéro un»?
Dans le très substantiel Post-scriptum du Complot contre l’Amérique, Philip Roth détaille les bases documentaires de son roman de pure fiction, qui éclairent notamment le conflit entre isolationnistes (Lindbergh entre autres, qui voyait en l’Allemagne un rempart contre le communisme) et antifascistes, et précise le rôle d’autres protagonistes, comme le journaliste Walter Winchell qui devient, dans le roman, le héraut de l’antifascisme fauteur, malgré lui, de véritables pogroms…
Reste que l’essentiel du roman n’est pas, finalement, de l’ordre de la politique-fiction: il réside bien plutôt dans sa base absolument réaliste et véridique, reprenant et développant, à partir d’une famille et d’une communauté dont l’auteur est devenu le barde, la vaste chronique de l’Amérique de la seconde moitié du 20e siècle à laquelle se voue Philip Roth avec autant de sérieux et de lucidité que de talent littéraire.
Quand l’autre Kennedy lit l’avenir…
S’il a déjà été question, sur votre média indocile préféré (cf l’édition du 8 novembre 2024) , du dernier essai «panoramique» de Douglas Kennedy, Ailleurs, chez moi, paru avant la réélection de Donald Trump et constituant une sorte de récit-reportage courant des débuts de la contre-culture des années 60 à la prise d’assaut du Capitole par les hordes «suprémacistes», c’est à son roman précédent qu’il faudrait aujourd’hui revenir, pour ainsi dire au «futur antérieur», avec son tableau des Etats désunis de 2045 scindés en deux entités antagonistes autant que les deux Corées: une Confédération bigote coercitive, dominée par douze apôtres punissant de mort toute hérésie, et une République numérique aux ordres de multimilliardaires verrouillant la sécurité intérieure par une autre forme d’inquisition, laïque mais non moins liberticide…
Est-ce cela qui menace aujourd’hui les States, ou l’écrivain a-t-il déliré en sa parano comparable à celle d’un Boualam Sansal peignant le diable islamiste sur la muraille de son redoutable 2084? Dans le dernier récit de Douglas Kennedy, celui-ci reste ouvert, au titre de l’amitié non encore pourrie par l’idéologie et ses partis pris, au dialogue avec tel pote considérant que Trump et ses partisans constituent l’avènement d’une nouvelle ploutocratie fascisante, et tel autre qui en attend un redressement pacifiste et providentiel – mais la dominante de sa vision d’artiste libre reste bel et bien plombée par l’inquiétude, alors que sa lucidité de veilleur, comme celle d’un Philip Roth ou, à sa façon, d’un Michael Connolly sondant la mémoire violente de son pays et la détresse des victimes, reste garante de l’honneur composite de ce journal de bord de l’humanité que représente la littérature…


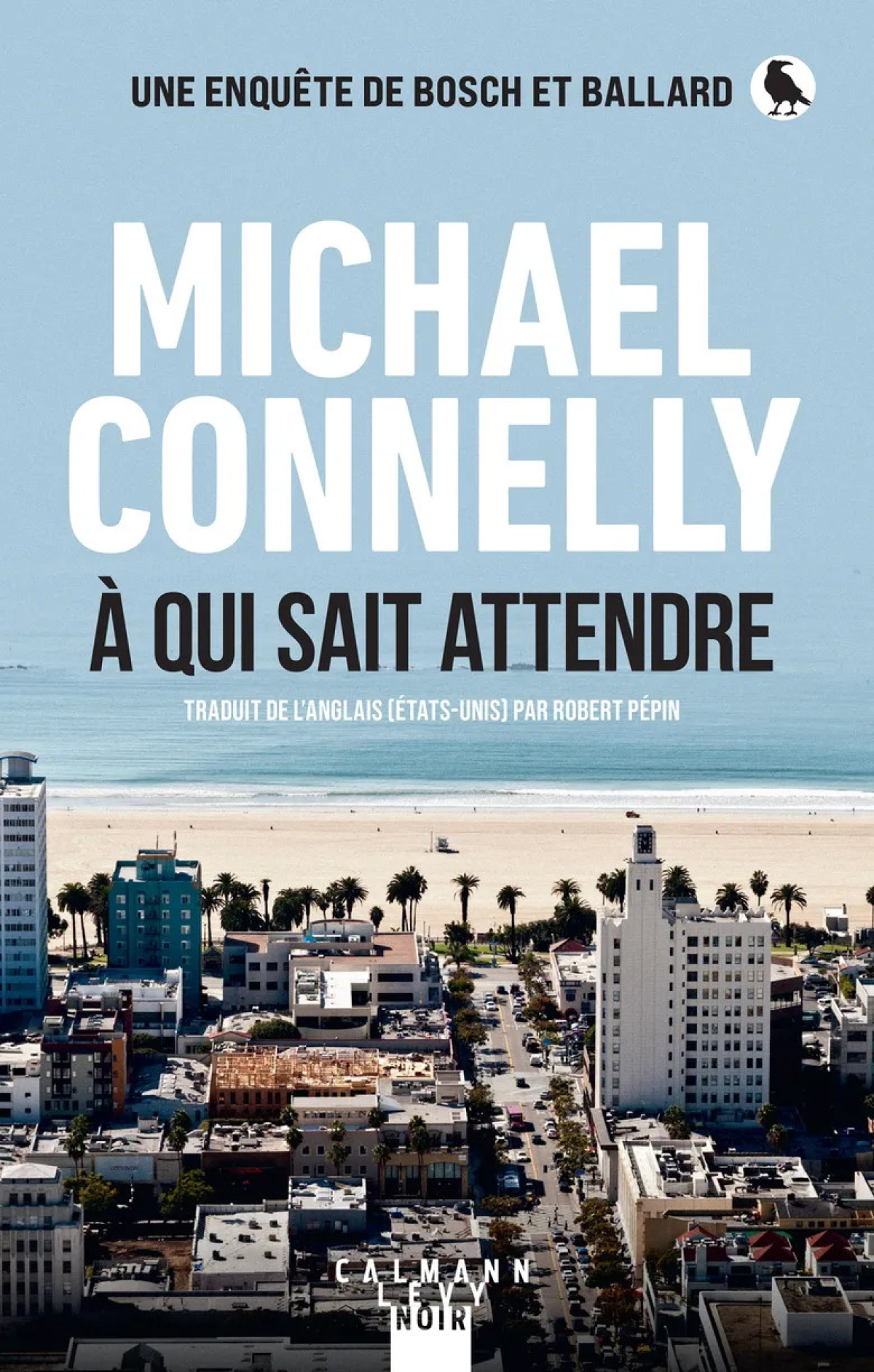

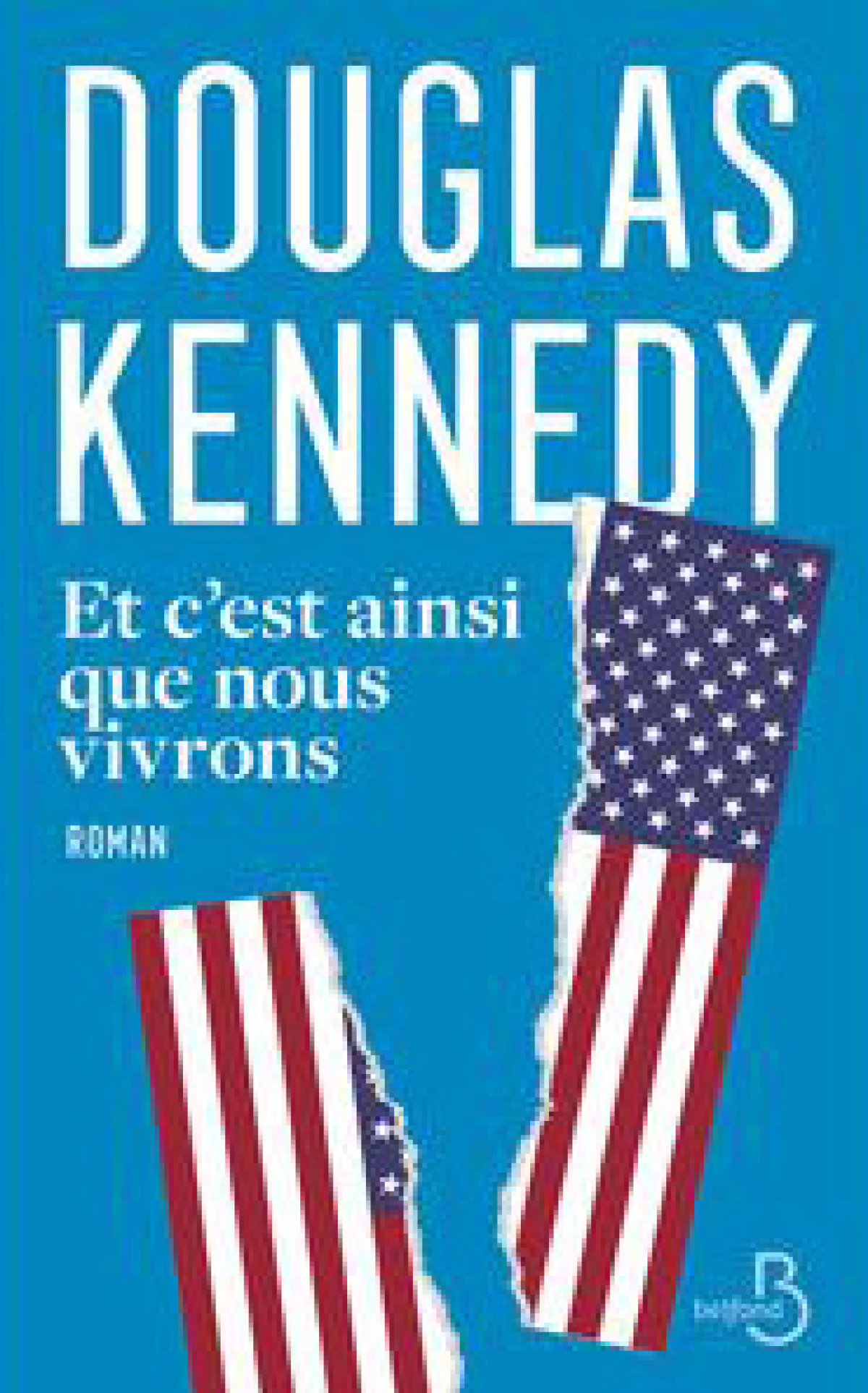

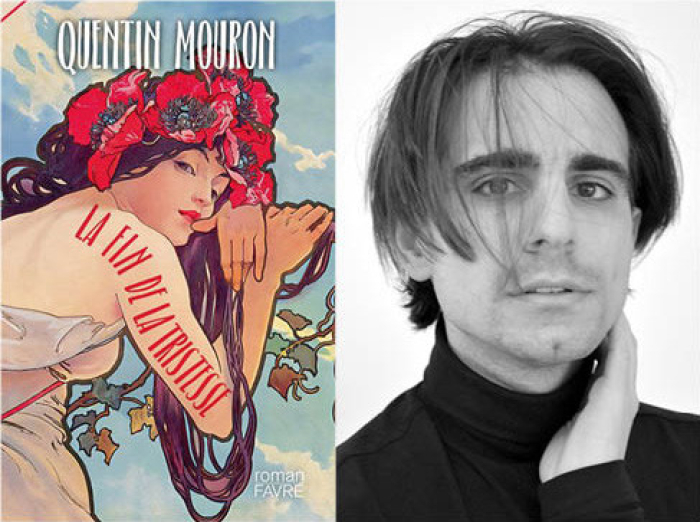
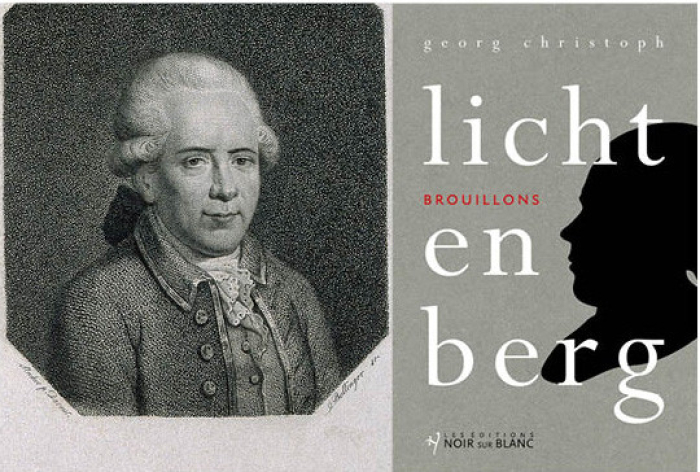
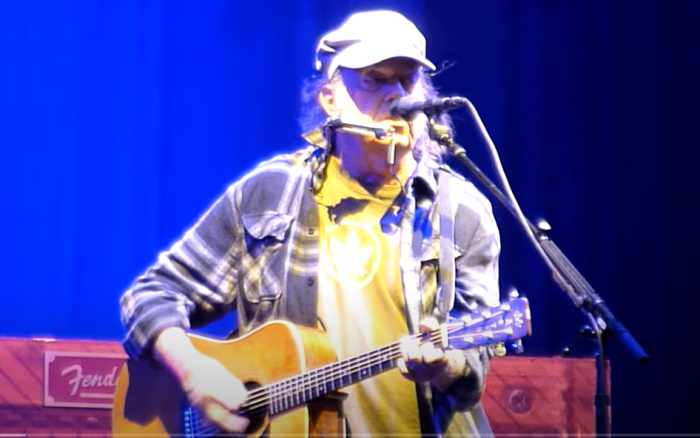

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire