Actuel / Sur le quai de la gare d'Irkoutsk, j'attends le train pour Oulan-Bator
Partir en train jusqu’en Chine est un rêve d’enfance que j’ai longtemps remis à plus tard. C’est la guerre entre l’Ukraine et la Russie. Peu m’importe, je pars. Je pars parce que nos rêves ne nous survivent pas, écrit l'artiste.
Etape 1: Sur le quai de la gare de Moutier, j’attends le train pour Pékin
Etape 2: Sur le quai de la gare de Moscou, j'attends le train pour Irkoutsk (en libre accès)
Vidéo à 360ᵒ: cliquez et baladez-vous dans la carte
Après plus de trois jours dans le transsibérien, je fais halte à Irkoutsk, capitale éponyme de cet oblast (canton) de Sibérie.
Je me rends au guichet pour acheter un billet vers Oulan-Bator. Mon train part dans trois jours.
Je sors de la gare, il fait étonnement chaud: -12°C. Je rêve de manger quelque-chose de consistant mais Maxime, pensant bien faire, m’a fait envoyer une voiture. Une heure de route me sépare des rives du Baïkal et d’un hypothétique vrai repas.
Nicolas, le chauffeur, ne dit mot. Il me conduit au Belka, petite guest-house perchée au bord de la forêt dans les hauteurs de Listvianka. J’ai pris un lit dans le dortoir et j’y suis seule pour l’instant. Il y a une cuisine à disposition des hôtes. Natalia, la gérante du lieu, m’explique que les pâtes, le riz et le muesli sont offerts.
Au marché je m’en vais dévorer la viande grillée et le poisson fumé que vendent les migrants kazaks.

Un migrant kazak à Listvianka. © Ondine Yaffi
Malgré la fatigue, je pars explorer les alentours et découvre que la route s’arrête au bout du village. Le lac n’a pas encore gelé, il a la couleur de l’argent liquide et sur ses bords, la consistance d’une granita. Rien ne laisse supposer ses plus de six-cents kilomètres de longueur.
Le lendemain, me trouvant en train de récurer les toilettes, Natalia m’engueule: «Et tu as aussi lavé la cuisine!?
- Oui, il y avait éponges, balais et tout ce qu’il faut...
- Mais c’est mon travail, je suis payée pour ça!
- Non, ton travail c’est d’être là. Personne ne devrait être payé pour nettoyer la merde des autres! Vu que tu n’as plus à faire le ménage, on peut boire un thé et discuter.»
Le Belka est un endroit charmant. Mais je découvre vite que c’est aussi le best choice du Lonely Planet.
La seule chose qui m'importe: rencontrer
Pendant que je bois mon thé le matin, j’observe Natalia faire des aller-retours, téléphone à la main, afin d’organiser les journées des routards fraîchement débarqués.
Avant neuf heures, tout le monde est parti enchaîner les loisirs et je reste à faire la seule chose qui m’importe: rencontrer. Nous conversons longuement avec Natalia. C’est une femme cultivée, elle a beaucoup voyagé du temps où elle était l’épouse d’un riche homme d’affaires. Également en Suisse qu’elle me dit ne guère apprécier: «Tout a l’air si parfait et si triste à la fois!».
Une amitié se dessine entre nous et j’ai droit à bien des égards. Quand les touristes envahissent le dortoir, elle me déplace dans une chambre individuelle, elle me prête son ordinateur pour envoyer des enregistrements à notre webradio et me fait profiter du banya (sauna humide) les soirs où il a été chauffé pour les clients. Elle m’accompagne au village afin de me servir d’interprète.
Natalia achète de la vodka et me dit que ce soir, nous mangerons ensemble. Elle veut que j’interviewe Nicolas. «Il est très timide, mais si nous lui faisons boire un ou deux verres, ça lui déliera la langue. Tu vois, si les Russes ont une très ancienne réputation de buveurs, c’est à cause des Tsars. Quand un Tsar ou un de ses subordonnés recevait des émissaires ou marchand d’un autre royaume, il était exigé de faire couler l’alcool à flot autour d’un copieux banquet. Les langues se dénouaient et toute information, de la plus haute à la plus insignifiante, était précieusement consignée, juste au cas où.»
Les temps sont difficiles au lac Baïkal, explique Nicolas. L'équilibre du lac est mis en péril par la pollution. Il est impératif, selon lui, de mettre plus de ressources et de temps pour l'écologie. © Ondine Yaffi
La nuit, les chants du Baïkal sont beaux, terrifiants
Le lac Baïkal a muté. La différence de température entre les extrémités nord et sud, si éloignées l’une de l’autre, ne permet pas à l’eau de geler uniformément. Là où il y a trois jours ne se trouvaient que de l’eau et de la neige mouillée, des plaques de glace venues du nord s’entrechoquent. Des stalagmites d’arêtes bleutées s’élèvent vers le ciel.
Au milieu de la nuit, quand les moteurs se taisent, je vais écouter le Baïkal chanter. C’est beau et terrifiant à la fois.
Une vague de froid arrive, mon train pour Oulan-Bator dans son sillage. Les provodnitsa trainent péniblement des sacs de charbon. Quand j’en soulève un sur l’épaule pour les aider, elles rigolent derrière leur main et attendent que je vienne chercher le suivant. Il n’y a pas de troisième classe dans le transmongolien, je prends mes quartiers dans un compartiment à quatre couchettes. J’entends une voix passer de porte en porte bêlant à tue-tête: «Hello, where do you come from? You speak english?...» C’est l’Autre étrangère du wagon. Quand elle arrive à ma hauteur, je réponds un poil glaciale «From my mother, Darling!» et tourne la tête signifiant que la conversation n’ira pas plus loin. Je ne suis pas d’humeur à me taper une hystérique. Deux jours de train me séparent de Oulan-Bator. Je me surprends à penser que ce n’est pas très loin.
Le lendemain matin, deux femmes mongoles prennent place dans mon compartiment. Elles transportent une montagne de boîtes en carton remplies de petits gâteaux qu’elles vont, je présume, revendre en Mongolie. Je les écoute parler leur langue: tchuktchki ikrrlorh tchisser laotsekrrh... Incroyables, tous les sons que la bouche humaine peut produire.
Arrivée à la frontière, je dois descendre du train que je vois repartir sans nous. Les deux femmes me font comprendre que nous devons l’attendre deux heures. Sûrement un changement de roues.
Le paysage s’aplanit et s’assèche, les zones urbaines se font de plus en plus rares, la terre mongole défile en dessous de nous. Nous entrons en gare d’Oulan-Bator à 5 heures et 40 minutes du matin. L’hiver est passé au niveau supérieur.
Je me suis fait rouler
Un ami, également musicien, m’a mise en relation avec Sharav qui doit venir me chercher à 6 heures.
Je pénètre dans le hall principal, carré et haut de plafond. Je découvre en son centre des chaises où somnolent une cinquantaine de personnes et peux lire sur les vitrines: Tourism agency, Change... La pénombre règne, aucune lumière n’est allumée. Deux couloirs donnent accès à quelques commerces. Tout est fermé. Un escalier mène à la galerie supérieure où se trouve une autre salle d’attente. Il y a quelque chose qui cloche dans cette gare. J’explore à nouveau chaque recoin, mais où sont les guichets?
Le temps passe, la gare s’éclaire, cela fait plus d’une heure que mon contact devait me récupérer. Je demande à quelqu’un s’il y a un téléphone public dans le coin. Il me tend le sien.
Sharav me dit s’être trompé, il est venu hier et ce n’est maintenant plus possible de me rencontrer.
Le propriétaire du téléphone réclame dix mille francs locaux pour le coup de fil. Je n’ai aucune idée du cours de cette devise. J’essaye de marchander, mais ayant peur d’être impolie, je cède. Les gens se retournent et portent un regard sévère sur leur compatriote en secouant la tête. Je me suis fait rouler.
Je sors de la gare. Des bus crachotant partent dans tous les sens. Je n’ai aucun point de repère, j’appelle un taxi. Le chauffeur ne parle pas un mot d’anglais et me sort une carte de la ville au milieu de laquelle je pose un doigt: «Center, downtown...».
Il fait deux-cents mètres et au premier carrefour, me demande quelle direction prendre. Je lui remontre le centre de la carte. Il pointe la droite, puis la gauche et lève les deux mains la tête enfoncée dans les épaules. Je suis consternée. Il repart, puis s’arrête demander son chemin à des passants et fait à plusieurs reprises des demi-tours. Je sors du véhicule perdue dans la banlieue d’une des villes les plus inhospitalières du monde. Une fumée noire couvre le ciel et des yourtes s’entassent au milieu d’immeubles neurasthéniques et de déchets.
Il fait tellement froid. J’ai les pieds qui gèlent – Sorel fait de la publicité mensongère, ses bottes ne résistent pas à moins trente degrés – et une envie de faire pipi à me couper en deux.
Comment quitter cette ville?
Après plus de deux heures de marche et quelques zigzags en bus, je retrouve ce qui me semble être le centre-ville. C’est aussi déprimant et sale que tout le reste, mais il y a quelques boutiques et hôtels de luxe aussi déplacés qu’un vautour sur la carcasse d’un vivant. Ne trouvant rien de plus modeste et ne tenant plus, j’entre dans un quatre étoiles et supplie le réceptionniste de me laisser utiliser les toilettes. Il a la politesse d’accepter. Le froid et le manque de nourriture me tombe dessus, mes orteils me font un mal de chien. Je demande au garçon le prix d’une chambre pour la nuit. La détresse doit se lire sur mes traits, après un bref échange avec son supérieur, il baisse le prix de moitié.
Ici, rien n’a l’air d’être à sa place. Ni les portiers, grotesques dans leurs costumes trop rouges et trop grands, ni les hommes d’affaires qui s’irritent de ces Mongols inflexibles en affaires.
Pendant deux jours, je parcours la capitale à la recherche d’une agence de tourisme, de quelqu’un qui parle anglais, d’une piste pour acheter un billet de bus ou de train. Tout est écrit en cyrillique et avoir appris à le déchiffrer ne m’aide pas à comprendre le sens des mots.
Me souvenant de l’agence à la gare, je hèle un taxi et demande en russe, c’est plus sûr, «Vagsal?». Il me conduit à la station, mon espoir s’éteint devant l’inscription de la vitrine: Open in March.
Comment quitter cette ville?
* L'étrangère
Prochaine étape: Avant de retrouver la gare d’Oulan-Bator, je pars pour les steppes mongoles





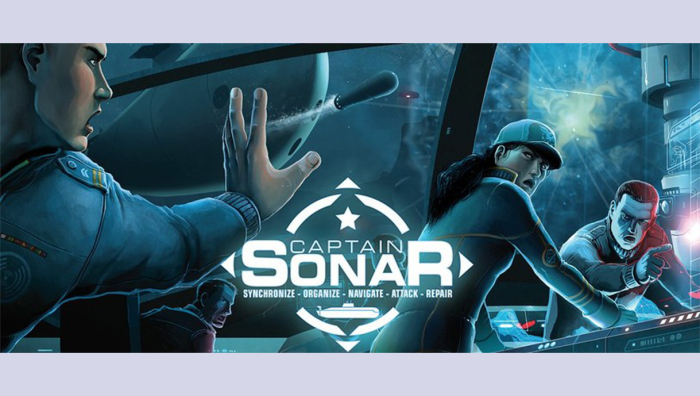


VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire