Culture / «L’actualité, c’est comme la vitrine d’une grande quincaillerie...»
Pendant de nombreuses années, les lecteurs et les lectrices du «Matin Dimanche» ont eu droit, entre des éléments d’actualité et de nombreuses pages de publicité, à une chronique «décalée», celle de Christophe Gallaz. Comme un accident hebdomadaire dans une machinerie bien huilée. Aujourd’hui, les Editions Antipode publient «Au creux du monde», un recueil de chroniques parues dans le journal romand mais aussi dans d’autres publications. Rencontre.
Christophe Gallaz est un chroniqueur à part dans le microcosme médiatique romand. Ce n’est pas un donneur de leçons. Et s’il regrette parfois qu’on l’estime difficile à comprendre, il n’en modifie pas pour autant sa manière de penser et d’écrire. Il est à part, car il ne commente pas; il explore, construit des agencements, trace des lignes de fuite, se frotte aux concepts, se laisse aller au sensible. Ses chroniques ne ressemblent ainsi à aucune autre. Il suffit de lire celles éditées aujourd’hui dans Au creux du monde (Editions Antipodes) pour s’en convaincre. C’est un choix parmi les nombreux textes qu’il a publiés dans des médias suisses et français, comme notamment Le Matin Dimanche, Le Nouveau Quotidien, L’Evénement syndical ou Libération. Jean-Luc Godard était un de ses admirateurs, Jacques Chessex l’a menacé avec un couteau, il fut l’ami du peintre Jean Lecoultre et de l'ancien directeur de la Cinémathèque suisse Freddy Buache, est encore celui du philosophe Dominique Bourg, de nombreux intellectuels et de quelques personnalités politiques, mais aussi d’illustres inconnus.
Tout a commencé à la fin des années 1970, alors qu’il était journaliste à la Tribune de Lausanne (qui deviendra Le Matin en 1984). «J’avais été engagé pour avoir pu glisser dans le journal quelques articles à propos d’un projet d’aéroport à Etagnières, dans le Gros-de-Vaud. Des textes qui manifestaient mon intérêt pour l’environnement. Or un chroniqueur du Matin Dimanche, pareillement sensible aux enjeux écologiques, s’apprêtait justement à quitter ses colonnes. On me demanda si je voulais lui succéder. Ma toute première chronique, parue le 21 janvier 1979, fut consacrée à des projets d’aménagements à Crans-Montana. Voilà comment l’affaire a commencé, avant qu’assez rapidement j’élargisse mes propos bien au-delà des thématiques environnementales.»
Les mots du philosophe Jacques Rancière pourraient s’appliquer à Christophe Gallaz: «L’écriture chez moi est un processus de recherche, une manière non pas de rapprocher le lecteur de ma pensée, mais de rapprocher ma pensée de ce qu’il y a à penser dans telle ou telle distribution des corps et de leur capacité.» (Les mots et les torts, 2021)
Vous vous décrivez comme «un esprit joueur». En quoi cela influence-t-il votre réflexion et votre écriture?
Il me semble que l’esprit joueur préside à toute création. Jouer, c’est combiner des faits et des matériaux, si possible de manière inventive. D’abord le jeu des mots, merveilleux point d’accroche pour le lecteur quand il est réussi. Ensuite, le jeu avec différents éléments d’actualité. Moi, je fais confiance au mode de la cueillette. Par exemple, au moment où apparurent les premières caméras de surveillance aux carrefours des villes, il y a bientôt trente ans, apparurent aussi dans les entreprises des coachs chargés de souder les équipes. J’ai trouvé intéressant que d’un côté l’on contrôle les gens, tandis que de l’autre on les console et les remet en état pour travailler. Ça a donné une chronique intitulée Le mouchoir et la matraque. Tricoter ce genre de schéma, c’est le plaisir de la jouerie.
Quelle est votre définition de l’actualité?
Ce terme me rend dubitatif. Je le comprends comme un échantillon temporel prélevé de manière conventionnelle dans le flux permanent des informations, et souvent présenté de manière si spectaculaire qu’il diffère tout vœu, chez son destinataire, de déployer sa curiosité sur le long terme. On «stroboscopise» le champ des événements, comme autrefois dans les discothèques où les danseurs se démenaient de geste en geste tous distincts les uns des autres. Or l’actualité, soit-elle réductrice à cet égard, reste pourtant un concept intéressant comme terrain d’exercice mental, parce qu’on peut essayer d’y repérer les indices annonciateurs d’une rupture dans l’Histoire en train d’advenir. L’actualité, en somme, c’est comme la vitrine d’une grande quincaillerie: on y met un objet différent une fois par semaine, ça ne nous dit rien de son fonds de commerce, mais on essaie de le deviner…
Dans une de vos chroniques, vous faites parler une femme qui dit: «J’aime quiconque s’explore». Vous explorez-vous vous-même?
Je n’ai pas le sentiment que mes chroniques sont des textes introspectifs. Mais il n’est pas exclu qu’elles me disent un peu. Qu’elles disent en tout cas ma nature d’énervé récurrent. Au-delà de ça, un auteur se révèle sans doute en exposant les types d’intérêt qu’il porte à la marche du monde, et par sa manière de le faire. Il en résulte un portrait indirect, quoique partiel. Et c’est tout: à me lire on ne peut pas en déduire qui je suis au fil de mes jours, ni ce que je pense de faits ou de thèmes que mes textes n’abordent pas.
Est-il important de savoir qui nous sommes? Peut-être sommes-nous juste des moments éphémères de pensée…
Belle hypothèse! Peut-être… éphémères, éphépères, qui que nous soyons...
Vous aimez les jeux de mots (rire)…
Oui. Mes petites murailles contre le désespoir.
L’idée que nous avons un destin nous oblige à nous définir nous-mêmes, nous empêchant ainsi de penser, non?
Votre question nous propulse dans des zones de réflexion merveilleusement complexes où le vouloir-être, ou le vouloir-devenir, deviennent comme des limites à notre présence au monde la plus ouverte et la plus accueillante, et la plus prospective. A peine avons-nous défini les critères de notre réussite sociale ou professionnelle, voire amoureuse, qu’il faut nous formater en fonction de cette perspective, en réduisant nos vagabondages et nos récoltes buissonnières. Je lisais l’autre jour une interview du philosophe Thibaut Sallenave déplorant que nous soyons devenus pareillement obsédés par l’ambition de donner un sens à notre vie. Il n’y en a peut-être pas…
De l’importance du style
Quelle est l’importance du style littéraire dans une chronique?
Fondamentale à mes yeux. Le style, pour quiconque, est une façon de formuler née de sa façon de percevoir et de se penser. Et pour le lecteur, une façon de prendre d’autres trains que celui dans lequel il monte machinalement, et dans d'autres paysages que le sien familier.
Pourquoi apportez-vous tant de soins à votre écriture?
Cet aspect-là de mon travail m’apaise. Une sorte de transe ouvrière, si je puis dire. Alors les fracas du monde extérieur se désaiguisent pour quelques instants. Dans un numéro spécial de Libération sur les écrivains, en 1981, cette question leur fut posée: «Pourquoi écrivez-vous?» Tous y répondirent longuement, sauf Beckett en quatre mots: «Bon qu’à ça…» Merveille de réplique. Que je ferais mienne si j'étais convaincu d'être bon. Je dirais plutôt qu’écrire avec soin, au point de m’avérer tatillon sur la position de la moindre virgule dans chacune de mes phrases, relève chez moi d’un principe quasi militant qui s’est machinalement glissé dans ma pratique. Voilà. Le sentiment que j'ai de ma justesse est gradué par des virgules. Ce qui n’a pas toujours été compris, voire supporté. Tenter d’être soi dans l’acte de faire, quelle arrogance au temps du paraître, du marketing et de l’emballage, ce dont je me suis souvent indigné! En me fâchant publiquement, par exemple, après avoir appris qu’on enseignerait aux stagiaires journalistes à «écrire pour être lu». Alors qu’il faut écrire comme on écrit, au point qu’ensuite on soit lu précisément grâce à cette authenticité, ou sous-lu, voire non lu, tant le texte qui s’ensuit devient passe-partout. A l’écrivant de singulariser naturellement sa production, à ses lecteurs d’accomplir le minime effort qui leur vaudra des perceptions plus mémorables. Bref, décortiquer la coque pour savourer la noix.
Un journaliste formateur m’avait tancé: «Vous devez écrire simplement, de manière à ce que votre concierge puisse vous comprendre…»
Quel mépris des concierges, c'est épouvantable.
Vous dites qu’il ne faut pas écrire de manière péremptoire. Ce qui ne vous a pas empêché de traiter le philosophe médiatique Michel Onfray de «connard»…
Je l’ai fait dans un texte où je situais le personnage d’Onfray face à celui de Greta Thunberg qu’il avait grossièrement insultée, l’un et l’autre étant mis en présence d’une araignée, représentante d’une espèce installée sur Terre depuis 310 millions d’années, qui s’était installée dans le rétroviseur latéral de ma voiture. Dans ce dispositif trilatéral, en présence d’une jeune femme habitée par une cause d’intérêt supérieur et d’un insecte attestant la marche presque infinie des millénaires, le «connard» avait en somme lui-même choisi son statut… Le reste de la chronique étant par ailleurs tissé de tâtonnements essayistes et de traverses poétiques. Une matière orchestrale. Or un coup de cymbales, dans une symphonie, ne la rend pas toute péremptoire…
On en revient au style, au rythme…
Oui, au rythme et à la musique du texte. Au point, dans mon cas, de m’être souvent entendu dire dans les bistrots: «J’adore ce que vous écrivez, mais je n’y comprends rien.»
Je trouve cela tout à fait flatteur pour vous dans la mesure où ces lecteurs-là sont plus dans le ressenti que dans une compréhension sur commande. Quelque chose les traverse. C’est un grand compliment…
Oui, selon votre système de pensée ramifiée. Peut-être…
A propos des influences intellectuelles
Dans plusieurs de vos chroniques se trouvent des réflexions qui font penser au situationnisme, à Guy Debord… Par exemple: «Nous vivons sous le règne de l’image qui recouvre tout réel»… Vous avez lu les situationnistes?
De Debord, oui, j’ai lu La société du spectacle. Et j'ai révéré son style, sa manière de forer les thèmes. De les désosser méthodiquement et implacablement. Comme Thomas Bernhard, au fond.
Vous ne citez jamais vos influences intellectuelles…
Vous savez, j'ai peu lu. Plutôt grappillé. Feuilleté. Peu d'ouvrages consommés de bout en bout. J’ai trouvé du réconfort chez Godard. Lui-même ayant été prodigieusement cultivé, mais comme délié de ses connaissances. Un jour, dans une interview, un journaliste lui demande ce qu’il a pensé de je ne sais plus quel film, et le cinéaste déroule son propos sur ses images, son montage, sa bande-son, ceci, cela. Dernière question: «Et la fin du film, qu’en pensez-vous ?». Réponse: «Je ne sais pas, je dormais depuis un moment.» Ce qui m'enchante.
Comment nourrissez-vous votre réflexion intellectuelle?
Je cherche à comprendre deux ou trois mécanismes à l’œuvre chez les êtres que j’observe, au sein de nos sociétés et dans la manière dont celles-ci protègent ou détruisent ce qui les entoure. Je suis davantage une tête chercheuse, notamment dans la fluidité de ce qu’elle ignore, qu’une tête-bibliothèque soit-elle impressionnante.
Que lisez-vous?
Les journaux.
Des écrivains?
Par bribes, pour y trouver quelque viatique ponctuel ou pérenne. En découvrant par exemple, dans ce poème de Cocteau pêché dans son recueil Clair-Obscur publié en 1954: «Si le feu brûlait ma maison, qu’emporterais-je? J’aimerais emporter le feu…» Tellement beau! Parce qu’on peut généraliser à partir de là. En emportant de tout événement l'équivalent de ce feu, ou de toute rencontre, ou même de toute rupture affective, de quoi nous permettre au moins de mieux percevoir le caractère de l’Autre ou le sien…
Vous vous définissez comme un autodidacte?
Oui et non. Je ne me sens pas avoir acquis beaucoup de savoirs certifiés, mais des façons de laisser vagabonder ma curiosité sensible et de bricoler. On pourrait plutôt me décerner un certificat de débrouillardise culturelle et sociale éventuellement trompeuse…
Vous me faites penser à un entomologiste se baladant dans la nature…
Oui, c’est ça. Se balader pour orchestrer des thématiques qui n’ont parfois, en tout cas dans leurs apparences, rien à voir entre elles. Godard, encore, avait répondu ceci au journaliste Jean-Pierre Elkabbach qui le traitait de marginal: «Vous savez, ce sont les marges qui font tenir les textes». Une fulgurance qui me construit.
Une critique de la société marchande
Comment pouvoir écrire une critique de la société marchande dans des journaux qui, comme Le Matin Dimanche, en font la promotion dans leurs pages de pub comme dans leurs articles?
En concevant cette critique comme un contrepoint légitime à la société que vous dites, au nom d’une intellodiversité nécessaire. Alors on peut tenir le cap. Dans mon cas, les choses se sont établies un peu par hasard, comme par glissement. Du côté des éditeurs, une réaction d’acquiescement subreptice s’est peut-être produite, du genre «Tiens, c’est bien d’avoir un petit accident à l’intérieur de notre système, ça peut être rentable…» Résultat, j’ai pu écrire dans Le Matin Dimanche comme je l’aurais fait pour moi. J’ai pu y exprimer ce que j’avais envie d’exprimer, comme dans d'autres publications. Mais je n’oublie pas qu’on m’en a viré deux fois. En vain, d’ailleurs, au grand dam des hiérarchies concernées, par la grâce d’un public moins inerte et moins désintéressé que prévu…
Le monde que vous décrivez depuis les années 1980 se radicalise…
Oui, on peut même dire que la muraille nous faisant face est armée, au sens du béton. Et je crains que les discours ne suffisent plus.
N’est-ce pas plutôt l’inverse? Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’il n’y a plus que les idées qui peuvent exister…
Bel optimisme, que je partage par moments. Les idées peuvent être le début d’un mouvement, oui, et l’ont souvent été. Mais leur complexité, nécessaire aujourd’hui, les empêche de mobiliser vigoureusement le plus grand nombre. Seuls triomphent en effet sur la scène, comme on le constate, les tribuns sommaires qui les réduisent au statut de clichés.
On entre pourtant, peut-être, dans un grand moment où la pensée va devenir une action, quelque chose qui va ébrécher ce mur…
Il faut l’espérer. Vous avez raison d’y croire. Quoi d’autre, en effet? Le bénéfice amer et pourtant tonique de notre époque, c’est qu’elle nous incite, au moins, à régler nos focales intellectuelles et civiques sur «netteté».
On ne peut plus imaginer être tout à la fois un petit-bourgeois de gauche profitant des avantages du système et prétendre se tenir du bon côté de la morale…
D’où l’existence pour beaucoup d’un inconfort croissant. Oui, se penser et se dire de gauche peut produire un réconfort anesthésiant. Mais porter le maillot de la supposée bonne équipe ne suffit pas, encore faut-il jouer. Mais sur quel terrain, et comment? Pour développer la métaphore du maillot: les parlements, et même toute instance politique exécutive, peuvent-ils continuer à ressembler à des terrains de football ou de rugby travaillés par les principes de la victoire, c’est-à-dire de la violence et de la prédation, plutôt que par ceux du jeu? Moi, je plaide pour une approche multisensorielle dont l’un des paramètres est défini par le bon voisinage de notre espèce avec l’ordre non humain, dont la mise en extinction massive préfigure d'ailleurs notre suicide. A ce propos, j'aime citer l’anthropologue et ethnologue Claude Lévi-Strauss expliquant en 1958 que notre grand tort est d’avoir institué, notamment au siècle des Lumières, une césure mentale et comportementale séparant notre humanité de l’animalité: en manifestant le culot de tracer cette coupure au cœur du monde vivant, précisait-il, nous produirions des minorités possédantes corrompues au détriment de majorités démunies asservies. Eh bien nous y sommes.
Comment terminer cet entretien?
En revenant à ce dont nous avons parlé au début. A notre idée du jeu. En kinésithérapie, il faut qu’il y ait du jeu dans les articulations pour débloquer les mouvements du corps et lui procurer un minimum d'allégresse. C’est une image éclairante. Une autre me vient aussi, celle de la natation. Quand j’évoque la cueillette comme mécanisme de travail, je m’entrevois dans une piscine où je n’ai pas mon fond, comme on dit: je flotte au gré de ma curiosité, je ne croule et ne coule pas sous le poids dont je me suis peut-être chargé, y compris celui de mes savoirs et de mes connaissances «arrêtés». J’ai confiance et ne vais pas me noyer. Et mes protocoles d’observation, comme ceux de mes fabrications, s’en trouvent comme émulsionnés. Ces souplesses-là sont peut-être une définition de la liberté…



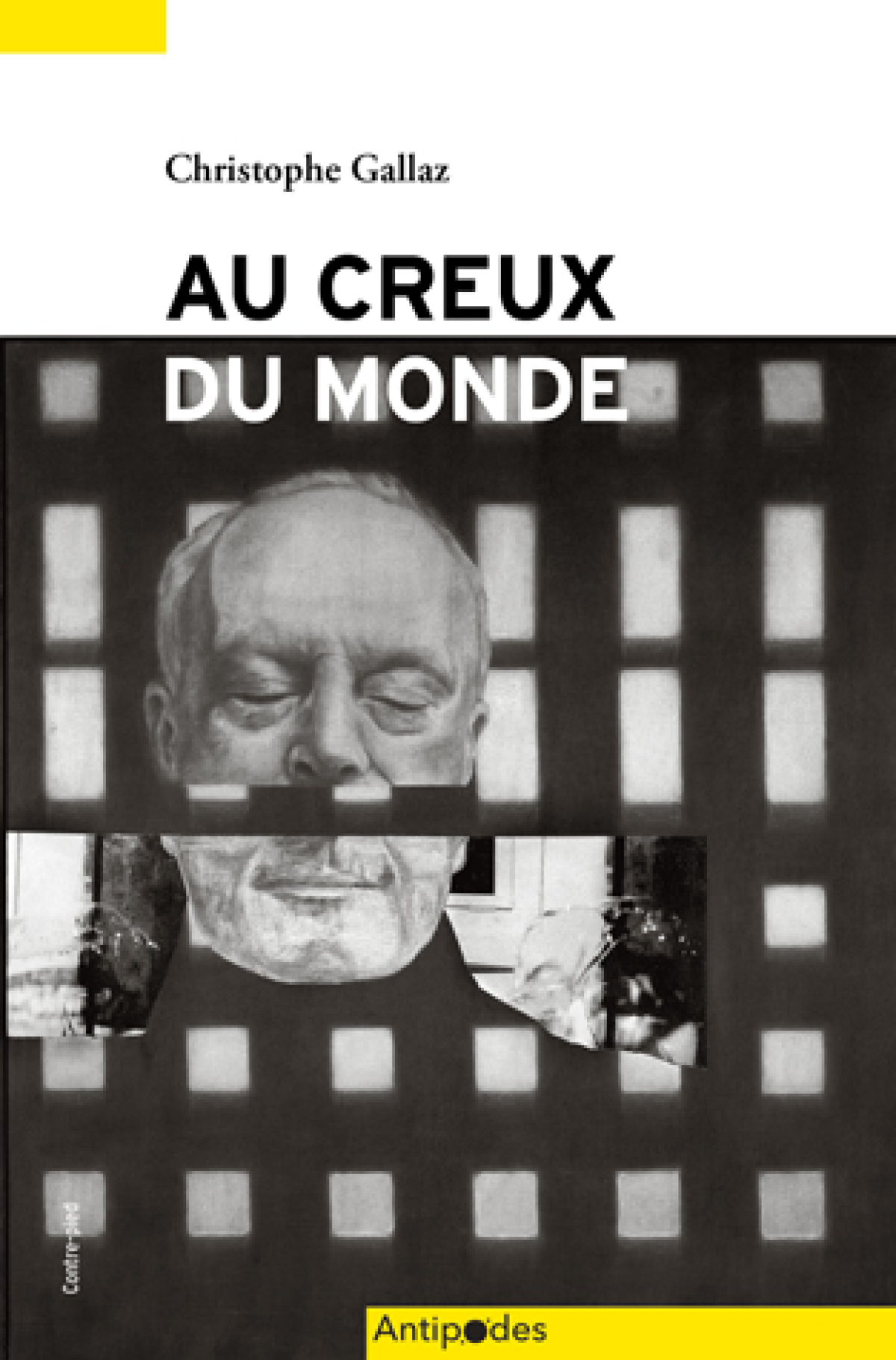


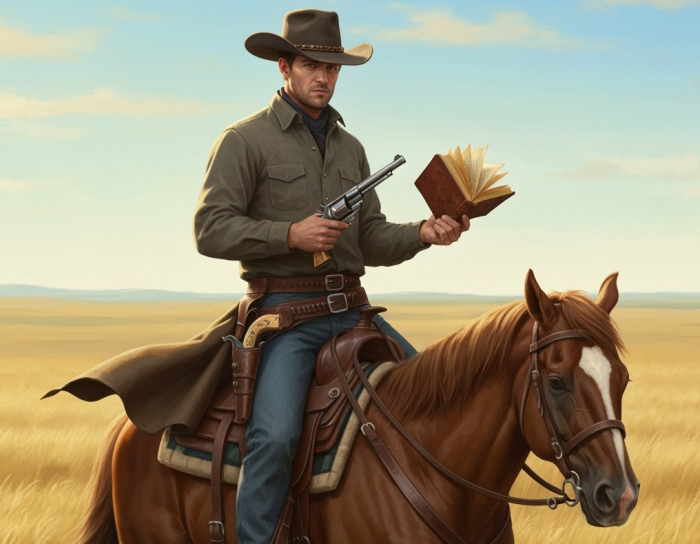
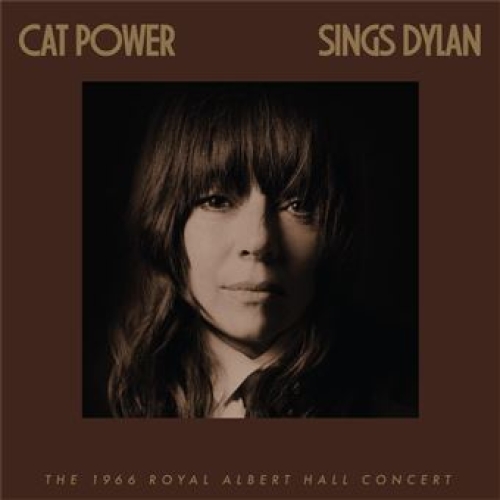

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
1 Commentaire
@Colibri 25.07.2025 | 11h39
«Quelle magnifique rencontre. Merci monsieur Gallaz, merci monsieur Morier-Genoud.»