Culture / La Suisse centrale, le lieu où il ne peut rien arriver
Sous le titre «Ombres sur l’autre ville lumière», Serge Robert nous propose un roman en deux tomes pour un total de 742 pages, sans longueurs ni ruptures de style. Il y est question de sujets qu’il a personnellement expérimentés, notamment le choc culturel que cela représente pour un Français que de s’établir en Suisse centrale et certaines dérives de l’industrie des cosmétiques. Entretien.
Sabine Dormond: Autour de quelle idée de départ avez-vous ficelé votre intrigue?
Serge Robert: Pour le tome 1, je suis parti d’une réflexion qu’on entend souvent en Suisse centrale quand il y a du chaos dans le monde: ce ne serait pas possible chez nous. En tant que Français, je trouvais intéressant de démentir cette idée.
Vous y êtes allé fort en faisant de Lucerne le théâtre d’agressions sexuelles, de déversements de déchets toxiques en pleine nature, de mutilations d’animaux et de tentatives d’assassinat. Vous n’êtes manifestement pas subventionné par l’Office du tourisme?
J’ai quand même obtenu des subsides de la ville de Lucerne. Mais mon histoire est assez éloignée de la réalité. Dans les faits, les gens continuent à éviter de passer par la Baselstrasse, parce qu’un crime y a été perpétré trente ans auparavant.
Comment avez-vous réussi à garder le souffle sur un tel marathon d’écriture?
J’ai pris le temps de réfléchir à la manière d’alterner dialogue et narration, action et moments plus calmes. Mon style se caractérise par beaucoup de rebondissements et peu de descriptions.
Vous avez fait preuve d’une discipline toute germanique! Combien de temps consacrez-vous à l’écriture?
Au moins une demi-heure par jour, idéalement une heure tous les soirs, tout le vendredi et la moitié du samedi. Pour trouver de nouvelles idées, il faut vraiment se plonger dans l’histoire.
Vous vous y astreignez même quand vous n’avez pas envie?
En principe, j’ai toujours envie. Avec l’expérience, j’ai acquis une sorte de fluidité, je sais à peu près où je vais. J’ai réservé la salle pour le vernissage avant d’avoir fini le premier tome, ce qui m’a stimulé à respecter mon échéancier. L’an passé, la traduction en allemand m’a toutefois obligé à repousser les délais.
Vous y sacrifiez une partie de votre vie sociale?
Complètement, c’est beaucoup trop de temps consacré à l’écriture, mais je compte changer le rythme, peut-être diminuer la taille des prochains, ça ne m’intéresse pas de sortir un roman par année. Avant, c’était la folie, car je m’occupais en plus d’une association.
Vous sentez-vous parfois décalé en tant que Français établi en Suisse centrale?
Je suis venu ici par amour voici plus de 20 ans. Il y a de grosses différences de mentalité, mais je m’y suis fait. Les gens se disent plus fermés aux autres, pourtant, il y a plus de touristes par habitant à Lucerne qu’à Venise. Ce qui me surprend, c’est que tout le monde se retourne si tu éclates de rire dans un restaurant. Et que dans la rue, les passants te détaillent des pieds à la tête. Le choc aurait été plus violent si je n’avais pas eu, à travers ma compagne, un accès à ces codes tacites.
Ecrire, est-ce une façon de rester en contact avec la langue française quand on vit à Lucerne?
Oui, tout à fait, ça semble assez bizarre, mais on oublie sa langue en baignant dans un autre environnement linguistique. Je m’en suis rendu compte en juillet 1998, quand j’ai rencontré un Français établi aux Etats-Unis qui parlait un français très basique. En apprenant l’allemand, je me suis aperçu que mon anglais s’appauvrissait et que j’en venais même à chercher mes mots en français. Il est frustrant de perdre sa langue maternelle sans en maîtriser parfaitement une autre. J’ai donc créé une association francophone.
Comment peut-on promouvoir des livres en français quand on vit à Lucerne?
C’est la grosse difficulté, je ne suis pas au bon endroit. Dans une chaîne très connue, les responsables du rayon français ne parlent pas français et, dans une autre, la responsable de la librairie s’occupait auparavant d’un magasin de meubles. Quant aux Romands, ils ne s’intéresseront pas forcément à un roman qui se passe à Lucerne. J’ai eu moins de peine à placer la version allemande, mais à Schwyz, les libraires m’ont refusé sous prétexte qu’ils privilégient les auteurs locaux!
Comment passe-t-on de chimiste à romancier, ou qu’est-ce qui vous a attiré vers l’écriture?
C’est un voyage autour du monde qui m’a incité à écrire. J’ai rencontré un type recherché par la mafia, parce qu’il s’était mis à jouer et à perdre beaucoup d’argent. Ses parents avaient épongé une première dette de 100’000 euros, puis refusé de s’acquitter d’une deuxième deux fois plus élevée. Le gars se planquait dans une banlieue. Il avait des yeux exorbités par le manque de sommeil et l’alcool. Ça m’a inspiré. Ce premier livre m’a servi de thérapie, il m’a ouvert aux autres et aidé à exprimer mes sentiments. Sans m’en rendre compte, j’avais accumulé beaucoup de stress.
Pourquoi avoir choisi le genre du polar? Est-ce votre type de littérature préféré?
J’avais commencé par un roman d’aventures avec une grosse touche de fantastique. Il y a des portes encore ouvertes dans ce monde parallèle d’Utopia, j’aimerais bien m’y replonger.
Votre héros Didier d’Orville est-il une version idéalisée de Serge Robert?
Oui, j’ai toujours un alter ego fantasmé, mais il y a une part de moi dans tous les personnages, par exemple chez Beatriz. Mes personnages évoluent dans des mondes que je connais bien.
Vous inspirez-vous de ce que vous avez vécu en tant que chimiste?
Complètement, c’est parfois du copié-collé, au point que ça pourrait me causer des problèmes. Le premier tome se passe dans le milieu de la pharma et de l’industrie cosmétique. On y colore des extraits de plantes avec du caramel pour donner l’impression qu’ils contiennent plus de substance. On rattrape une couleur, une odeur en mélangeant des produits périmés avec des produits encore utilisables.
Les pratiques que vous décrivez sont-elles courantes?
Je dirais que 95% des marques y recourent. Il y en a de sérieuses, mais elles sont souvent assez chères. Les producteurs de cosmétiques qui achètent ces extraits ne sont pas dupes: les produits sont dits «sans conservateurs», parce qu’on joue sur les régulations. Certains additifs sont acceptés dans tel pays, pas dans tel autre. Les multinationales se renseignent sur le pourcentage minimum d’extrait de plante requis pour être en règle en cas de contrôle, mais se fichent bien de connaître le pourcentage nécessaire pour produire un effet. L’emballage mentionne la provenance de l’extrait et son action apaisante sur la peau par exemple. Le consommateur en déduit que c’est le produit qui a un effet bénéfique, alors qu’en réalité, le dosage est beaucoup trop faible pour provoquer le moindre effet.
A quelle peine s’exposent ceux qui trichent avec la composition et la date de péremption des cosmétiques?
Aux Etats-Unis, quand la FDA vient faire un audit, elle cherche l’arnaque et part du principe qu’on essaie de la truander. Les compagnies qui commettent une erreur n’ont plus accès au marché et la liste de leurs noms est publiée sur Internet. Ici, il y a une forme de laxisme. En cas de problème, on va plutôt se dire que c’est arrivé par mégarde. J’ai vu des cas où les autorités ont estimé que des produits assimilés à la pharma ne remplissaient pas les critères, sans pour autant les retirer du marché. Cela dit, la pharma est astreinte à des règles beaucoup plus strictes que l’industrie cosmétique. Dans mon livre, je mets en scène une compagnie appelée Swiss quality extract, parce que dès qu’un produit est fabriqué en Suisse, ça fait miroiter une qualité. Je m’en amuse, parce que c’est en Suisse que j’ai constaté les problèmes susmentionnés.

«Ombres sur l'autre ville lumière», tomes 1, Serge Robert, 376 pages.





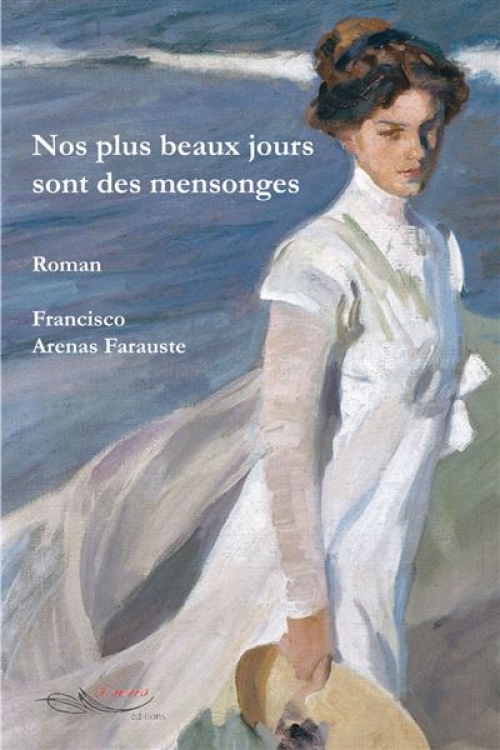



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
1 Commentaire
@Chan clear 08.12.2023 | 11h29
«Détrompez-vous en tant que romande je suis très intéressée par un roman se situant à Lucerne, pour y avoir séjourné, suis tombée sous le charme de cette superbe ville….Il y avait aussi Martin Sutter , super écrivain, passionnant dès ses premiers écrits `la face cachée de la lune « etc,,,,»