Culture / Jean Prod’hom élargit les seuils de l’univers qui nous contient
En un peu plus de cent pages limpides, voire parfois candides, et non moins denses et d’une belle musicalité, le rêveur à la Rousseau, promeneur des marges, que représente l’auteur vaudois, poursuit ses déambulations dans la nature accueillante autant que par le dédale de son existence passée, entre moments de déprime et minutes heureuses, tout à la célébration de «cela simplement qui est», cadeau du présent.
Elargir les seuils est un petit livre étroit de format et d’à peine plus de cent pages, mais assez large d’esprit et de cœur et qu’il faut tout de suite dire amical et de bonne compagnie, de bon conseil sans être sentencieux; un livre d’une immédiate proximité où celui qui parle de lui vous parle de vous, ou d’une sorte de nous partagé, en évoquant l’étrangeté de notre naissance et la singularité de nos enfances ou de l’adolescence telle que les uns, bien sages et alignés, ou les autres plus rebelles, ou tout à fait solitaires, les auront vécues à travers les années, des années parfois marquées par de soudaines déprimes qu’aucun thérapeute, prêtre ou coach de vie (homme ou femme si ça se trouve) n’aura soulagées sur le moment alors même que la dépression en question aura peut-être préludé à une reconstruction de soi ou à une véritable rédemption – le livre de Jean Prod’hom évoquant plus ou moins tout ça; et j’en étais d’ailleurs à penser à nos vies, l’autre soir, tout en poursuivant ma lecture, bientôt interrompue cependant, du fond de la nuit de la forêt d’à côté, par les abois de mon fox Snoopy devenant bientôt d’inquiétants gémissements, sur quoi j’aurais pu finir assommé dans l’obscurité des bois où, à la recherche de mon chien, j’ai fait une chute aussi soudaine que brutale, tête la première et rebondissant sur une quinzaine de mètres le long de la très roide pente du ravin tapissé d’ail des ours…
Or je n’évoque pas cette péripétie par complaisance narcissique, mais parce qu’elle s’inscrit en somme dans cette fin de soirée de lecture d’un livre impliquant précisément le moment vécu de celui qui lit et ses propres sentiments ou sensations du moment…
«J’étais là, telle chose m’advint», le vers fameux de La Fontaine, pourrait être, de fait, l’exergue d’Elargir les seuils dont l’auteur, Jean Prod‘hom, a plutôt choisi cette citation du pédagogue Fernand Deligny: «Le langage mène à tout. D’aucune n’en reviennent jamais»… Ce qui n’exclut ni les mots qui aident, ni les paroles qui sauvent, pourrait-on ajouter.
Des choses, des mots et des «je» que sont les autres…
Or le mot Désarroi figure le premier vecteur de la narration, donnant son titre au premier des cinq chapitres, plus précisément: Naissance et découverte du monde, Dimanches, Au milieu: la nuit, et enfin La Vie plutôt, tout un programme comme on le voit, accordé aux âges revisités par le narrateur – lui-même décentré –, et à ce qui en nous relève de la permanence, à commencer par ce moment de fragilité existentielle suggéré par le premier intitulé qui renvoie à un état largement partagé par nos contemporains dans le drôle de monde qui est le nôtre: «Qui ne s’est réveillé un beau matin les mains vides, allégé mais sans perspective, un peu perdu?»
Le grand mélancolique que fut Leopardi l’écrivait dans son inépuisable Zibaldone: «Pour jouir de la vie, un état de désespoir est nécessaire», et c’est le long de cet abîme «pascalien» que chemine aussi bien Jean Prod’hom, mais il chemine d’un bon pas, et c’est un premier mouvement salutaire, car il y a le chemin et les choses le long du chemin, et «les choses débordent de partout, affranchies de leurs noms, libres des fables et des représentations qui les réduisent si souvent à n’être que les auxiliaires de notre récit personnel. Elles ont non seulement retrouvé leur pouvoir d’être et d’agir mais aussi cette voix singulière que les poètes tentent de restituer dans leurs poèmes. Le vent les effleure parfois, alors qu’elles remuent heureuses et inquiètes; et le frémissement qui les parcourt se répercute de proche en proche jusqu’à l’horizon. Cette mystérieuse concertation des choses ne m’est pourtant pas inconnue; plus d’une fois j’ai surpris les arbres debout dans la nuit, les yeux grands ouverts»…
Je ne sais plus qui disait que la littérature romande découlait en partie de la cinquième promenade des Rêveries d’un promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, où il est question de relation quasi fusionnelle avec la nature et de contemplation, et cela vaut pour ce nouveau livre de Jean Prod’hom, plus encore que pour les précédents, qui s’inscrit également dans le sillage des longues virées pédestres d’un Henri-Frédéric Amiel ou des marches en plaine de Gustave Roud et des promenades de Philippe Jaccottet, explicitement cité d’ailleurs dans le premier récit.
Mais un autre aspect, plus urbain et plus contemporain, marque aussi la relation de l’écrivain avec les choses et les gens, qui m’évoque plutôt la quête des «minutes heureuses» d’un Georges Haldas, ou l’approche des gens par celui-ci, quand il est question ici des clients d’un café en terrasse ou, comme un leitmotiv majeur, de tel vieux berger rencontré par l’auteur dans les monts de la Drôme, dont le conseil lui est resté comme un message essentiel de sagesse: «Le vieux berger me répète depuis plus de trente ans, lèvres closes, par un mystérieux mouvement des yeux, du dedans vers le dehors et du dehors vers le dedans, mais aussi de tout son corps, que l’impossible est à portée de main, que la césure qui nous fait si souvent douter et aller de travers n’est pas tant un empêchement ou une gêne que l’appui à partir duquel il est possible de nous réconcilier avec nous-mêmes, les autres et la terre.» Et de citer, dans la foulée, un fragment des Eléments d’un songe de Jaccottet où il est question, là encore, du dépassement du désespoir par ce que Georges Haldas appelait l’état de poésie.
Les détours du spirituel vers le grand ouvert
Jean Prod’hom n’écrit point de vers, qu’on sache, pas plus que Gustave Roud d’ailleurs, ni ne prêche pour aucune paroisse religieuse ou politique, même si «le ménage de la poésie et du religieux», auquel il fait allusion à propos de Jaccottet, le préoccupe de toute évidence et que la présence de son livre dans la «petite bibliothèque de spiritualité» des éditions Labor et Fides se justifie pleinement.
Or la meilleure illustration de sa «position» en la matière me semble se trouver dans le chapitre intitulé Dimanches, où il évoque sa participation aux cultes dominicaux de la communauté darbyste, en son enfance, dont ce qu’il a retenu, bien plus que le «message» des offices, est la présence d’un vieil homme chétif et solitaire chargé, en tant que concierge apparemment extérieur à la communauté, d’ouvrir les fenêtres du local entre le moment de la lecture et celui de la communion. Contraste formidable, alors, entre l’atmosphère confinée du rituel auquel l’enfant se sent aussi étranger que le chenapan fils de quakers, dans La Loi du seigneur, qui reluque les fidèles en train de prier, et le «miracle» du grand jour révélé par le vieux concierge.
Alors l’auteur de commenter: «Pourquoi ne pas le reconnaître, je dois beaucoup à ces dimanches darbystes et à cet inconnu qui, sans le vouloir ni le savoir, m’aura détourné des collectifs et de la folie qui les guette lorsqu’ils tournent le dos à ce qu’ils ont sous les yeux». Et de conclure en ces termes qui ne sont pas d’un «mômier» mais rejoignent en somme les «métaphysiques naturelles» communes à beaucoup de nos auteurs: «Les années ont passé mais la foi qui m’habitait est restée intacte; je voue aujourd’hui comme hier une espèce d’adoration et de culte à l’égard de la terre et du ciel lorsqu’une fenêtre s’ouvre et qu’ils déboulent. Je concède même que, sous ce rapport, je suis devenu toujours plus religieux. Nous sommes nombreux – n’est-ce pas? à répondre chaque matin à l’appel du dehors»…
Ce «dehors», c’est La vie plutôt, comme le suggère le dernier chapitre de l’ouvrage, suivant une très belle évocation de la solitude adolescente (dans le chapitre précédent intitulé Au milieu: la nuit), la vie et ses états dépressionnaires («Il n’y a qu’un pas entre le néant et le ciel, les gouffres et les illuminations, l’effroi et l’émerveillement»), la vie et ses cadeaux de chaque jour, la vie et ses détours dont la poésie intrinsèque scelle la valeur à l’épreuve du temps: «S’il nous faut beaucoup d’années pour ne plus consacrer nos heures à l’exercice exclusif de la raison et de la preuve, il nous en faut plus encore pour accepter l’insensé, le ciel et les rivières, l’éphémère, le jeu de l’éveil et du déclin, de la tension et du relâchement, de la vie et de la mort. Et de nous en satisfaire»…




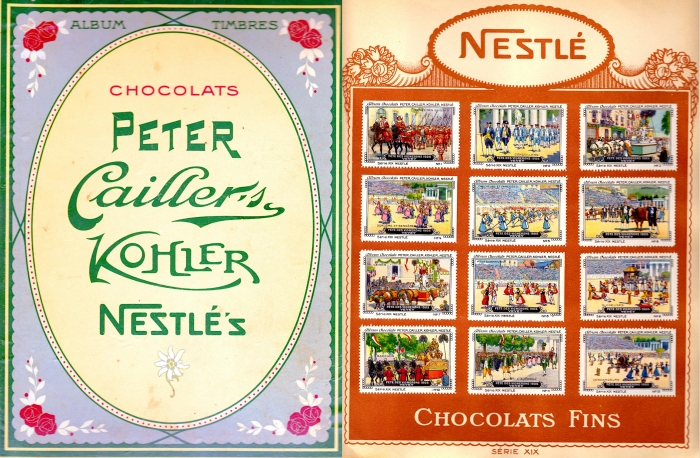

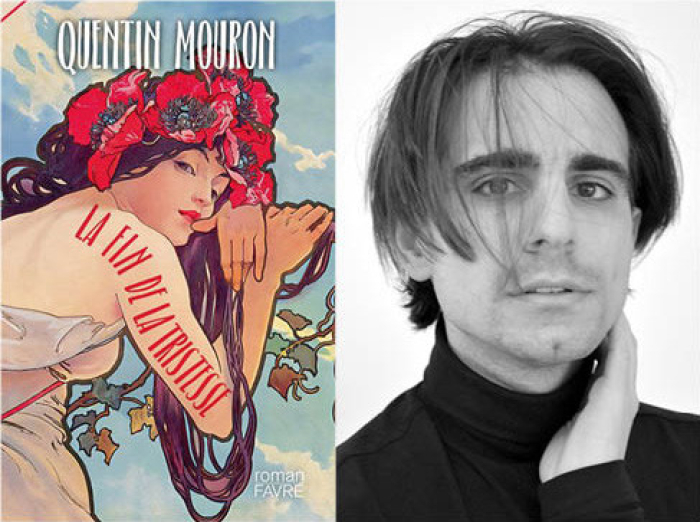
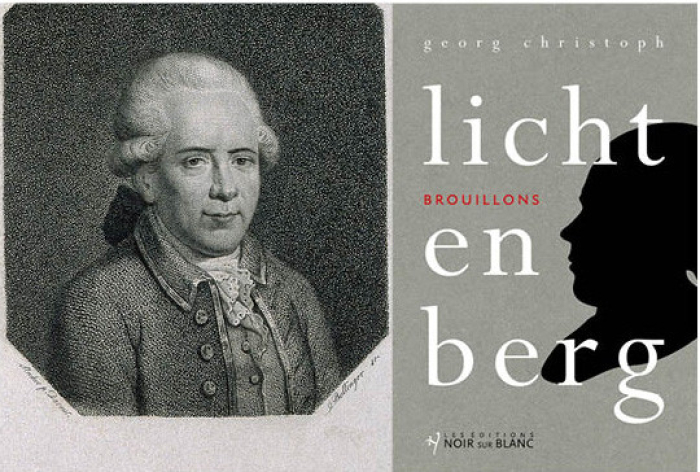
VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire