Culture / Un soupçon d’humour noir peut aider à supporter le poids du monde
Une série anglaise de l’humoriste Ricky Gervais, «After Life», évoquant le deuil de manière plutôt hilarante, et le premier roman d’Emmanuelle Robert, «Malatraix», détaillant les méfaits d’un terroriste préalpin qui venge la Nature afin de préserver les hauteurs sublimes de l’invasion parasitaire des «traileurs», modulent les envies de tuer qui nous viennent parfois pour de plus ou moins nobles raisons, avec ou sans passage à l’acte…
C’est d’abord l’histoire d’un quinqua déprimé, prénommé Tony, qui vient de perdre la Lisa de sa vie et se demande s’il va plutôt tuer son prochain qui ne lui a rien fait, pour se venger de la vie salope, ou plutôt se taillader les veines – ce à quoi il renonce devant le regard réprobateur de sa chienne Randy.
Tel est l’argument de départ de la série à succès After Life, délectable suite d’horribles petits épisodes écrits et interprétés par l’humoriste Ricky Gervais et que, me sachant en grand deuil depuis décembre dernier, un ami né le jour de la mort de Che Guevara, en octobre 1947, a cru bon de me conseiller, à moi qui suis né le jour de la naissance du Che et de Donald Trump, le 14 juin de cette même année.
Or, allez comprendre la nature humaine: je sais gré à mon compère de la découverte (tardive, puisqu’on en est à la troisième et dernière saison qui a drainé plus de 100 millions de spectateurs) de ce feuilleton ironisant à sa façon sur le «travail de deuil», quand bien même je n’ai pas été tenté, une seconde, de trucider mon entourage ni de me jeter dans la baye de Montreux avec une pierre au cou.
Par ailleurs, After Life m’a rappelé, aussi, ma carrière dans les diverses rédactions où j’ai sévi pendant cinquante ans – Tony collaborant à un «gratuit» qu’il trouve décidément minable depuis la mort de Lisa, alors que celle-ci, tous les jours, continue de l’encourager à vivre par le truchement de l’ordi sur lequel elle a enregistré des messages à lire après sa mort, entre autres vidéos de leur joyeuse vie commune.
C'est aussi parce qu’il y a bel et bien une vie après Lisa, qui le pousse à lui trouver une remplaçante, que tous ses proches s’efforcent de raisonner Tony dont la douleur lui fait croire qu’il peut tout se permettre: son beau-frère qui dirige le «gratuit» et la brave dame venant se recueillir devant la tombe de son défunt Stan, voisine de celle de Lisa; son psychiatre gentiment débile mais de bonne volonté qu’il traite de nul sans se gêner; une plantureuse courtisane qu’il remballe d’abord et qui lui propose de lui faire son ménage en tout bien tout honneur; d’autres encore, et peu à peu, malgré sa rage, lui apparaissent la gentillesse et pire: la bonté des braves gens, tandis que Lisa, sur son écran de laptop, lui répète qu’il est le roi des types – tout cela pimenté d’irrésistibles épisodes, au fil des «sujets» qu’il traite pour sa feuille locale, dont la rencontre avec une centenaire – fierté locale à citer absolument en exemple pour sa probable sagesse, qui lui lance que la vieillesse est une calamité et qu’elle se réjouit de clamser…
Bref, et comme dans la série Mum, version féminine du même sujet, le succès phénoménal d’After Life tient sans doute à l’immense tendresse que dissimule son apparent cynisme, faisant de tous ses personnages des sœurs et frères humains en somme dignes de sympathie…
Sympathie même avec le démon? Chiche!
Le terme qui convient le mieux à la nature des relations d’Emmanuelle Robert avec les nombreux personnages, de tous les âges, de son premier roman, est sans doute celui-ci: sympathie, et qui se communique illico à la lectrice et au lecteur.
Ceux-ci, bien élevés ou sagement conformés aux traditions bienséantes de la paroisse littéraire romande, se formaliseront peut-être à la lecture des quatre premières pages de Malatraix, intitulées Carnet et rédigées par un malappris agressif au langage grossier, visiblement talonné par «cette merde de virus», non moins cancéreux en rémission temporaire et tout décidé, avant le grand saut, de purger la Montagne, sacrée à ses yeux, de tous les «guignols en baskets» qui en polluent les flancs et les crêtes. On apprendra plus loin que cet ange exterminateur est un ancien guide à l’ego proportionné à ce qui lui reste de belle gueule, mais pas question de «spoiler la story», n’est-ce pas, comme le recommandent les amateurs de séries.
Or précisément, dans le même style des séries, l’on parodiera tout de même la mise en garde d’usage: langage grossier, violence, sexe, drogue, suicides, déconseillé aux moins de 13 ans…
Et la sympathie là-dedans? Pas moins immédiate dans la mesure où le Carnet du type, se posant en nouveau Farinet, «résistant» et chargé de mission par l’Alpe sublime, fait écho à quelque chose que tout Helvète ami de la nature peut éprouver.
Il me souvient, ainsi, qu’entre seize et vingt ans, fous de grimpe d’avant et après mai 68, nous aurons, à l’enseigne du FDA (Front de désintoxication alpine), imaginé de dynamiter moult pylônes et autres obscénités mécaniques souillant la pureté des hauteurs, quitte à user nous-mêmes de moyens artificiels pour passer un surplomb ou remonter une dalle ou une fissure de sixième degré supérieur, etc.
Donc «grave sympa» la Manu, comme le relèverait le joli Dani, le plus jeune de ses personnages, qui parle comme vos ados même moins «chelous» que lui, et dont la «galère perso» s’inscrit bien dans les zones d’ombre de la crise sanitaire, entre «teufs de oufs» et «plans culs» à voile et vapeur, sans parler de faits carrément «relous» (trafics de filles de l’Est et autres malversations liées au Covid), etc.
Cela surtout à souligner d'emblée: que la narration de Malatraix se fait dans le langage particulier de chaque personnage, sans que sa fluidité ou son naturel n’en pâtissent. Il est vrai que le parler actuel, jusque «par chez nous» où l’on dit «contour» pour virage et «là-bas en haut» pour là-haut, est aussi métissé que la société des temps qui courent…
Purs et durs en dolce Riviera
Après quelques pages d’anthologie sur l’argot des bagnards, dans Splendeurs et misères des courtisanes, Balzac fait cette remarque concernant les exagérations de la fiction par rapport aux données de la réalité: «Une des obligations auxquelles ne doit jamais manquer l’historien des mœurs, c’est de ne point gâter le vrai par des arrangements en apparence dramatiques, surtout quand le vrai a pris la peine de devenir romanesque». Puis le romancier dit, en substance, que la «nature sociale», notamment dans une grande ville, est devenue tellement «romanesque» qu’elle dépasse tout ce qu’un écrivain peut imaginer. Et d’ajouter: «La hardiesse du vrai s’élève à des combinaisons interdites à l’art, tant elles sont invraisemblables et peu décentes, à moins que l’écrivain ne les adoucisse, ne les émonde, ne les châtre»…
Or Balzac n’était pas du genre à «châtrer» la réalité, ni non plus à brider sa folle imagination. Cependant, rapportés à la Suisse actuelle, et à l’image qu’en donnent nos écrivains, que dire de leur souci du «vrai» ou des éventuelles exagérations de leurs fictions? Je me suis posé la question en lisant naguère les premiers romans de Marc Voltenauer, qui ne se situaient ni à Paris ni à Los Angeles mais dans nos Préalpes où tel tueur en série rôdait entre marmottes et ruminants placides. Du moins Voltenauer achoppait-il bel et bien à une thématique sociale, économique ou psycho-pathologique impliquant telle ou elle «affaire» à connotations criminelles, comme un Dürrenmatt ou un Glauser dans leurs récits «noirs» antérieurs.
Cela noté pour en revenir à Malatraix, qui emprunte les sentiers locaux à la manière de Voltenauer – au ravissement probable des randonneurs de notre classe moyenne gentiment encanaillée et redécouvrant la belle nature.
Quant à la vraisemblance du «killeur» s’en prenant aux «traileurs» du Haut-lac, genre ex-beau mec grand baiseur et pervers narcissique quoique guide patenté, pourquoi ne pas y croire quand on sait ce qu’on sait et qu’on voit ce qu’on voit, comme le dirait l’adorable vieille Marie-Rose bientôt centenaire qui risque de s’exploser en fumant ses clopes trop près de ses bonbonnes à oxygène?
Ce qui est sûr, au sens balzacien du «vrai», c’est qu’Emmanuelle Robert et ses personnages sont «en phase» avec notre présent récent (la pandémie, l’obsession sanitaire, la non moins obsédante course aux «perfos», la crise climatique et ses dérives para-terroristes, l’errance affective et sensuelle d'un peu toutes et tous, la liberté des mœurs n’excluant pas les éthiques personnelles rigoureuses) et qu’il en ressort, conforme aux codes du genre très bien maîtrisés, un roman franc du collier et tendrement accordé au sens commun, narquois et débonnaire, dont le sentiment qui s’en dégage, excluant toute complaisance morbide ou malsaine, relève, une fois encore, d’une sympathie partagée qui ne s’aveugle pas, disposée cependant à «faire avec» l’impureté de notre putain d’espèce…
Ergo sans ergoter: Emmanuelle Robert, dès son premier roman, sait faire parler notre terre et ses gens, démêler en nous la part des anges et des démons, célébrer enfin la bonne vie au bord du ciel splendide cerné d’orages, etc.





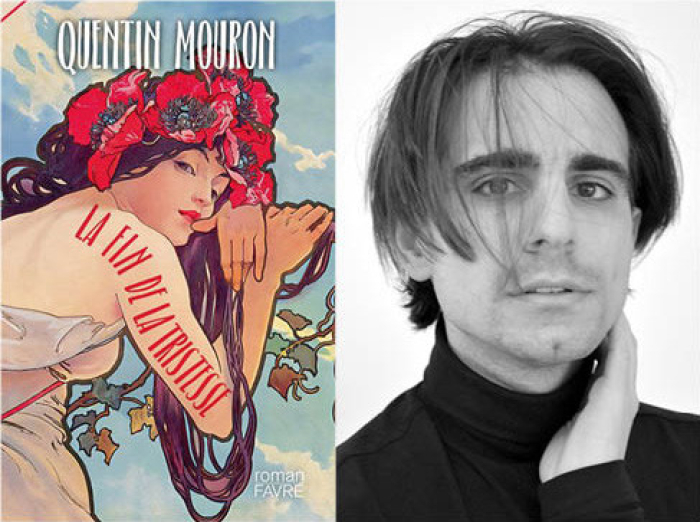
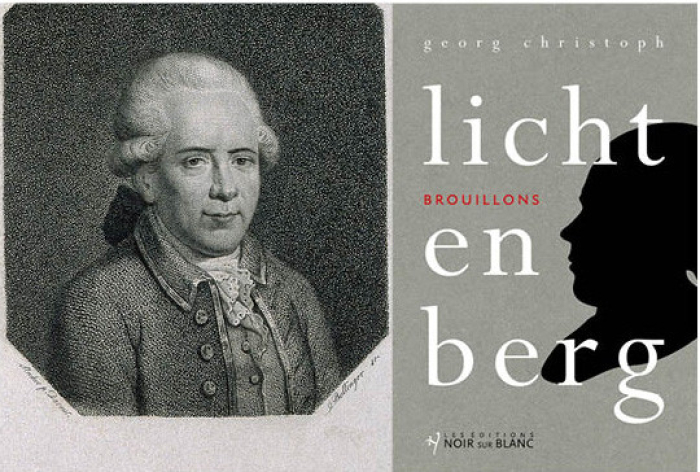

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
1 Commentaire
@miwy 05.02.2022 | 04h46
«comment peut-on naître le même jour que celui de la mort du Che ? C'est honteux ! N'y avait-il pas interdiction d'accoucher ce jour là ?»