Culture / Le squelette et sa propriétaire
Dominique de Rivaz est une hydre à mille têtes, à en croire le nombre de ses casquettes. Scénariste, cinéaste, metteuse en scène, auteure et jadis participante à la fameuse émission des télévisions francophones «La Course autour du monde» qui a fait rêver plus d’un journaliste en herbe, elle vient de sortir un recueil assaisonné d’humour parfois sarcastique et d’une bonne dose de fantaisie. Paru aux éditions Le Cadratin sous le titre Le monsieur qui vendait des choses inutiles, il aborde la question de la mort et de la décrépitude. Celle de ses proches, de son père et la sienne en filigrane. Entretien.
BPLT: Les personnages de ce recueil sont-ils uniquement le fruit de votre imagination ou sont-ils réellement inspirés de vos proches?
Dominique de Rivaz: C’est un mélange, les transmissions familiales sont inspirées de ma famille, d’autres ont été données par des connaissances, des amis ou par la vie. En Iran, j’ai rencontré un monsieur qui faisait son coquet en affirmant vendre des choses inutiles. J’ai tout de suite su que j’allais en faire une histoire. Quant au récit rocambolesque qui ouvre le recueil, il est tiré des archives de la ville de Neuchâtel.
Les choses inutiles sont-elles plus séduisantes et si oui, pourquoi?
Souvent, oui, en tout cas, ces pattes de hanneton, ces manchons pour les pattes de poulet, ces petits ronds au bout du bec de la théière, tous les articles du catalogue de ce monsieur rencontré en Iran, c’est toute la vie qui défile, notre génération avait encore ces fioritures au restaurant. Au printemps, quand il y a les hannetons dans les confiseries, c’est un émerveillement. Cette coutume vient d’Alsace et s’est développée en Suisse alémanique. Au pensionnat à Estavayer, les hannetons entraient par les fenêtres et nous étions terrorisées à l’idée qu’ils se posent dans nos cheveux.
Vous vivez à Berne et à Berlin et c’est de l’allemand que vous tirez le terme de dédevenir, autrement dit décliner, péricliter. Quelle influence cette langue a-t-elle sur votre écriture?
«Je dédeviens», c’est ce qu’a répondu un jour Bernadette Prêtre, la maman du célèbre cardiologue, à quelqu’un qui lui demandait comment elle allait. Cette réplique a suscité en moi le choc qu’on éprouve quand une pièce du puzzle se met en place pour un recueil. J’ai découvert plus tard que dédevenir vient de l’allemand entwerden. Plus que les langues, ce sont surtout les pays qui ont de l’influence sur mes scénarios de films, en particulier la Russie.
L’émission "La course autour du monde" vous a donné une notoriété dès l’âge de 26 ans. Vous avez ensuite obtenu des prix cinématographiques tels que le prix du cinéma suisse en 2004 et de prix littéraires comme le prix Schiller Découverte 2009. Est-ce que les succès que vous avez connus dans votre vie attisent la peur du dédevenir, selon l’adage «On ne peut pas être et avoir été»?
Ce n’est pas une peur, mais peut-être une coquetterie, de me dire qu’il faut affronter la chose, mais à l’évidence avec humour. La mort et le déclin sont présents dans toute mon œuvre; dans mon premier film, il y a déjà un gisant, des jeunes qui vendent leur âme pour survivre.
Votre recueil est ponctué de 12 fragments intitulés Transmission familiale qui constituent autant de mini-portraits de proches dans leurs derniers instants. Est-ce que le moment de l’agonie est celui où on se révèle le plus?
Pour ne pas y être passée, j’aurais de la peine à te dire, mais en tout cas en Valais où on a la chance de voir mourir les proches, on prend la chose la tête haute, avec fierté, humour. Et surtout sans peur.
L’histoire qui a donné son titre au recueil met en scène une femme qui lit une lettre écrite en hommage à son père, lors des funérailles de ce dernier. Elle la lit au micro alors qu’il n’y a absolument personne dans la salle, hormis le cadavre et l’employé des pompes funèbres pressé de terminer sa journée. Vous poussez jusqu’à la caricature le manque de déférence du croque-mort vis-à-vis de la personne en deuil. Avez-vous eu l’occasion d’observer pareil décalage entre la souffrance de l’un et l’impatience de l’autre?
Je l’ai vécue au décès de ma maman. Les pompes funèbres valaisannes étaient en dessous de tout. Ils ont collé les lèvres de ma maman à la colle, fermé le cercueil alors qu’on leur avait demandé de le laisser ouvert, été incapables de rédiger le faire-part. Avec mon frère, on a dû s’en charger nous-mêmes en piquant l’accès internet sur un site de sport. On s’est trouvés à pleurer de rire tellement c’était éprouvant.
La plus longue nouvelle de votre recueil est l’histoire d’un squelette qui se rebiffe contre sa «propriétaire» parce qu’elle le fait trop travailler sans s’encombrer de considérations ergonomiques. Est-ce qu’on est parfois, à soi-même, le pire des dictateurs?
Cette histoire est totalement autobiographique: j’ai d’abord eu une bosse qui est apparue sur le pied, puis une autre sur la main, ça m’a donné l’idée du squelette qui veut prendre son indépendance.
Je pense que ça arrive qu’on soit très dur avec soi-même, mais «dictateur» c’est un mot extrême que je garderais pour des situations politiques plus graves.
Faut-il voir aussi dans cette rupture insolite entre un squelette et sa propriétaire une métaphore des maux de l’âge ou de la mode des divorces?
Je pense que c’est tout en même temps. Il est aussi question de nos désirs individuels, le squelette et sa propriétaire se disputent beaucoup sur la question de savoir s’ils veulent être enterrés ou incinérés. J’ai supprimé un passage où le squelette voulait adopter un enfant. C’est un récapitulatif de tous les sujets quotidiens dans un couple. Ce qui est très actuel, c’est le coming-out.
L’humour est-il un solide refuge contre la décrépitude?
Absolument, c’est le seul, rire de soi-même et de l’inéluctable. C’est ma démarche générale. Rose Envy est une tragédie, l’héroïne perd son mari médecin dans un accident d’ambulance et décide de manger ses cendres par amour. Au fond, c’est une histoire tragique, épouvantable, mais la façon dont l’héroïne procède relativise tout, le fait qu’elle utilise par exemple une cuiller Ikea, qu’elle ramasse les cendres avec l’aspirateur quand l’urne se fracasse, tous ces détails la tournent en dérision.
Est-ce qu’on gagne en humour ce qu’on perd en fraîcheur, en vigueur, en beauté, autrement dit est-ce que l’âge incite à l’autodérision?
Je crois que c’est très personnel, je connais beaucoup de personnes qui n’en ont pas. Mon roman La poussette (Buchet-Chastel, 2011) aborde le thème de la stérilité. A la base, je voulais en faire une chose grave, mais quand j’ai vu à la télévision un monsieur dont le métier consistait à chercher des balles de golf dans des trous d’eau, il m’est apparu que j’allais en faire quelque chose d’acide, de drôle.
Vous avez réalisé tellement de choses que vous donnez l’impression d’avoir eu plusieurs vies. Quels ont été les évènements les plus marquants?
Mon mariage avec Jean-Pierre à Berlin (on était à l’école française ensemble et on s’est retrouvés à 43 ans), ma marche à St-Jacques de Compostelle avec une amie pendant Tchernobyl et les semaines que j’ai passées seule dans le grand Nord russe au-delà du cercle polaire dans un village de 300 habitants où il n’y a qu’un avion par semaine. J’y ai réalisé mon livre de photo Les hommes de sable de Choïna et un essai cinématographique intitulé Elégie pour une phare. J’y repense tous les jours avec nostalgie.




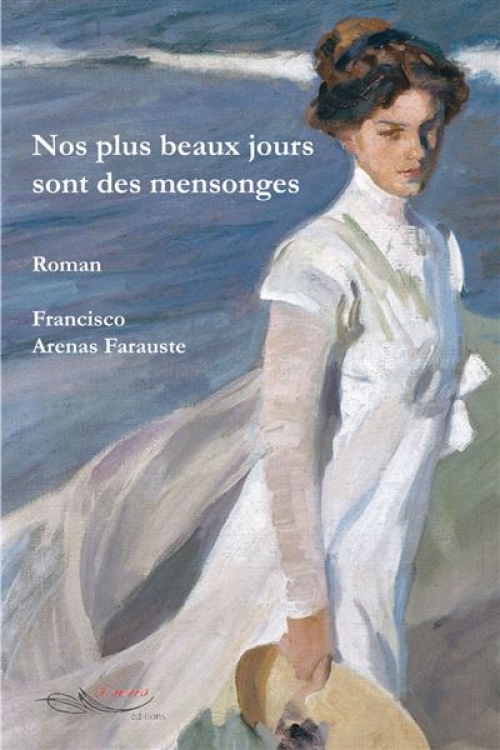



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
1 Commentaire
@stef 18.01.2020 | 20h18
«J’ai adoré ses sujets, d’une grande sensibilité, dans la Course autour du Monde »