Culture / Exister à l’ombre de sa sœur
Récemment paru chez Campiche, le roman de Sonia Bächler intitulé «Mon Dieu, faites que je gagne» montre à travers un crescendo parfaitement maîtrisé ce que c'est que d'être la sœur d'une sportive d'élite sur laquelle se focalise sans cesse toute l'attention de la famille. Il décrit au passage la machine à broyer les destins que représente la compétition de haut niveau. L’auteure de cette autofiction force volontairement le trait avec le souci néanmoins de restituer le plus fidèlement possible la dérive d’une famille happée par le miroir aux alouettes de la réussite sportive. Entretien.
Sabine Dormond: C’est bientôt les JO, comptez-vous y assister?
Sonia Bächler: Non, j’avais prévu d’aller à Paris cette année, mais on va repousser à l’année prochaine.
Aurait-on tendance à confondre bonheur et réussite au point d’attacher plus d’importance à la réussite qu’au bonheur?
C’est un résumé de mon livre. Sous couvert de bienveillance, on a tous en tête la réussite.
On entend souvent dire qu’il ne faut pas chercher la reconnaissance auprès des autres, mais savoir se la donner à soi-même. Cela vous parait-il réaliste? Peut-on se construire une identité indépendamment du regard que les autres portent sur nous?
Je pense qu’une part de soi dépend du regard des autres, dans l’enfance, ça compte énormément pour se construire et apprendre à se faire confiance. On a tous eu un prof qui nous a fait sentir qu’on est quelqu’un de bien et qui nous a donné des ailes. Avec un peu de maturité, on commence à mieux se connaitre, à se découvrir des centres d’intérêt et des dons, en fonction de nos échecs et de nos réussites. Mais même dans le couple et en amitié, on a besoin d’encouragements. L’identité est un puzzle, à chaque étape, on en découvre une nouvelle pièce en lien avec les rencontres qu’on peut faire.
Certaines compétitions sportives comme le foot semblent euphoriser des nations entières. Vous y croyez, vous, à ce bonheur par procuration?
Je me souviens avoir vu mon grand-père pleurer de joie en regardant les courses de ski. Tout le monde se réunissait autour de la table pour y assister. Moi, je me suis toujours sentie en décalage. Pareil pour les matchs de foot: j’y allais pour ne pas rester à l’écart, mais ça ne me procurait aucune émotion.
L’esprit de compétition nous pousse-t-il inéluctablement aux dérives que vous décrivez ou peut-on avoir un sain esprit de compétition?
Je me pose la question. Un peu de compétition peut être stimulante. En 3e du cycle, il y avait dans ma classe un garçon dont j’étais un peu amoureuse, ce qui me poussait à essayer d’obtenir de meilleures notes que lui. Mais représenter un canton, une région, la Suisse, nous empêche d’exister pour soi. C’est le début des dérives. Je suis ressortie de ces années avec une haine de la compétition et du sport. Dans le monde d’aujourd’hui, tout est affaire de compétition. Par exemple les clubs sportifs proposent tout de suite des concours, que l’enfant soit bon ou pas. On met en avant le fait que c’est apprendre le dépassement de soi. Je trouve terrible cette injonction à faire du sport pour être quelqu’un de bien. Je me demande si ne rien faire, jouer, rêver, n’est pas le plus important dans la vie.
Le grand-écart de la petite sœur sur le tapis de la Migros de Sion a marqué le début d’un engrenage fatal. Est-ce que la possibilité d’y échapper s’est présentée une fois ou l’autre au cours des onze ans que vous relatez dans Mon Dieu, faites que je gagne?
Il y a un moment où tout risque de s’arrêter quand la gymnaste n’est pas qualifiée pour Macolin sur un malentendu. L’aînée espère d’un côté pouvoir sortir de l’engrenage, mais elle se rend compte que ça va nuire à son autonomie naissante. A la longue, elle a fini par y trouver son compte.
Chaque époque, y compris la nôtre, a imposé aux filles et aux femmes une façon de vivre leur féminité. Est-ce que c’est encore plus pernicieux quand on nous persuade que ces diktats sont l’expression de notre liberté?
A l’époque dans laquelle j’inscris ce livre, il ne fallait pas être trop fille. J’avais l’impression que le modèle du garçon manqué incarnait le summum de la liberté. Ce genre de filles savaient plaire aux garçons, parce qu’elles leur ressemblaient.
Vous nous présentez l’athlète, la star comme une simple marchandise au service d’intérêts qui le dépassent. Peut-il s’en rendre compte avant de tomber du podium?
Ça dépend de nombreux facteurs. Mes parents n’avaient pas pu réaliser leurs rêves. C’est une faille que la réussite de la gymnaste est venue combler. J’aime l’image de l’eau qui gèle dans les failles en hiver. Mes parents sont entrés dans une sorte d’aveuglement et m’y ont embarquée. On ne voit que les sportifs qui réussissent, ça occulte tout le reste. L’enfant qui vit ça est certain d’être quelqu’un d’exceptionnel. Il se laisse prendre dans une spirale de réussite et de fierté de soi, même si la pratique de son sport ne lui procure plus de plaisir.
Un enfant ne peut pas se rendre compte que ce qu’il vit n’est pas normal, ni donc verbaliser son mal-être, puisqu’il n’a rien connu d’autre. Est-ce que ce non-dit ne cherche pas à s’exprimer à travers des troubles du comportement par exemple?
Je ne suis pas experte, ni psychiatre, mais j’ai vu des filles tomber dans l’anorexie, voire les addictions. Tout enfant qui ne se sent pas à l’aise avec l’activité qu’il pratique doit le faire entendre d’une manière ou d’une autre.
Comment vos parents ont-ils accueilli ce livre?
C’est un roman basé sur des choses qu’on a pu vivre. J’avais quelque chose à dire au sujet des méfaits du sport à outrance, un questionnement à exprimer par rapport au dogme «le sport, c’est la santé». Est-ce que c’est sain de porter aux nuées des héros du sport? La musique, c’est pareil, où placer le curseur pour prendre du plaisir à apprendre et progresser sans s’enfermer dans une obsession? Mes parents ont pris de la distance, parce qu’ils ont bien compris qu’il ne s’agissait pas d’eux. On a tous souffert en se rendant compte de l’immense machine dans laquelle on a été embarqués.
Le livre ne risque-t-il pas de donner une image négative de votre mère?
Ma mère me lisait des histoires et ne ressemble pas du tout au monstre décrit dans le livre. Le personnage est un mélange de plusieurs mères que j’ai observées. Ça s’est imposé à moi de laisser venir une part de fiction. J’aime trop mentir, inventer, pour m’en tenir à un témoignage. Déjà petite, je gonflais toujours mes histoires.
Avez-vous rencontré d’autres frères et sœurs de qui se sont reconnus dans la situation que vous décrivez?
Je reçois des témoignages de plus en plus intéressants. Des gens me parlent de leur difficulté quand tout tourne autour d’une personne, que même les vacances dépendent des possibilités d’entraînement. J’ai aussi lu le témoignage d’une mère qui pratiquait un sport à haut niveau et trouvait formidable que toute sa famille la suive, sans se demander si ses proches en avaient réellement envie. Je n’ai de réponse à rien, c’est déjà un grand pas si on peut se poser plus de questions. Beaucoup d’anciens gymnastes deviennent entraîneurs, comme s’il leur était impossible d’en sortir. Ce qui me dérange le plus, c’est la certitude de faire juste.
Notre société condamne sans pitié toute forme de jalousie. N’y a-t-il pas pourtant une forme de jalousie saine et légitime?
Je pense que oui. C’est humain, on ne se fait pas du bien à vouloir masquer tout le temps ce genre de sentiments. Ce n’est qu’en la laissant s’exprimer qu’on peut la dépasser.
En choisissant l’écriture plutôt que le sport, avez-vous réussi à échapper à toute forme de compétition ou rencontrez-vous là aussi une pression au succès?
Non, ça m’embête qu’on ne parle que de Joël Dicker, je serais vraiment malhonnête de prétendre le contraire.





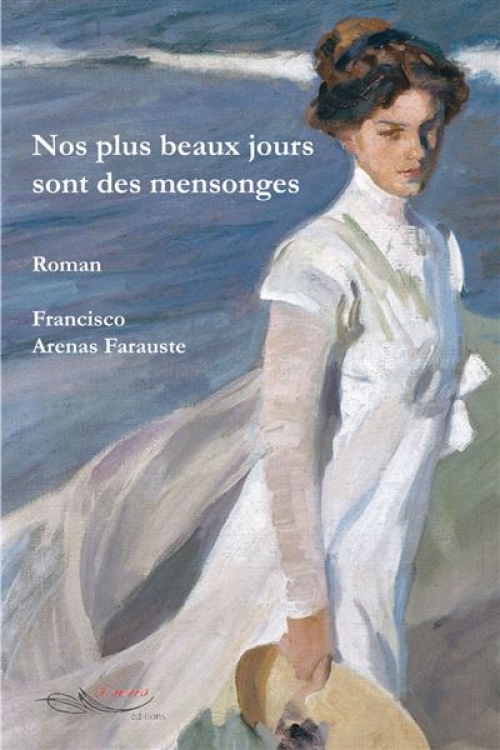



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire