Culture / Au grand débarras de mémoire, «Le vieil incendie» nous réchauffe
Petit ouvrage au grand pouvoir de suggestion et d’émotion, le quatrième roman d’Elisa Shua Dusapin nous parle en profondeur de nos vies avec une foison de détails qui ne disent, de loin, pas tout, nous invitant à combler ses secrets ou ses vides, ses hésitations ou ses manques, par les nôtres, les vôtres et les leurs...
Faut-il parler d’un livre parce qu’on en parle? Faut-il souscrire forcément à une adhésion que précède ou suit une flopée de prix littéraires, telle que la connaît ces jours la jeune Elisa Shua Dusapin, ou s’en méfier comme d’un effet de mode ou de conformité? Faut-il seulement lire Le vieil incendie de cette autrice poursuivant un «sans faute» de carrière sûrement impressionnant, avec quatre romans à la fois bien distincts l’un de l’autre et comme tenus ensemble par un même ton, un même fonds, une même voix et une même papatte?
Perso, quoique de la vieille garde du «monde d’avant» dont parle notre compère Roland Jaccard, je ne me suis pas posé la question en (re)découvrant, quelques années après sa parution, le premier livre de dame Elisa, Un hiver à Sokcho, à l’époque où, très fan de séries sud-coréennes, j’avais eu la lubie d’apprendre le hangeul (langue coréenne démarquée du chinois au XVème siècle) et enchaîné avec la lecture des Billes du Pachinko, où j’ai cru retrouver la «touche humaine» et l’atmosphère, la légèreté de touche et l'émotivité incisive de mes feuilletons coréens préférés, sans parler des mémorables films d'un Lee Chang-dong rencontré naguère, notamment...
Bref, c’est par le texte seul, loin du flafla publicitaire, que je suis entré dans l’univers singulier de cet indéniable écrivain, dont le regard et l’expression s’aiguisent encore loin de ses demi-origines, sous le ciel du Périgord que les sangliers craignent moins que ces abrutis de chasseurs humains. A petites phrases efficaces, au présent de l’indicatif pour traiter le retour du passé refoulé: voici donc, avec son titre impossible, Le vieil incendie...
L'art de ne pas tout dire en se forçant au contraire
Pour résumer en quelques mots la story, comme on dit, de ce roman foisonnant de sous-textes, et sans crainte de faire du spoiling, comme on dit encore, vu que c’est écrit sur le dos du livre et qu’il n’y a qu’à coller le copié: «Après quinze ans d’éloignement, Agathe, scénariste à New York, retrouve Véra, sa cadette aphasique, dans la bâtisse du Périgord où elles ont grandi. Elles ont neuf jours pour la vider. Les pierres des murs anciens serviront à restaurer le pigeonnier voisin, ravagé par un incendie vieux d’un siècle. Véra a changé, Agathe découvre une femme qui cuisine avec agilité, a pris soin de leur père jusqu’au décès, et communique avec sa sœur en lui tendant l’écran de son smartphone»…
Cela pour l’inessentiel avant d’entrer dans le détail, passion d’Elisa Shua Dusapin, qui fait toute sa singularité, l’insolite fuyant comme un lapin sous les phares, l’incongru comme ces fromages qui mûrissent dans une cage à oiseaux avant que nous soit révélée la légende paternelle des pigeons en flammes…
«Laissons venir l’immensité des choses», disait un jour le considérable Ramuz. Et le lendemain son ami Cingria rétorquait: «Ça a beau être immense: on préfère voir un peuple de fourmis entrer dans une figue». Or Elisa Shua Dusapin est plutôt du côté des fourmis, dont elle sait l’effet que leur font le jus de citron. Sous ses yeux joliment bridés, le monde semble se débrider au point de nous sembler familier partout: ici dans le Périgord vert, mais aussi à New York, au bord d’un étang que surplombe la silhouette d’un château pareille à un escargot, à côté d’une cheminée pleine de livres ou dans les bras imaginaires d’un amant d’Agathe adolescente, dans les draps de son actuel boyfriend Irvin, sur les lettres posées sur l’eau de Philémon – merveilleux ahuri des lectures faites à nos kids – ou dans les pages de W ou le souvenir d’enfance de Perec dont la même Agathe prépare la fictionnalisation avec ses coscénaristes retrouvés le soir en visioconférence durant ces jours de fausse vacance dans le far-west forestier de France d’oc.
A la porte de leur maison d’enfance, premier détail ahurissant: que l’œilleton est à l’envers, à l’intention revendiquée du père, affabulateur comme on le verra, qui prétendait que les habitants de la demeure n’avaient rien à cacher au monde entier invité à voir là-dedans, comme par un œil de poisson agrandissant, «les plus belles personnes» qui fussent. Et la dialoguiste de saluer sa sœur à l’ouverture de la porte: «Salut.» Et Véra de répondre d’«un sourire trop grand pour sa bouche». Et le récit de s’amorcer d’un ton plutôt sec (on sent Agathe, pas vraiment sympa, sur la défensive face à sa sœur visiblement en quête de tendresse), et c’est parti pour le sondage (en douce) des gouffres intimes et extimes – il y a plein de grottes dans la région dont certaines ont des fresques rupestres encore fraîches du matin après 20'000 ans.
Les vraies questions restent sans réponses
Ce qu’on sait des gens les plus proches peut nourrir un roman, – et vous avez sûrement un voisin faraud genre aventurier sur le retour, comme le spécialiste du traitement des cuirs rencontré par Agathe dans le voisinage qui lui dit comme ça qu’elle devrait écrire sur lui –, mais c’est de ce qu’on ignore que les romanciers parlent le mieux, et c’est par ce qu’on ignore du père d’Agathe et Véra, plus encore de la mère en froide fuite, de la vraie nature de l’aphasie de Véra, de ce qui a jeté Agathe dans les bras d’Irvin, de ce que ressent vraiment Octave quand il retrouve «l’Américaine», que, mystérieusement, nous parlant en sommes de ce que nous ne savons pas de nos plus proches, voire de nous-même, Le vieil incendie, par delà tout symbolisme, nous touche, nous attache à ses demi-fantômes, nous découvre les beautés de «cela simplement qui existe», comme le disait encore Cingria, et fait de ce petit livre de rien du tout une espèce de grand poème d’amour.
S’il y a bel et bien du symbole, dans ce livre du grand débarras à fendre le cœur sans larmoyer pour autant, c’est évidemment que l’auteure l’a conçu comme elle a conçu la forme «journal» de son roman, d’un 6 novembre au 14 suivant. En écho à la bouleversante évocation de Perec – et je me suis aussi rappelé l’Enfance de Nathalie Sarraute ou les poèmes noués par la douleur de Sylvia Plath, autant que certaines séquences de l’incomparable résilience coréenne –, Le vieil incendie saisit pourtant, hors de toute référence, par sa magie propre que relancent les contes à dormir debout du père – et la poésie est partout présente dans la nature qui nous entoure, avec ses sangliers et ses dindons, le foie gras de Sarlat dont raffolait la femme de ta vie ou l’étang mystérieux qui s’étend sous nos yeux, etc.




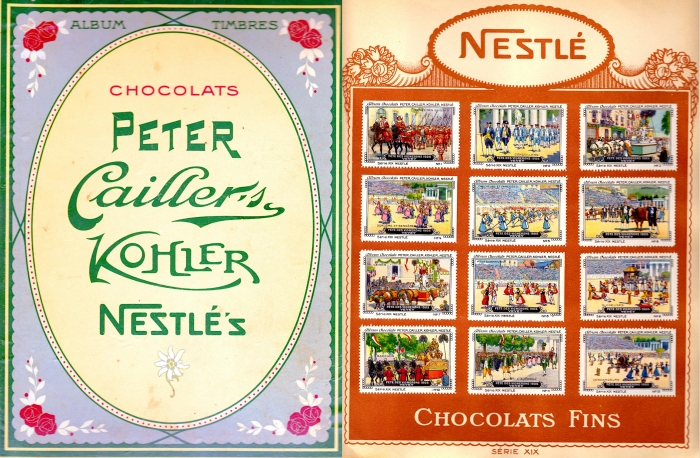

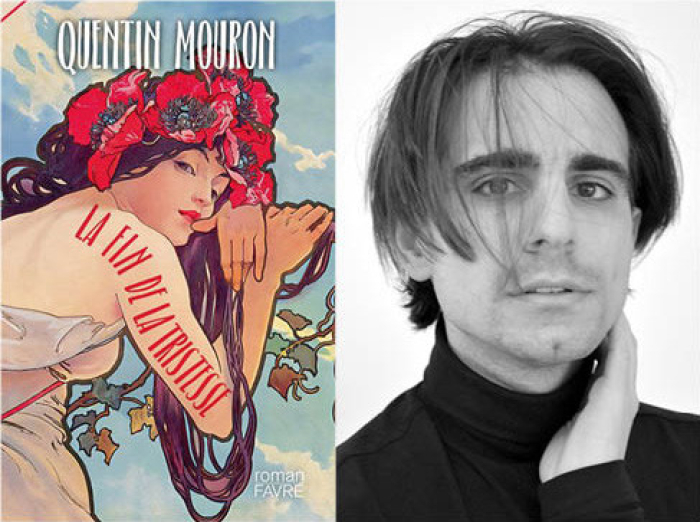
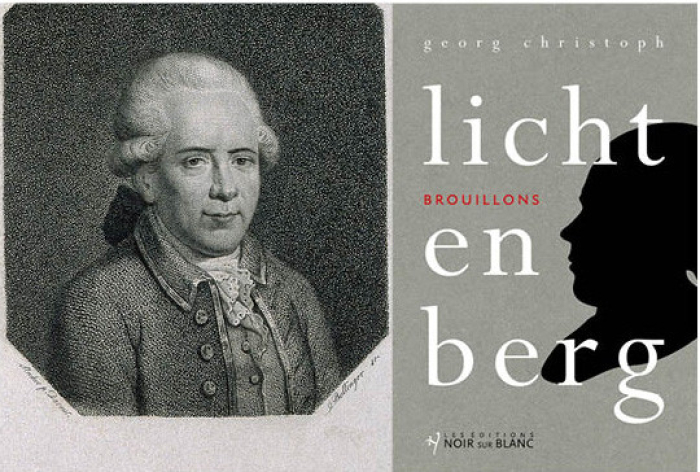
VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire