Actuel / «On ne peut pas toucher à la langue sans toucher à la personne»
Que représente, affectivement, telle ou telle langue dans ma vie? Quelle place pour l’intime dans l’apprentissage? Et pour la grammaire? Désormais diplômée et entrée dans le monde du travail, Fatma Sahindal a retrouvé sa professeure Hélène Pfersich, le temps d’un échange sur des questions trop peu souvent explorées.
Hélène Pfersich enseigne le français langue étrangère à l’École de français langue étrangère (Faculté des Lettres, UNIL). Son cours «De l’improvisation théâtrale à l’écriture» s’adresse à des étudiants non-francophones de niveau avancé en français (niveau B2-C1 dans le cadre européen des langues), avec déjà une bonne aisance dans la langue, mais très souvent paralysés par la peur de faire des fautes, inhibés, voire même paralysés à l’idée de prendre la parole en public en français. D’autres, comme les étudiants des Hautes Écoles Pédagogiques suisses alémaniques, viennent suivre le cours par intérêt pour cette approche créative qu’ils souhaitent intégrer à leur pratique de futurs enseignants de français. Le principe pédagogique est d’accompagner les étudiants dans la création, de faire en sorte que chacun grandisse au travers de son parcours dans la langue, dépasse ses blocages tout en apprenant le français.
Fatma Sahindal est quant à elle désormais acheteuse dans le secteur agroalimentaire. Elle a passé deux ans à l’École de français langue étrangère, où elle a vécu l’option «apprentissage de la langue par le théâtre» comme une divine surprise. Dans son répertoire langagier, Fatma Sahindal compte le kurde, le turc, l’allemand (le suisse allemand), l’anglais et le français. Cette dernière langue est à ses yeux un outil précieux pour s’épanouir dans l’entreprise francophone dans laquelle elle travaille également en anglais et en allemand. Cette année, elle fait par ailleurs un séjour linguistique en Italie.
Que représente le français pour vous?
Fatma: Je trouve tous les hommes qui parlent le français sexy (rires). Plus sérieusement, la langue est tellement jolie et attirante. On a l’impression que c’est une langue accueillante. Je serais bien née en français, si j’avais eu le choix.
Hélène: Moi je suis née en français, le français me définit. J’ai vécu en France jusqu’à l’âge de 20 ans. Mon père était excessivement à cheval sur la correction de la langue: on était constamment «repris». À l’adolescence, je ne parlais pas comme les autres jeunes, j’étais toujours en décalage. Je n’arrivais pas vraiment à m’intégrer parce que je ne parlais pas la même langue. Quand je disais «ces toilettes sont immondes», on me traduisait: «tu veux dire que ces chiottes sont dég, c’est ça?». Le français était comme un tuteur, rigide, un langage léché, qui m’a fait grandir d’une certaine façon, mais m’a aussi fait construire un rapport aux autres plutôt compliqué puisque je ne pouvais pas sortir de ce langage absolument léché. Quand je suis venue en Suisse romande, j’ai quand même connu une forme d’émigration, même si c’était la même langue. J’étais pleine d’enthousiasme, je suis aussi tombée amoureuse de la Suisse. J’étais pleine d’élans envers les gens, mais j’ai vu qu’ils restaient en retrait: j’ai compris que ma manière de parler attirait de la méfiance. J’aime l’aspect créatif de la langue pour sortir de mon carcan, que la langue soit à inventer, à réinventer. J’aime la souplesse de la langue, sa richesse, sa fantaisie, qu’elle fasse respirer, et sortir d’un corset.
Que représentent les mots pour vous?
Fatma: Écrire me fait du bien. Comme si sortir ce qui est à l’intérieur permettait de se lire. Parfois je ne savais pas ce que je voulais écrire et c’est Hélène Pfersich qui intervenait pour ouvrir une voie, et ma voix.
Hélène: Il fallait que Fatma trouve une forme assez forte pour transmettre ses émotions et son vécu. Pas n’importe quelle forme. Une forme qui permette de donner vie à ce qui était encore latent et un peu confus en elle. Parfois les étudiants sont bloqués, ne peuvent plus avancer dans leur travail et il faut alors leur rappeler leur projet initial, les ramener à ce qui est vraiment important pour eux. Et à ce moment-là le déclic se fait le plus souvent. En ce qui me concerne, paradoxalement mon regard critique est trop fort pour que je puisse pratiquer moi-même cette écriture. En revanche, chez les autres je peux discerner un potentiel et les guider pour réaliser ce qui est en germe. C’est étonnant cette différence.
Êtes-vous sensibles à l’évolution du français?
Fatma: J’essaie d’écrire «proprement»: les erreurs, l’absence de style m’agacent. J’essaie d’utiliser plusieurs registres, des mots variés, d’éviter les répétitions, de «soigner» la langue. Le respect de celui qui lit compte pour moi. Si on est clair dans nos propos, ça facilite le travail de l’autre. L’argot, par exemple, ça va, je le comprends assez bien, mais c’est évidemment plus difficile si on n’est pas en contact avec les jeunes qui le parlent. Sinon j’avoue que, au travail, j’ai tendance à «corriger» mes collègues, je discute beaucoup avec eux, d’orthographe notamment; j’ai aussi du plaisir à leur apprendre des choses sur l’histoire du français. Et en général, ils le prennent bien.
Hélène: Quand c’est un langage argotique, jeune, ou réinventé, ça me va, d’ailleurs mes propres fils peuvent utiliser des phrases comme «c’est pire bien». Même si la syntaxe est maltraitée, ça me fait rire. Mais je n’arriverais jamais à parler comme ça, même sous la torture. Il y a des tournures impossibles pour moi, des mots que je ne prononcerai jamais. Mais ce que je déteste surtout, c’est quand le langage est snob, affecté, gonflé de tournures vieillies, employées parfois pour humilier ceux qui ne les maîtrisent pas. Quelqu’un qui va enseigner des tournures qu’on n’utilise plus, je trouve ça ridicule. J’aime quand le langage est riche, l’expression claire, la mélodie belle.
Y a-t-il un livre en français qui vous a particulièrement marquées?
Fatma: L’œuvre d’Amin Malouf, parce que cet auteur apporte une réponse culturelle à mes besoins au travers de sa réflexion sur l’identité.
Hélène: Œdipe sur la route, d’Henri Bauchau, écrivain et thérapeute. Ce livre associe création et reconstruction personnelle. On y découvre comment un homme qui s’est crevé les yeux de désespoir peut se reconstruire après un désastre absolu. L’art de la parole est utilisé jusqu’au pardon à soi-même.
La grammaire est-elle indispensable pour apprendre une langue?
Fatma: Je ne me suis jamais basée sur la grammaire pour apprendre une langue. La grammaire m’a même parfois découragée. C’est un peu comme les maths: si on saute un sujet, on ne comprend plus rien. J’ai besoin de ressentir, de sentir la langue, de vivre dans cette langue, de l’entendre. Ce qui marche selon moi, ce sont les phrases fabriquées dans la classe, élaborées par les étudiants. La grammaire ne m’intéresse que parce que j’utilise le français, que je m’écoute le parler et peux avoir besoin d’outils pour améliorer «ce qui sonne mal», pour mieux comprendre le fonctionnement de la langue, trouver des explications par moi-même. Il m’a fallu cinq langues pour aimer la grammaire, surtout pour comprendre l’utilité de cet outil. Apprendre une langue est comme une maladie. Imaginez-vous que vous êtes blessé à la cheville ou au genou. Bien sûr que vous pouvez marcher malgré les douleurs que vous ressentez. Mais marcher avec des béquilles vous permettra de guérir plus rapidement. L’italien est la seule langue où j’ai commencé à aimer la grammaire. Maintenant, pour moi la grammaire est comme un jeu ou comme les maths. Je n’aurais jamais pensé à dire une chose pareille. Mais j’ai eu même le plaisir d’apprendre la grammaire. Je n’ai plus peur de cet outil.
Hélène: Personnellement, j’ai horreur de la grammaire enseignée de manière réductrice et décontextualisée, par exemple uniquement à travers des exercices à trous ou des listes de règles et d’exceptions à apprendre. Par contre si cela devient une réflexion commune avec les étudiants qui se mettent à observer, chercher à comprendre le fonctionnement de la langue et de son évolution, et expérimenter des formes, cela m’intéresse. Dans ma vie, j’ai eu la chance de profiter de la didactique innovante du lycée-pilote de Sèvres qui entendait enseigner sans grammaire, à travers des approches créatives. J’en ai bénéficié de l’âge de 13 à 18 ans, donc il y a longtemps, de 1968 à 1973. Nous étions dans ces années de contestation et de bouleversement de l’ordre établi, notamment dans l’enseignement. Pour ma part, cette approche m’a sauvée de l’école que je détestais, m’a enthousiasmée et a permis que se développe mon amour pour la littérature française et l’apprentissage des langues. Mais par la suite, ces méthodes d’enseignement audacieuses ont suscité trop d’inquiétude et de résistance chez les parents, les autorités etc. et petit à petit cette approche novatrice a été abandonnée. Ce lycée a perdu toute notoriété et tout prestige à l’heure actuelle je crois.
Donc durant toute ma scolarité je n’ai jamais suivi le moindre cours de grammaire ou d’orthographe. On écrivait des romans, on faisait de l’improvisation théâtrale. Cela m’a entre autres familiarisée avec une approche des textes comme «ressources».
Y a-t-il une place pour l’intime dans des études de langue?
Hélène: Dans mes enseignements, c’est l’aspect «jeu» qui domine, pour vaincre les peurs qui pourraient inhiber les étudiants, leurs barrières. Il s’agit dans mes cours d’utiliser le corps. Cela peut libérer des étudiants qui n’osent pas parler. J’ai animé des ateliers d’écriture créative pendant 10 ans avec divers publics. Il s’agit de trouver une textualisation de quelque chose qui va ensuite être oralisé, prononcé, joué, appris par cœur, tout en étant capable de pouvoir raconter une histoire. Ça introduit une liberté et du plaisir – tout en respectant une structure –, dans l’apprentissage, dans la langue, et dans l’individu. J’ai commencé par faire apprendre des scènes classiques. Mais c’est tellement plus intéressant si les étudiants écrivent eux-mêmes une scène, voire toute une pièce pour un travail approfondi. On va puiser dans les ressources de la langue, mais simultanément dans celles de la personne. Tout ce qui est appris dans un tel cadre fait sens pour les étudiants. La motivation est donc maximale. Et souvent, comme on exprime des choses très personnelles, l’émotion est pleinement intégrée à l’enseignement. Cela suppose évidemment une grande responsabilité: en tant que prof, on est garant du bien-être de chaque étudiant, de sa sécurité. Personne ne doit être humilié. Peu à peu, la confiance permet une émergence.
Fatma: J’avais fait du théâtre pendant deux ans, en turc. J’avais envie d’essayer en français. Je n’ai pas peur de parler devant les gens. Mais dans une langue étrangère, il y a toujours la crainte des jugements. À l’EFLE, j’ai pu m’exprimer en toute liberté. Je n’ai jamais ressenti de jugements ni des profs, ni des étudiants. C’est vraiment ici que j’ai parlé le français le plus librement. J’ai apprécié le plaisir de créer quelque chose depuis le début. On découvre des mots, des phrases complètes, des expressions que l’on réutilise parfois après. Il m’est arrivé de composer un texte à partir des formules apprises au cours de théâtre. Mais on découvre aussi la solidarité entre étudiants. Grâce au cours de théâtre, on se décentre en jouant des rôles qui nous amènent à tester d’autres pratiques culturelles, d’autres rituels de politesse par exemple. Je me souviens d’une scène par exemple, dans laquelle une étudiante brésilienne jouait un rôle de vendeuse. Elle avait pour réflexe de toucher systématiquement la cliente. Elle a découvert grâce au cours que cette familiarité n’était pas dans les habitudes suisses et pouvait troubler. Cette approche de la langue est basée sur la confiance. Les encouragements nous amènent à dépasser nos limites. Me reposer sur cette confiance m’a permis de «m’autoriser».
Comment concevez-vous les rapports entre langue et identité?
Fatma: C’est la sociolinguistique qui m’a permis de comprendre beaucoup de choses qui étaient en moi, et qui demandaient des réponses. Aucune langue n’est un pur outil de communication. Une langue est un «acteur» qui fait surgir d’autres enjeux. En Suisse romande, je représente la Suisse allemande et en Suisse allemande, je représente la Suisse romande. On ne me regarde plus comme turque ou kurde. Au travail, je suis plutôt une «étrangère suisse» qu’une étrangère venant d’un autre pays. Dans la société, c’est un capital que de maîtriser des langues nationales. Une forme de pouvoir, qui induit le respect. Et pour moi, m’approprier le français a aussi été une sorte de thérapie.
Hélène: Les étudiants expriment beaucoup de joie, de fierté, et de reconnaissance. Ils parviennent à traiter des problématiques douloureuses, personnelles, intimes. Ils constatent qu’ils ont dépassé leurs limites, qu’ils ont acquis des compétences qu’ils n’auraient même pas imaginées. Certains disent arriver à être enfin eux-mêmes grâce à cette approche créative. Ils apprennent à jouer avec la langue, leur corps, à oublier la notion de «faute». Ils oublient même qu’ils parlent une langue étrangère. Les étudiants ne choisissent pas la facilité. Ils choisissent de se confronter à quelque chose de dur. Et ce fait de dépasser un trouble émotionnel, identitaire, c’est un cadeau en plus.







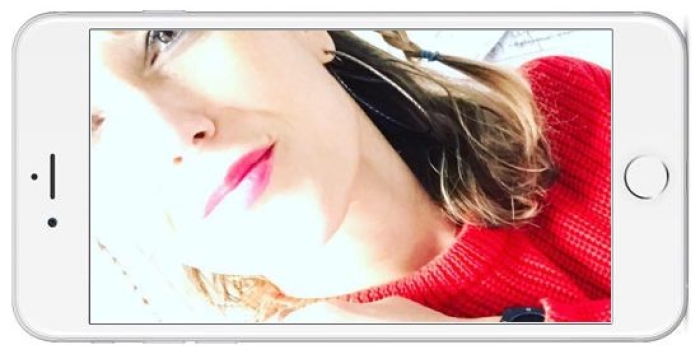
VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire