Actuel / Chairissons-nous
J’ai rempli tout le printemps des corbeilles à papier et d’ordinateurs de chroniques avortées sur les relations «amoureuses». Le sujet étant un des marronniers médiatiques les plus déclinés (les plus échauffants) de l’été, je m’y suis remise pendant mes vacances. Mais cette fois, sur le terrain.
24 heures parisiennes sur le réseau de rencontres Tinder. J’ai commencé par arranger, tricher, inventer. 34 ans. Mon second prénom. Et des accroches écrites par un ami metteur en scène. Productivité maximale: des centaines de photos mâles ingurgitées; autant d’appâts – photoshopage, bronzage, acrobaties sur paddles, skis ou vélos et torsions abdominales – régurgités. Et une quarantaine de matchs (accouplages virtuels) et interpellations: «Qu’est-ce qui te fait vibrer?»; «Sympa ta couleur de cheveux»; «Jolis tatouages».
Mon complice théâtreux en verve a piloté les répliques: «Tu sais, t’es pas terrible sur tes photos. Tu n’en aurais pas une autre?»; «Là je suis avec un mec déjà, mais s’il s’y prend mal, je reviens vers toi»; «Tu veux pas qu’on baise ce soir?». On a noyé dans de la limonade quelques réponses «énervées», deux ou trois déconnexions, et un sexe en contre-plongée.
Puis l’expérience s’est vue détournée. Des garçons un peu tentants, quand même. Mon ami qui orchestrait le jeu finalement agacé: «C’est écœurant tous ces gars, là, qui te désirent». Mon éthos de chercheuse essoufflé. Le déclic: un message-type pour confesser: «Je n’ai pas 34 ans, Blanche n’est pas mon premier prénom, les messages ne sont pas de moi, pardon, je suis là pour une chronique. J’ai un profil Facebook. Au cas où». Résultat final, trois élus transférés sur ce réseau social moins connoté: un intéressé («Tu saurais quel magazine publierait mes photos de montagne?»); un dévergondé («Ca t’excite que je me branle pour toi ?»); et un diable («Moi aussi je suis jeune, beau et effronté»; «Ma voix? Je pense qu’elle pourra te plaire»), qui a liquéfié ma bonne conscience, mes préjugés et tout fil conducteur bégueule de type «Amour, sexe et patriarcat».
Guillemets à «amoureuses»
J’ai tout repris moins méthodiquement. Plus frontalement. Plus organiquement. Je m’embourbe dans mon sujet depuis des mois parce qu’aucune mise en discours des relations «amoureuses» ne me rassasie. Je mets des guillemets autour d’«amoureuses» parce que je serais bien incapable, comme on me l’a pourtant religieusement appris, de ranger dans des boîtes étanches amour, sexe et amitié. Et j’ai rempli des tas de poubelles, parce que je ne suis pas dupe; écrire qu’on veut tout changer, ça ne revient en général qu’à tout double-verrouiller. Alors quoi?
A coups d’inhibitions successives, plus ou moins explicitées et contraignantes (on appelle ça «processus de socialisation»), je me suis construite comme une fille qui aime les garçons, parfois charnellement, mais pas trop, question de réputation. Et j’ai discipliné mon corps pour qu’il s’en tienne aux normes (de sexe, de genre, pondérales, vestimentaires, etc.) alentour. A 40 ans, à coups de désinhibitions successives (rencontres, conversations, lectures), je suis devenue une femme qui côtoie des êtres humains faits comme moi de fluides, de nerfs, de sentiments, de peau, de peurs, d’émotions, de fantasmes, de disgrâces, de sang, d’eau, de colères, d’incohérences, de perversion, de vulnérabilités, de chair. Et j’ai compris qu’au lieu de le dresser, il me fallait au contraire «tordre» mon corps, comme je tors ma langue, pour trouver un langage qui fasse émerger ma voix «écologiquement».
Je m’explique: j’adhère à l’hypothèse que développe le philosophe Bernard Andrieu dans son essai Sentir son corps vivant. Emersiologie I (Vrin, 2016): «L’écologie corporelle est une microécologie. C’est en transformant la conscience des pratiques corporelles des individus qu’on transformera l’écologie du monde. L’idée est d’expérimenter en situation des modifications de pratiques sensorielles. Pour sentir différemment son environnement, il faut consentir à se déroutiniser pour faire émerger dans son corps vivant d’autres modes d’existence, de déplacement et de relation».
A 40 ans, je consens à me déroutiniser. Je me refuse à amalgamer couple, famille, amour, sexualité. Je suis entourée de représentations sclérosantes des relations «amoureuses» que je ne peux pas éradiquer, mais j’ai pris conscience que je peux modifier mon rapport – et mon obéissance – à ces stéréotypes. Et cerise sur l’autonomie, j’ai la liberté de baptiser l’amour qui me va: «chairir».
Une sensation de confiance dans le ventre
Non, «chairir» ne se trouve pas dans le dictionnaire: c’est un néologisme. Un verbe transitif, dont le sens global est calqué sur son homophone, «chérir»: selon le Robert, «aimer tendrement», «être attaché à», ou «attacher un grand prix à quelque chose». Mais «chairir», avec l’«ai» de la «chair», c’est chérir en présupposant une action du corps dans le monde et en intégrant dans ses expériences l’action du corps des autres dans ce même monde. «Je chairis», «tu chairis», «ille (tant qu’à désencager) chairit», «nous chairirons», «vous avez chairi». Et je peux me chairir, chairir un amant, un amoureux, mon fils, un confident, un mentor, mes parents, mais aussi tous ces inconnus qui marchent ou dorment ou s’abîment dans nos rues et dont les corps sont lourds de la considération dont on les allège.
Le philosophe Vincent Cespedes rapporte dans son essai Mélangeons-nous. Enquête sur l’alchimie humaine (Maren Sell Editeurs, 2006), un échange de 1963 entre Ernie Barry et Allen Ginsberg, balayant la réduction de «l’amour relationnel» à «l’appétit charnel». Ernie Barry: «Qu’est-ce que tu veux dire par «amour»? Baiser?» Allen Ginsberg: «Non, une sensation de confiance dans le ventre, d’encouragement à Être qui pourrait conduire à se frotter les ventres les uns contre les autres, à s’embrasser les oreilles et à faire toutes sortes de choses délicieuses, y compris des bébés… Le frottement des ventres est instinctif. La tendresse entre les gens est une relation instinctive normale». «Chairir» dit cette confiance et ce frottement des ventres, ces tendresses instinctives. «Chairir» contourne les réseaux de binarités (hétéro)normées qui couvrent de théories et d’angoisses toutes les sortes de choses délicieuses (des plus platoniques aux plus audacieuses) évoquées par le poète de la Beat Generation.
Le diable, si chairissable, qui m’a sortie de ma zone de complaisance en dégommant mon kit d'attitudes très académiques mais confortablement condescendantes face à Tinder, me souffle qu’il se félicite d’avoir métamorphosé ma chronique en cette incitation: «Chairissons-nous».







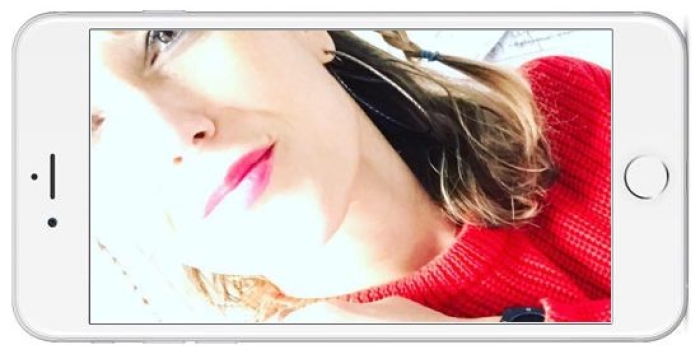
VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire