Culture / Lire ou ne pas lire Bruno Le Maire?
Un soir de mai, à Lausanne, amusé par les extraits épicés qui circulaient sur Twitter depuis des jours, un collègue et ami de BPLT me désigna comme la personne indiquée pour parler du dernier roman de Bruno Le Maire: «c’est ton ministre de l’Economie! tu sauras qu’en dire mieux que personne...» La taxe «française», dont je m’acquitte ici de bonne grâce.
Le lendemain, me maudissant déjà d’avoir accepté, je me faisais accompagner d’un autre ami, direction la librairie Payot de Lausanne, pour me donner du courage. 470 pages, 36,20.-, furent les deux informations qui me frappèrent, sitôt que la libraire avait rapporté un exemplaire de Fugue américaine, déjà planqué dans les rayonnages. L’ami, lecteur avisé des étiquettes, m’apprit que Payot n’en avait commandé que 3. Le public suisse n’était sans doute pas prêt pour la prose de «mon» ministre de l’Economie.
Que d’eau...
Premier constat, assommée par le pavé: il a donc du temps. A peine la cinquantième page atteinte, je tâchai d’aller au renseignement: est-ce vraiment lui, le ministre, qui écrit ses romans? La version officielle est que oui. Le Maire affirme que l’écriture est sa passion, son oxygène, et qu’il a travaillé dix ans à ce roman, le cinquième en quatre ans. Ne l’imaginons pas délaisser ses obligations économiques pour peiner des jours et des nuits sur la page blanche.
Effectivement, le roman traine en longueur. Par une licence narrative usée, le narrateur original présente dans les premières pages un manuscrit adressé par son oncle Oskar. Il faut donc blâmer Oskar pour avoir étiré à l’infini cette intrigue. Dépouillée de ses délayages romanesques, érotiques et érudits, la voici: Oskar, un psychiatre américain d’origine juive allemande parvenu au crépuscule de sa vie, rédige ses mémoires dans un hôtel berlinois. Il y est question de son frère Franz, pianiste raté, dépressif, suicidé quelques décennies auparavant, et de leurs souvenirs communs. Le premier, en 1949, est un concert de Vladimir Horowitz donné à La Havane, puis la rencontre entre Oskar, alors jeune étudiant en médecine, et «Satan au clavier». Leur relation s’étire jusqu’à la mort d’Horowitz. L’histoire de deux frères que dix années séparent, tiraillés entre le rêve américain que leurs parents, émigrés allemands des années 30, les poussent à épouser, et l’oubli tragique de leur culture européenne.
Frères et doubles
Ces thèmes servent de cadre à de très nombreuses et longues digressions. Les conversations entre l’apprenti psychiatre et son célèbre patient, les habitudes capricieuses et les relations homosexuelles non assumées de ce dernier, puis ses dépressions et retours à la scène successifs, la présence de son épouse Wanda, en forment une grande partie.
Le roman est construit en miroir. Un jeu de masques entre public et privé, entre fêlures et succès, entre aussi, pourquoi pas, le ministre et le romancier qui tiennent la plume.
A la vie et à la carrière triomphale mais torturée d’Horowitz répond l’échec sur toute la ligne de Franz. Un soir, à La Havane, Oskar demande à Vladimir Horowitz de donner une leçon de piano à son frère. Le début de la fin pour Franz, qui, écrasé par le génie du maître, décide à ce moment précis d’abandonner sa carrière naissante de soliste.
Oskar, qui parle souvent de lui à la troisième personne, se trouve au point de fuite de deux trajectoires symétriques. Il n’a pas fondé de famille, pas même un couple stable, il est l’exilé suprême, ses seules racines sont son travail, ses souvenirs et Vladimir Horowitz. Après une illumination mystique dans une église de La Havane, il passe le reste du siècle à déplorer que les idéologies meurtrières et la musique, pour ceux qui peuvent y avoir accès, aient remplacé le Dieu du ciel.
Autour de lui, deux exilés dont les portraits se répondent. Franz, fils d’émigrés, et Vladimir, né à Kyiv (ou à Berditchev, selon les biographies et ses déclarations), à la fois russe et ukrainien. Deux pianistes, deux grands névrosés, deux hommes dévorés par leurs démons. L’un écrasé par le génie, renonçant au piano, l’autre incarnant le génie, par-delà bien et mal, s’exorcisant lui-même. Deux trajectoires divergentes aussi devant le rêve américain des années 1950. Horowitz, superstar richissime, enfermé dans son hôtel particulier de Manhattan, Franz, mauvais agent immobilier ruiné par la passion de sa femme pour les fourrures et ses mauvais investissements, contraint de s’endetter et de prêter sur gages les bijoux de sa mère. Dans ces deux hommes qui, sur le papier, se ressemblent tant, tout diffère en miroir. Horowitz est marié à Wanda Toscanini, la fille du célèbre chef d’orchestre. Franz, lui, a épousé une émigrée française, Muriel Lebaudy, pétulante et ambitieuse, trop forte pour lui. La scène de leur mariage montre l’abysse qui sépare les deux époux comme les deux belles-familles. «(Franz) descendit encore six ou sept coupes de champagne. D’où leur venait ce goût de fer? La tête lui tournait. Il chercha Muriel. Elle continuait ses salamalecs sous-marins dans cette salle trop basse de plafond. Au milieu de son visage ruisselant de fard, sa bouche accomplissait des mouvements de dilatation et de contraction comme une anémone de mer effleurée par les courants. Quel plancton verbal pouvait-elle avaler avec autant d’avidité?»
Oskar fera son choix, un fratricide qu’il ne se reproche qu’à moitié. Il refuse de souscrire au motif d’Abel et Caïn mais c’est pourtant ce que son histoire renvoie. C’est bien pour se sauver lui-même et son patient qu’il abandonne son frère à son sort; et semble même soulagé d’apprendre qu’après des années de dépression psychotique, de délire épistolaire, il s’est jeté des fenêtres de l’ancien appartement familial, le jour de l’assassinat de John F. Kennedy. Un échec de plus...
Le sujet est inépuisable, comme la litanie des génies du XXème siècle pris en étau entre l’Est et l’Ouest, ballottés par l’exil, déracinés et maladroitement greffés sur d’autres terres. Ainsi trouve-t-on dans cette histoire de doubles des doubles enchâssés. Telle la passion soudaine de Franz pour l’autre grand pianiste du temps, Sviatoslav Richter, l'opposé d’Horowitz tant dans ses interprétations que dans son rapport au public, tout aussi fou mais d’une autre folie.
Le cul de Julia et des autres
Fugue américaine est un roman d'hommes. C’est grosso modo le reproche médiatique plutôt fondé qui lui a été fait. On a beaucoup glosé et ricané sur le «renflement brun de son anus», l’injonction «Tu viens, Oskar? Je suis dilatée comme jamais». On s’est esbaudi du désormais culte «quand est-ce que tu m’encules?»
Mais au-delà?
Sortie dans la même «séquence» médiatique que Marlène Schiappa dans Playboy, cette association pas forcément bienvenue entre sexe et politique est en réalité des plus classiques. Pourquoi vouloir la mettre en avant? Volonté de «choquer le bourgeois», ou de faire parler de soi en allumant un contre-feu dans la crise politique que la France traverse? Peut-être, excepté que cela ne choque plus aucun bourgeois, et que ces méthodes sont aussi démodées que le porno-chic. Il n'y a d'ailleurs, de nos jours, rien de moins choquant que le sexe hétéro. S'étonne-t-on alors que le ministre connaisse les choses de la chair? Ce dernier déplore les attaques de la «moraline». Il semble que les indignés du renflement brun s'inquiètent plutôt de ce que cela dirait, ou ne dirait pas, de la France.
Un coup d'éclat que l’on a dit très déplaisant pour le Président, sans doute aussi aux yeux de la sévère Elisabeth Borne, même si Le Maire assure que la date de sortie n’a été dictée que par l’agenda de Gallimard. L’opposante Sandrine Rousseau, elle, a malicieusement noté que le ministre semble ignorer la place et la fonction du clitoris dans ses descriptions enflammées.
De fait, la place des personnages féminins et l’importance donnée à leurs corps interpelle.
Muriel, l’épouse de Franz, est l’occasion de morceaux de misogynie particulièrement piquants, on l’a vu dans le passage cité ci-dessus. Perçue comme désirable par Oskar, elle est aussi la cause de la dépression de Franz, le ruinant avec ses aspirations à la richesse, et finalement, sa liaison avec un entrepreneur italien. Maîtresse de maison irritable mais bonne mère, Muriel n’est pas grand-chose d’autre dans le roman. Elle forme elle aussi un duo en miroir avec Wanda Toscanini, la femme de Vladimir Horowitz. Elle, avec ses petits chiens, son fume-cigarettes et ses remarques acerbes à son mari, est l’épouse idéale du génie. Le couple ne vit pas ensemble, se déchire dans de théâtrales scènes, mais in fine, Horowitz dira ne pas pouvoir vivre sans Wanda. Cette dernière demeure la fille de son père et l’épouse de son époux, en dehors de ces deux ascendants masculins, elle n’est rien. Julia, c’est le pur objet du désir. Elle est ses fesses, ses seins, sa bouche et ses cheveux, elle est le désir que ressent Oskar, puis Pablo, pour elle. Certes les scènes de sexe pourraient la faire passer pour une femme libre, à l’aise avec son corps... Elle n’est précisément qu’un corps. De même que Sarah, autre maîtresse d’Oskar, pur prétexte à d’autres ébats et mots crus.
Cela étant, faire au ministre un procès en misogynie serait une erreur. Nous lisons le roman de Bruno Le Maire, pas un programme politique, et ce serait méconnaître l’essence même du roman que d’aller chercher dans cette fiction le moindre début de discours. De quoi auraient l’air, d’ailleurs, des morceaux de bravoure féministes sous la plume d’un personnage comme Oskar?
Bien plus obscènes, moins racoleuses, plus littéraires et plus choquantes car pensées et écrites comme telles, sont par exemple les pages consacrées au bien nommé père Culp, prêtre pédophile de son état, qui officiait dans l’école des jeunes Franz et Oskar. Plus réussies, aussi, dans le but qu’elles visent: horrifier.
Un violon d'Ingres comme un autre
Le ministre a-t-il sa place dans la prestigieuse collection blanche de Gallimard? Après lecture extensive, notre avis est qu’il n’y est pas dépareillé. Il y a de belles pages dans cette Fugue américaine, en particulier sur Cuba, les rues de La Havane, leurs odeurs et leur pluie chaude. Le sujet, exigeant, n’est pas traité par-dessus la jambe, c’est le moins que l’on puisse dire. Le récit est construit, travaillé, et le style d’Oskar, puisque c’est lui qui écrit, modelé sur celui d’un nonagénaire revenu de tout, sauf de son passé.
Sous d’autres latitudes et peut-être même en France en d’autres temps, on s’enorgueillirait d’avoir pour ministre de l’Economie un homme qui connait son Horowitz jusqu’au bout du nœud papillon, est capable d’exposer les différences de son jeu avec celui de Richter, de digresser sur la sonate Waldstein, le désenchantement du ciel, et de placer deux fois le mot Dasein dans un roman sur l’exil des Juifs allemands aux Etats-Unis. Reconnaissons que cela a de la gueule. Certes, Le Maire écrit (et se regarde écrire) quelquefois comme dans une dissertation du concours de Normale Sup. Certes, quelques âneries sont agaçantes, comme la mention du «martèlement des marteaux»... qu'on lui jette la première pierre. Certes il mêle l’allemand, l’anglais, l’espagnol et l’italien sans jamais traduire ces incises, indice au mieux d’une forme d’exigence, au pire d’une pédanterie que l’on ne cessera jamais de reprocher à la «Macronie», quoi qu’elle fasse. Mais «mon» ministre, à l’issue de cette lecture, est loin de me faire honte.
Que le lecteur me pardonne, en revanche, si je passe mon tour le jour où Guy Parmelin révélera lui aussi que le roman est son violon d’Ingres.





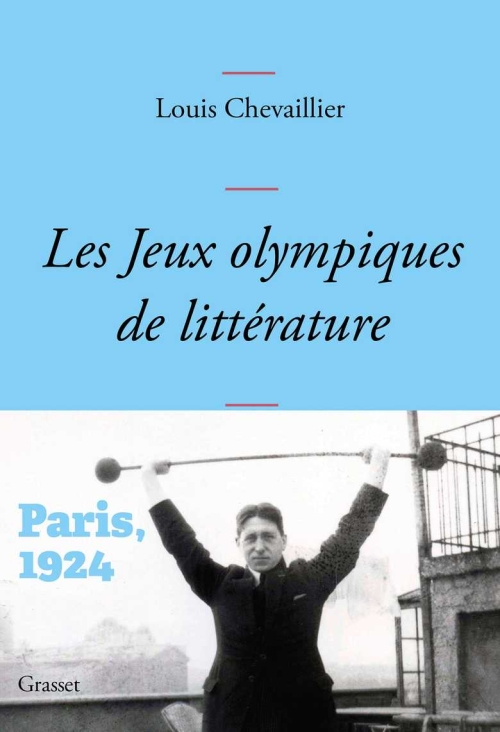



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire