Actuel / «Je n’ai pas grandi dans un ghetto, j’en suis reconnaissant au Jura et à la Suisse»
Il a d’abord été correspondant de l’Agence télégraphique suisse à Neuchâtel. Puis de l’Agence France Presse à Montevideo, en Uruguay, suivi d’un poste à Washington au sein de la même maison. Il est aujourd’hui basé au siège, à Paris. Le Jurassien Antonio Rodriguez, né en 1966 à Delémont de parents venus de Galice en Espagne, a une pensée pour eux en découvrant, du «Figaro» à «Paris Match», le bon accueil réservé aux «Larmes de ma vigne», témoignage à vif d’un vigneron chablisien adepte de la production biologique, auquel il prête une plume toute ramuzienne.
Avant de plonger dans les heurs et malheurs de la viticulture bio, Antonio Rodriguez a écrit deux précédents ouvrages: l’un sur l’ancien ministre Arnaud Montebourg, «L’alternative Montebourg», l’autre sur un chef pompier de Saône-et-Loire, Romain Comte, «L’appel des sirènes». Marié, père de deux filles, celui qui d’habitude se retranche dans l’anonymat du journaliste agencier, raconte ici son beau parcours, de son enfance delémontaine au temps des initiatives Schwarzenbach et du combat jurassien, à sa vie d’adulte, livrant des souvenirs émus ou drôles, donnant sa vision, «à titre personnel», de la politique et de l’économie. Interview d’un ami d’école.
Tes trois livres nous parlent d’une France de l’intérieur, travailleuse, volontaire, modeste. Pourquoi t’es-tu intéressé à cette France-là?
Les notions de travail, de courage et d’engagement sont importantes à mes yeux. Dans la chronologie de ces trois livres, il y a une évolution et un changement de perspective entre le premier d’entre eux, «L’alternative Montebourg», paru en 2016, et les deux suivants, dédiés à des individus placés à l’écart des projecteurs, le chef pompier Romain Comte et le viticulteur Denis Pommier, auquel il faut associer sa femme Isabelle. Le livre sur Montebourg, avec les cas épineux des hauts-fourneaux en Moselle et du groupe Alstom à Belfort, a été pour moi une façon de me jeter à l’eau comme journaliste. Une fois terminé, je me suis rendu compte que j’avais écrit un livre épousant un schéma classique en France, quelque chose partant de Paris pour aller en province. Une façon de parler des gens de haut en bas.
Tu as tenu à rompre avec ce schéma.
Oui. Mon intention, après Montebourg, était de faire l’inverse: aller trouver des gens, pas forcément connus, mais qui avaient une fonction, un rôle. Ce faisant, de restituer leur quotidien, de faire remonter les enjeux. En côtoyant le chef pompier Romain Comte, j’ai découvert, je le dis ici avec une certaine naïveté, que partout en France, des individus équipés d’un bip sont prêts à venir vous secourir à tout moment du jour et de la nuit. Avec Denis Pommier le vigneron, mon propos était le même : sa bouteille de vin bio, on s’en régale dans les milieux urbains, à Paris, Delémont ou Neuchâtel, mais on est loin de se rendre compte de la somme de tracas, de doutes, de nuits d’angoisse qu’elle contient. Je me suis attelé à décrire cette nature que l’on vénère, mais qui peut être tellement ingrate avec ceux qui la respectent le plus.
«La route de la mort»
Dans «L’appel des sirènes», tu évoques cette route de sinistre réputation passant par la Saône-et-Loire du chef pompier Romain Comte, la RCEA, la route Centre-Europe-Atlantique.
La route de la mort, c’est ainsi qu’on l’appelle. En 2017, l’accident d’un car transportant des Portugais qui rentraient en Suisse avait fait quatre morts. Romain Comte avait été l’un des premiers sur les lieux du drame. Ce tragique fait divers m’a replongé dans mon enfance. La RCEA était la route que je prenais avec mes parents pour aller en vacances en Galice. Un an plus tôt, sur le même axe, un précédent accident avait fait seize morts. C’étaient aussi des Portugais, partis de Suisse pour passer le week-end de Pâques au Portugal. Ils étaient entassés dans une camionnette sans vitres, comme des migrants voyageant clandestinement au sein de l’Union européenne. Eh bien là, ces conditions de transport inhumaines étaient le lot de ressortissants européens.
Qu’est-ce que tu trouves de remarquable ou de touchant chez les personnes dont tu dresses les portraits?
Elles m’intéressent parce qu’elles sont proches du terrain. Parce qu’elles produisent. Soit des services de première nécessité, comme Romain Comte, soit de la marchandise, comme Denis Pommier. Pas comme les intermédiaires qui eux ne produisent rien mais touchent parfois beaucoup d’argent. Quand le laboratoire américain Pfizer annonce l’arrivée sur le marché d’un vaccin contre la Covid, moi, ce qui m’intéresse, c’est l’histoire du couple turco-allemand qui a découvert ce vaccin et non pas les cinq millions de stock-options que va empocher le PDG de Pfizer.
Les deux Allemands d’origine turque, un homme et une femme, sont eux-mêmes aujourd’hui milliardaires…
Ils sont peut-être devenus milliardaires avec leur PME, mais c’est leur parcours que j’ai envie de raconter et qui échappe jusqu’à un certain point au monde de la finance.
«C’était la France qui fait rêver»
Il y a une dizaine d’années est apparue une lecture différente de la crise française avec la notion de «France périphérique» qu’on doit au géographe Christophe Guilluy et qui désigne un ensemble de territoires comme exclus des bénéfices de la mondialisation. Est-ce que tu es sensible à cette perception?
Oui, complètement. Je reprends l’exemple de la route de la mort, la RCEA. C’était celle des terroirs. Je me rappelle, enfant, de ces panneaux indiquant les grands vins de bourgogne et de bordeaux, les fromages, les églises romanes. C’était la France qui fait rêver. Quand j’ai repris cette route pour « L’appel des sirènes », d’autres panneaux avaient fait leur apparition : non à la fermeture de telle usine, non à la fermeture de telle maternité, non à la fermeture de telle gare, etc. En trente ans, cette France périphérique a changé, elle s’est abîmée. Ce récit d’une dégradation est plus présent dans les livres sur Montebourg et le chef pompier Romain Comte que dans celui consacré au viticulteur Denis Pommier.
On sent chez toi une part de nostalgie.
Oui, sans doute. Avec ma famille j’ai acheté une maison non loin de Chablis où je me suis lié d’amitié avec Denis Pommier. Cette partie de la Bourgogne me va bien parce qu’elle est située entre mon Jura natal et Paris où je travaille. Elle me va bien aussi parce qu’elle me rappelle l’époque où, venant de Suisse, je trouvais en France, sitôt la frontière franchie, cette atmosphère d’un terroir que je me remémore heureux dans mes souvenirs. Et puis, cette France des vignerons, ce que je vais dire va sembler affreusement réac, c’est une France qui travaille. On a en Suisse l’image d’une France rétive au travail, celle des 35 heures. Or, cela ne correspond pas à celle des vignerons que je côtoie.
En tant que journaliste à l’AFP, tu es tenu à une forme de devoir de réserve, mais on devine chez toi des valeurs plutôt de gauche, une gauche à la fois du salariat et de l’entrepreneuriat. Est-ce le cas ?
Permets-moi d’esquiver ta question. Je n’ai jamais demandé leurs couleurs politiques à Denis Pommier et Romain Comte. Montebourg, avec sa fibre protectionniste, a des idées qui peuvent être tout à fait acceptées par une partie de la droite. En ce sens, Macron a raison de dire qu’il n’y a plus ni de gauche ni de droite solidement ancrées et distinguables l’une de l’autre. L’opposition que je vois aujourd’hui est plus une opposition entre l’humain et ce qui l’est moins. Je reprends l’exemple des stock-options de Pfizer : apparemment c’est un algorithme qui devait les vendre à partir du moment où l’action montait énormément. Il y a un côté inhumain dans cette opération. L’autre opposition qui m’apparaît est celle entre ville et campagne, entre idéalisme ou utopisme d’une part, et une réalité parfois ingrate de l’autre. Le pompier de Saône-et-Loire, il n’intervient pas sur l’incendie de Notre-Dame mais sur des accidents de la route ou des voitures qui brûlent dans des quartiers difficiles. Paray-le-Monial, la ville de Romain Comte, c’est une petite ville de 12 000 habitants comme Delémont.
«Mon père travaillait chez un caviste et ma mère travaillait comme couturière»
Est-ce que les personnages que tu décris sont représentatifs du mouvement des gilets jaunes?
Les ouvriers d’Alstom et de Florange, oui. Le chef pompier Romain Comte et le vigneron Denis Pommier, non. Romain Comte, en tant que pompier, est de plus en plus appelé au secours dans des zones rurales où l’Etat a disparu, mais son cas personnel, pas plus que celui de Denis Pommier ne témoignent d’une situation ou d’un sentiment de déclassement tel qu’observé chez les gilets jaunes rassemblés chaque samedi aux ronds-points de cette France périphérique.
Venons-en à ton histoire. Tu es né à Delémont en 1966, quand le Jura faisait encore partie du canton du Berne. D’où venaient tes parents?
Ils venaient tous les deux de Galice en Espagne mais ils se sont rencontrés à Delémont. Mon père travaillait chez un caviste et ma mère travaillait comme couturière. Elle a terminé sa vie professionnelle, et c’était pour elle une forme de consécration, concierge à Morépont, là où se réunissait le gouvernement jurassien, à Delémont. J’étais enfant unique.

Antonio Rodriguez et ses parents, Higinio et Maria, à Delémont en 1970. © Privé
Dans les années 70 et 80, je n’ai pas souvenir de racisme en paroles ou en actes visant dans le Jura les Italiens, les Portugais et les Espagnols. Est-ce que toi, à l’enfance ou à l’adolescent, tu as été témoin de racisme?
Non, pas vraiment. Au contraire, même. Maintenant que je peux comparer les situations des deux côtés de la frontière franco-suisse, je dirais que j’ai plutôt eu la chance de grandir en vieille ville de Delémont dans un premier temps, pas très loin par la suite, et non pas dans un HLM construit en zone inondable. De la même façon, j’ai eu la chance d’être scolarisé dans une classe où nous étions peu de fils et filles d’étrangers, mélangés aux enfants de la bourgeoisie delémontaine. Il n’y avait pas de séparation de classe sociale.
«Mon éditrice m’a dit: "Pense à la relation de l’homme avec la nature, relis Ramuz"»
Parlais-tu français tout petit?
Non. Je me souviens à ce propos que ma mère me rappelait, une fois devenu grand, que je ne parlais pas français quand elle m’emmena la première fois à l’école enfantine. J’avais 5 ans et j’avais grandi dans un cocon galicien. Tout le monde parlait galicien à la maison, y compris bien sûr mon grand-père, qui était là. C’est pour cette raison que je suis particulièrement sensible aux critiques qui relèvent la qualité du style de mon livre sur Denis Pommier – mon éditrice m’a dit: «Pense à la relation de l’homme avec la nature, relis Ramuz», ce que j’ai fait, notamment «La guerre dans le Haut-Pays» et «Jean-Luc persécuté». Parce que tout cela, à l’origine, ce n’était pas gagné. Il s’agissait pour moi de ne pas être tenté par le décrochage scolaire ou autre chose.
Il y a quand même eu des périodes pénibles au moment des initiatives xénophobes Schwarzenbach qui entendaient réduire le nombre d’étrangers présents en Suisse.
Oui, là, en effet, pour ma famille, ce fut l’inquiétude et l’angoisse. On avait suivi à la télévision, un poste noir et blanc, les résultats de l’initiative de 1974. C’était un contexte de récession économique, marqué par le premier choc pétrolier et le début de la crise dans la branche horlogère. Cette initiative, comme toutes les autres, avait été rejetée. J’ai eu, ado, un entraîneur de foot devenu membre de l’UDC par la suite, mais je n’ai jamais entendu de propos racistes dans sa bouche, mais d’autres, plutôt drôles avec le recul, du genre: «Antonio, si tu ne veux pas courir, fais de la marche!»
«Je me suis dit alors que j’étais un gros con»
As-tu ressenti chez tes parents ou en toi une pression te poussant à réussir ta scolarité et tes études?
Oui, d’ailleurs je pense à mes parents ces jours-ci. Quand je lis une bonne critique des «Larmes de ma vigne», je pense à eux. Mon père est décédé en 1993, ma mère, il y a sept ans. On n’est pas toujours conscient des attentes des parents. J’en ai pris conscience lorsque je leur ai annoncé que je redoublais ma deuxième année de lycée. Je pensais pourtant les avoir préparés à cette mauvaise nouvelle. Eh bien non. J’ai vu mon père pleurer. Je me suis dit alors que j’étais un gros con. Si bien que me suis ressaisi. J’étais dans cette période insouciante de l’adolescence où j’aimais sortir, aller en boîte au 138*. Je me suis rendu compte qu’il ne fallait pas penser qu’à moi.

En 1990, Antonio Rodriguez interviewant le footballeur français Michel Platini. © Privé
Tu avais deux passions qui te prenaient du temps. Le foot et le rock.
J’ai même interviewé Michel Platini, ton idole, pour Le Démocrate, devenu Le Quotidien Jurassien. Au foot, j’ai joué en Inter A avec les SRD, le club delémontain. Comme ailier droit ou latéral droit. Ma meilleure saison (rires), c’était au poste d’avant-centre avec les Espagnols de Delémont. Je devais avoir 18 ou 19 ans, je marquais plein de buts. On s’était sauvé de la relégation dans un match de barrage contre Sonvilier, à côté de Saint-Imier. J’avais marqué le but vainqueur. Quant au rock, plutôt la pop anglaise en ce qui me concerne, j’appartenais à une équipe de passionnés qui faisait venir des groupes au Caveau, une salle de Delémont. Des formations qui étaient en tournée en France voisine, à Besançon ou en Alsace. On s’était mis dans la boucle. On faisait des échanges avec les Eurockéennes de Belfort.
«Quand il y a une frontière, j’aime bien la traverser»
Qu’as-tu fait comme études? Comment t-es-tu retrouvé correspondant de l’AFP à Montevideo en Uruguay?
J’ai fait études de lettres à l’Université de Neuchâtel, avec espagnol, histoire et journalisme. En même temps, j’écrivais des articles pour la rubrique «sports» du Démocrate. En 1993, je suis entré à l’ATS, l’Agence télégraphique suisse, avant même d’avoir terminé mes études. En 1997, j’ai rejoint l’AFP, l’Agence France Presse et je suis effectivement parti comme correspondant à Montevideo, en Uruguay. J’avais noué auparavant des contacts avec le correspondant de l’AFP à Besançon. C’est un peu dans mon tempérament: quand il y a une frontière, j’aime bien la traverser. Partir en Uruguay, à 12 000 km, avec un salaire plus bas qu’en Suisse, laisser ma mère à Delémont – elle viendra me voir plusieurs fois à Montevideo… Tout cela n’était pas facile. J’ai tenté le coup. L’idée n’était pas nécessairement de faire carrière à l’AFP, d’y travailler maintenant depuis plus de 20 ans, mais les choses se sont faites comme ça.
Quels faits marquants gardes-tu de ton séjour en Amérique du Sud?
Il y a l’arrestation de Pinochet à Londres en octobre 1998. Je me suis rendu plusieurs fois à Santiago dans le cadre de cette affaire judiciaire. Et là je suis tombé sur des gens qui n’étaient pas contents que Pinochet ait été arrêté. J’ai découvert à cette occasion un Chili qui ne correspondait pas à l’image que j’en avais. A l’inverse, il y a eu une grande émotion à Santiago lorsqu’à Londres la Chambre des lords a estimé que l’action contre Pinochet était légale. Ça s’est joué à trois voix contre deux, un peu comme sur des tirs au but. Je me trouvais au siège de l’association des victimes de la dictature. Je ne parvenais à interviewer personne, tout le monde me sautait dans les bras.
«Ne te mêle pas de ça, c’est des histoires de Suisses!»
Cela ressemble, dans un autre registre, à l’intense émotion du 23 juin 1974 à Delémont, quand une majorité des sept districts jurassiens a approuvé la création d’un canton du Jura. Tu avais 8 ans.
Oui, je m’en souviens. Je me souviens surtout de mes parents qui me disaient: «Ne te mêle pas de ça, c’est des histoires de Suisses!» Pour en revenir à l’Amérique du Sud, avec ma mère nous avons retrouvé des cousins galiciens qui avaient émigré en Argentine et en Uruguay dans les années 50 et que ma mère n’avait pas revus depuis.
Après l’Uruguay, te voilà correspondant de l’AFP à Washington.
J’y suis resté de 2004 à fin 2008 et la réélection d’Obama. Ce qui était intéressant, c’était de sortir de Washington, une ville qui vote démocrate à 90% et ne représente donc pas les Etats-Unis. C’était l’époque où l’Amérique profonde avait une dent contre la France parce que celle-ci n’avait pas rejoint la coalition armée contre l’Irak en 2003. En Caroline du Nord, il ne fallait pas commander des «French fries» mais des «freedom fries», les frites de la liberté, ainsi qu’elles avaient été renommées. Je me suis intéressé aux latinos, aussi parce que je m’identifiais à eux. Je voulais voir comment ils vivaient dans cette Amérique qui les faisait rêver. Je me souviens d’un reportage sur la Nouvelle-Orléans reconstruite après l’Ouragan Katrina de 2005. J’étais allé à la rencontre de ces latinos qui avaient pris part à l’ouvrage et qui après cela s’étaient retrouvés sans emploi. J’avais titré mon papier: «Les oubliés de Katrina». En 2009, j’ai été nommé au siège à Paris. J’étais affecté à l’économie. J’y ai suivi notamment les ministres Montebourg, Macron et Le Maire.
Beau parcours. A propos de ton livre «Les larmes de ma vigne», tu me disais dans une précédente conversation que l’essentiel des critiques, toutes bonnes, était le fait de la presse de droite. Comment l’expliques-tu?
Ça m’amuse un peu, parce que la presse qui fait le plus la promotion de l’écologie et du bio, c’est la presse de gauche, or c’est elle qui parle le moins de ce livre. Je ne sais pas vraiment à quoi c’est dû. Mais ce que je constate… Je ne sais pas comment te dire ça de manière journalistiquement neutre… Pour faire simple, le 10 mai 1981 quand François Mitterrand a été élu président de la République en France, j’ai été content. Dans l’immeuble où j’habitais avec mes parents logeait aussi Jean-Luc Vautravers, le rédacteur en chef du Démocrate, un quotidien de sensibilité libérale-radicale pour qui je pigerais par la suite. Jean-Luc Vautravers ne devait pas être content de l’élection de Mitterrand, lui (rires). Dans un autre contexte, il avait été la cible d’un barbouillage des séparatistes du groupe Bélier, au sol devant l’immeuble. Quelle époque!
Quel immeuble!
Il n’était de loin pas habité que par des étrangers. Outre le rédacteur en chef du Démocrate, on y trouvait le délégué épiscopal, ainsi que le directeur de l’usine de vélos Condor. Il y avait de la mixité sociale.
Tes sentiments d’ado en faveur de Mitterrand seront-ils par la suite un peu plus mélangés?
Oui, en quelque sorte. Je repense au parcours de ma mère, aux échelons qu’elle a gravis à Delémont pour terminer fonctionnaire. Les gens qui lui ont permis de les gravir sont des gens de droite. C’est bête pour la gauche, ce que je vais dire, mais les ministres (les conseillers d’Etat jurassiens, ndlr.) dont elle me disait du bien parce qu’ils avaient eu une attention pour elle, étaient des ministres de droite, alors que les socialistes étaient plutôt froids et distants. Maintenant, avec les échos favorables que rencontre mon livre dans les journaux de droite, je me dis que c’est peut-être une réalité qu’il faut accepter.
«Je suis pour un protectionnisme environnemental»
Sur la question d’un certain protectionnisme économique, soutenu par des personnalités de gauche, posant des limites au libre-échange, comment te situes-tu?
C’est une conviction tout à fait personnelle: on ne peut pas fermer les usines en Europe pour aller polluer ailleurs, ce n’est plus possible. Si on veut améliorer notre environnement, il faut taxer de manière dissuasive les produits importés de pays ne répondant pas aux normes de l’Union européenne. A ce titre, une taxe carbone sur ces produits s’impose, comme le prévoit le «Pacte vert» au sein de l’UE. Je suis pour un protectionnisme de type environnemental.
Comment te positionnes-tu dans le débat sur l’immigration extra-européenne?
Il faut arrêter d’être hypocrite. Si des gens viennent en Europe, c’est parce qu’ils pensent qu’ils y vivront mieux que dans leur pays d’origine, mais c’est aussi parce qu’on a besoin d’eux. L’idéal serait que tout cela se fasse de manière ordonnée et légale. Quand, après la chute du mur la mondialisation a pris son essor, l’idée était d’aller produire dans d’autres pays, que cela contribuerait à l’élévation globale du niveau de vie partout sur la planète. Or trente ans plus tard, on s’aperçoit qu’on est allé produire ailleurs mais avec l’impératif de produire toujours moins cher. Je ne crois pas au crédo néolibéral de la stabilisation des populations dans leur pays par la création de classes moyennes. Pour moi, c’est un utopisme. C’est comme le ruissellement, ça n’existe pas. On pensait freiner l’immigration, elle s’est accélérée. Avec les conflits provoqués par les crises environnementales (sècheresse, montée des eaux), le nombre de réfugiés climatiques augmentera. Il y’a pas beaucoup de raisons d’être optimistes.
Te reconnais-tu plutôt dans un modèle universaliste à la française ou dans une organisation multiculturaliste à l’anglo-saxonne?
Disons que la laïcité française me va très bien. Ma femme est musulmane, je suis catholique. On vit sans problème dans un pays qui accepte et permet ce type d’union. Pour en revenir à mon histoire, je n’ai pas grandi dans un ghetto et j’en suis reconnaissant au Jura et à la Suisse.






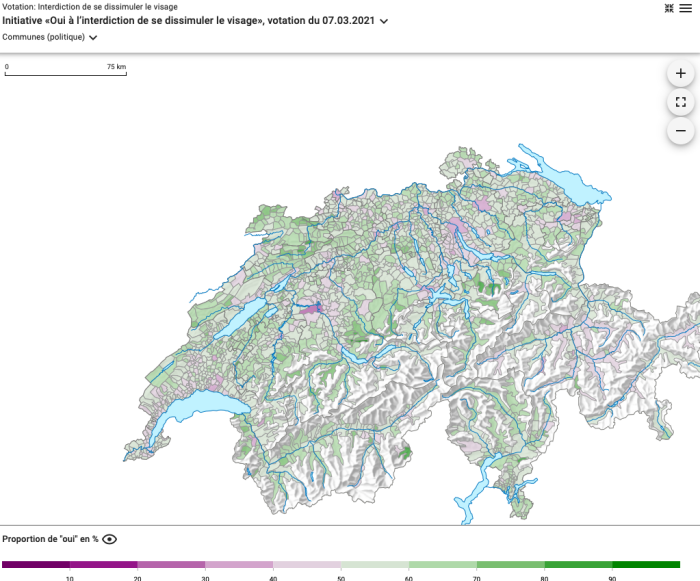

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire