Culture / Les leçons de Maître Arditi rayonnent de belle humanité
Un grand roman chatoyant, «Le Danseur oriental», préludant à une prochaine «Trilogie de Constantinople», et précédé par une profession de foi «identitaire», «Comment je suis devenu juif en dix leçons (avant de virer parano)», déploient le double talent de romancier et d’essayiste-humaniste généreux dont nous avons grand besoin aujourd’hui…
Pour votre première leçon de langue turque de ce matin, à laquelle Metin le métèque vous convie en marge du roman de près de 400 pages qu’il vient de publier sous une couverture évoquant un jeune derviche tourneur, vous noterez dans votre cahier le mot de seçmé, signifiant «choisi» et que vous prononcerez «setchmé» selon les indications de l’auteur jouxtant la généalogie familiale des protagonistes du roman, laquelle précède la liste de la quinzaine de figures proches ou carrément «historiques» impliquées, tel Kemal Atatürk, alias Mustafa Kemal Pacha, dans ce qui s’annonce comme une vaste fresque où le détail le plus infime (les petites misères physiques de l’implacable Kemal) le disputera aux tribulations de l’Histoire avec sa grande hache, le rideau du roman se levant le 5 septembre 1912 alors que l’empire ottoman s’effondre ou plus exactement se prépare à sa transformation en république – cela se fera en 1923, 1912 marquant la date où le jeune Gülgül, héros du roman, est «choisi» pour intégrer un groupe de lutteurs selon la tradition dont il deviendra le champion national.
De la langue, de la guerre et des doux mélanges
La question de la langue est essentielle pour un écrivain, autant que pour un peuple et les minorités linguistiques de partout, Russes d’Ukraine compris, vous diront que leur interdire l’usage de leur langue maternelle équivaut à une déclaration de guerre, au figuré ou au propre le plus sale. Or cela équivaut-il à un absolu identitaire? Peut-être en termes d’idéologie et de plans géostratégiques à grandes largeurs, mais le point de vue de l’écrivain, et plus particulièrement du romancier, vaut essentiellement dans les «petites» largeurs de la singularité personnelle, et c’est ainsi que les touches de couleur de la langue turque émaillant la marqueterie du roman de Metin Arditi, bien plus encore qu’une «couleur locale» participent de la polyphonie où le détail ciselé d’une miniature ottomane à calligraphie surfine s’inscrit dans le tableau magnifique d’une ville proprement «révélée» du nom de Constantinople.
Occupée par les Alliés après de violentes tribulations, la ville est dite «honteuse» mais reste supervivante, ville de bruits et d’odeurs enivrée par les cris des marchands ambulants, les vendeurs d’eau et les portefaix, portant encore beau dans un mélange de fierté et d’humiliation, «Byzance conquérante sur la rive droite de la Corne d’or, un Paris déjà décadent sur sa rive gauche et l’Asie de tous les espoirs sur l’autre rive du Bosphore »…
Or la splendeur passée de l’Empire, qui se trouve entre les mains ottomanes mais pas musulmanes à l’heure de l’hallali, entre ses majestueuses mosquées et son Bazar où se joue l’avenir financier du pays que contrôle le camp minoritaire des Grecs, Juifs et Arméniens, est symbolisée ici par un chef-d’œuvre de l’art ottoman appelé le Surnâmé, constitué initialement de deux cent cinquante double-pages racontant, en cinq cents miniatures, les 52 jours et nuits des fêtes célébrant la circoncision du fils de Mourat III, en 1582 en présence des invités de la Sublime Porte venus de toute l’Europe. Or l’extraordinaire objet, auquel il manque une quinzaine de pages égarées Dieu sait comment, représente la préoccupation majeure du sultan, plus esthète que guerrier, qui voit en sa restauration le geste qu’il ne peut accomplir pour sauver l’Empire en lambeaux. Le détail pourrait sembler secondaire sur le fond des énormes convulsions secouant le pays, mais le romancier a choisi d’en faire l’un des noyaux de sa narration, où le travail raffiné des calligraphes importera autant que la danse des derviches et que la tradition des lutteurs – toutes activités incarnées par les protagonistes du récit.
Où tout se passe comme «en coulisses»
Chose étonnante, et significative en l’occurrence: que ce roman impliquant divers personnages historiques de premier plan, à commencer par le dernier sultan et le glorieux Atatürk, n’aborde en somme les événements de l’époque que par la bande et, plus surprenant encore: que son héros central, le jeune et beau Gülgül, adorable garçon du genre à gagner illico la sympathie du lecteur, n’apparaît guère qu’épisodiquement. Il y a du personnage à la Dickens chez cet orphelin de mère secrètement confié par son père biologique à un tuteur d’adoption, dont la force physique et la beauté princière contrastent avec la douceur (il aime la lutte mais déteste la violence), et qui montrera une noblesse de comportement sans faille quand il sera sournoisement attaqué pour une raison qu’on ne «spoilera» pas. Mais les pages du Temps – autre protagoniste du roman – se tournent vite, et les apparitions du personnage restent fugaces. De la même façon, quoique bien individualisés par les traits essentiels qui les distinguent, les autres personnages (y compris le sultan), de Danilo l’antiquaire juif à Sarkis l’encadreur arménien, ou de Calypso la craquante fille de Spiro le Grec à Bella l’amie de Gülgül sensible à la sensualité saphique, sont traités non en «solistes» mais comme faisant partie d’une sorte de chœur social où apparaissent, alors, les clivages et les oppositions – la multiculture spécifique de ce monde-là se détaillant alors «du dedans». D’où l’importance de l’intense attention portée par l’auteur à la vie intime de ses personnages, et notamment en matière de sexe – l’usage pédérastique des jeunes lutteurs offerts en gitons aux notables, ou l’érotisme enseigné à Gülgül par les odalisques du harem – et de croyances, évoqués avec autant de clarté (Metin Arditi pourrait être dit un romancier de la «ligne claire») que de précision. Nulle empreinte «idéologique» dans le développement de la fresque: rien que la vie avec ses contrastes lumineux ou plus sombres où ressortent alors les grands thèmes récurrents de l’œuvre de l’écrivain: de la filiation et de l’identité, de la pluralité et des fidélités parfois en conflit, du rôle de l’art et de l’importance lancinante de la religion, etc.
Au tournant de son dix-huitième roman, Metin Arditi brasse son matériau vivant avec maestria, grand cuisinier pratiquant à fines touches-séquences comme un scénariste de série haut de gamme, et Le Danseur oriental apparaît alors comme un formidable «labo» d’observation avant le retour aux «travaux pratiques» de l’essayiste et du frère humain mettant la «main à la pâte».
Un engagement qui ne se paie pas de mots…
Il fut un temps où, dans la foulée d’un Sartre se la jouant maître à penser, la notion d’engagement, essentiellement idéologique, posait son auteur sur le «bon bord», selon l’expression du chrétien de gauche Henri Guillemin. Le chaos actuel, où l’adjectif-valise de «fasciste» suffit à qualifier n’importe qui pour n’importe quoi, relègue apparemment l’auteur «engagé» dans le débarras des vieilles lunes, alors même que la réalité d’un engagement conséquent, qu’il soit d’un James Baldwin contre le racisme ou d’un Boualem Sansal contre l’islamisme radical, reste combien légitime, et l’exemple de Metin Arditi, scientifique de formation et notablement enrichi au titre d’agent immobilier, mécène au rayonnement international et ambassadeur de bonne volonté à l’UNESCO, écrivain depuis sa quarantaine et couvert depuis lors de prix littéraires, défie tous les classements «sartriens» et notamment sur la «question juive», comme l’illustre magnifiquement son manifeste de 62 pages intitulé Comment je suis devenu juif en dix leçons (avant de virer parano), où nous voyons de plus près (comme dans le roman) comment une expérience vivante en pleine chair, et en lien avec l’Histoire, et donc avec le Temps, fonde la reconnaissance «charnelle» d’une appartenance.
C’est à quatre ans déjà que le jeune Metin, diablement précoce (!) et fermement décidé à devenir le roi de Turquie (il y était né en 1945 et, à deux mois déjà (!!) avait convaincu son paternel de migrer d’Ankara à Istanbul, pour mieux développer ses affaires), quand sa mère objecta. «Tu ne peux pas», alors lui: «Et pourquoi?» Et elle: «Parce que tu es juif. Nous ne sommes pas de vrais Turcs. Nous sommes juifs.» Et lui de conclure: «Alors je serai roi de Juivie»…
Mais c’était avant d’apprendre ce qui était arrivé aux millions de Juifs exterminés en plein XXe siècle, avant Israël qui l’a fait «virer parano» à la découverte (notamment) du sort de la Cisjordanie, avant l’horreur du 7 octobre 2023 et l’horreur de la vengeance lui inspirant ces lignes en 2024. «Le pays a, depuis des décennies, tourné le dos au droit international sans en payer le moindre prix.» Mais ceci aussi: «L’urgence est de ne plus écouter les marchands de malheur dont, étrangement, de nombreux arguments reprennent ceux des discours inflammatoires de Netanyahou.»
Se disant hanté par les images de Gaza, et s’abstenant cependant de juger la réponse d’Israël aux crimes atroces commis par le Hamas, c’est en homme de bonne volonté «réaliste», une fois encore, que Metin Arditi , à l’exclusion d’un Etat binational, propose un Etat fédéral inspiré du modèle helvétique – mais là encore foin d «spoiling» et allez-y voir, lectrices et lecteurs de bonne foi qui refusez de vous payer de mots – c’est au pied de la Lettre que vous attend l’écrivain…
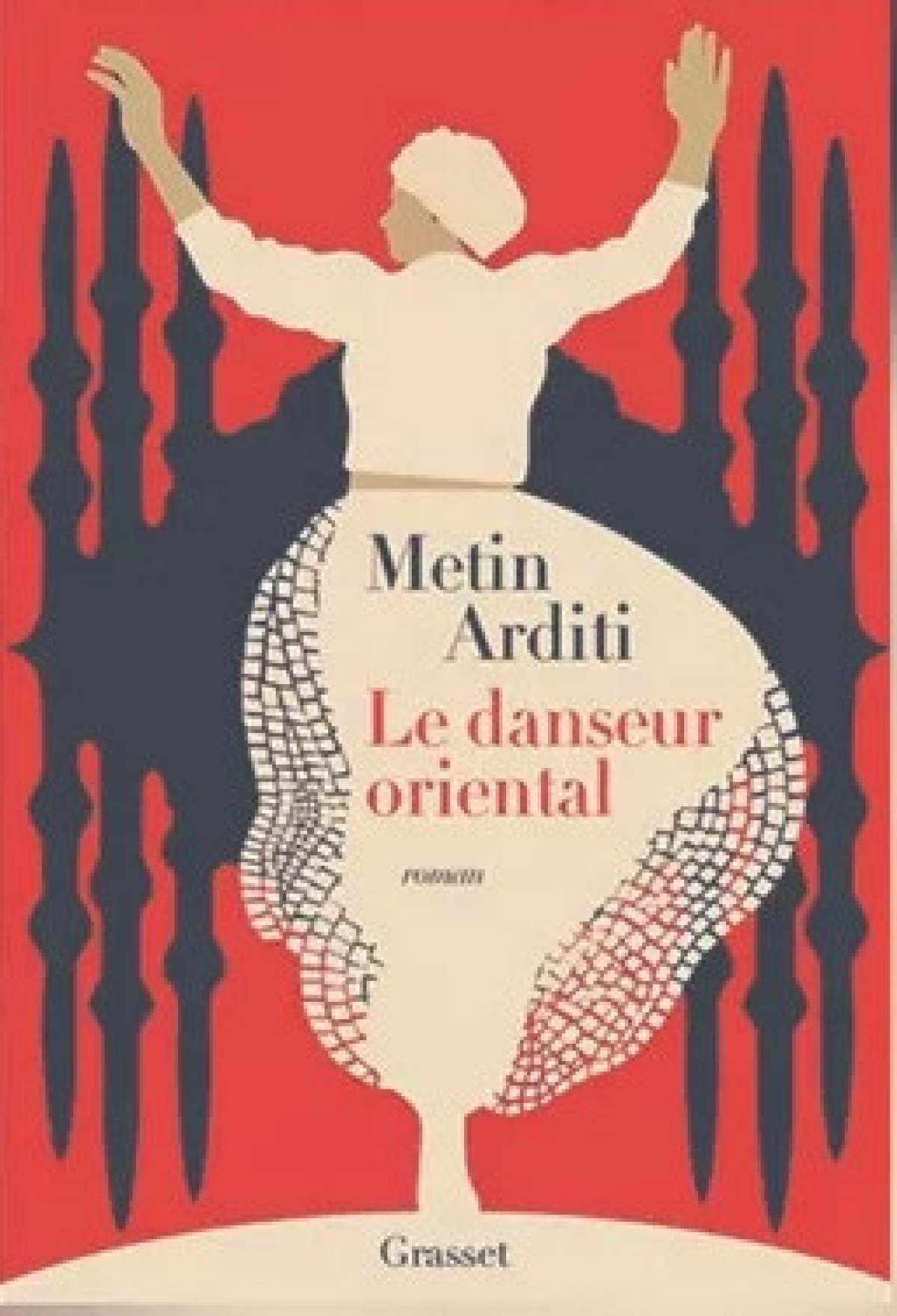
«Le Danseur oriental», Metin Arditi, Editions Grasset, 395 pages.
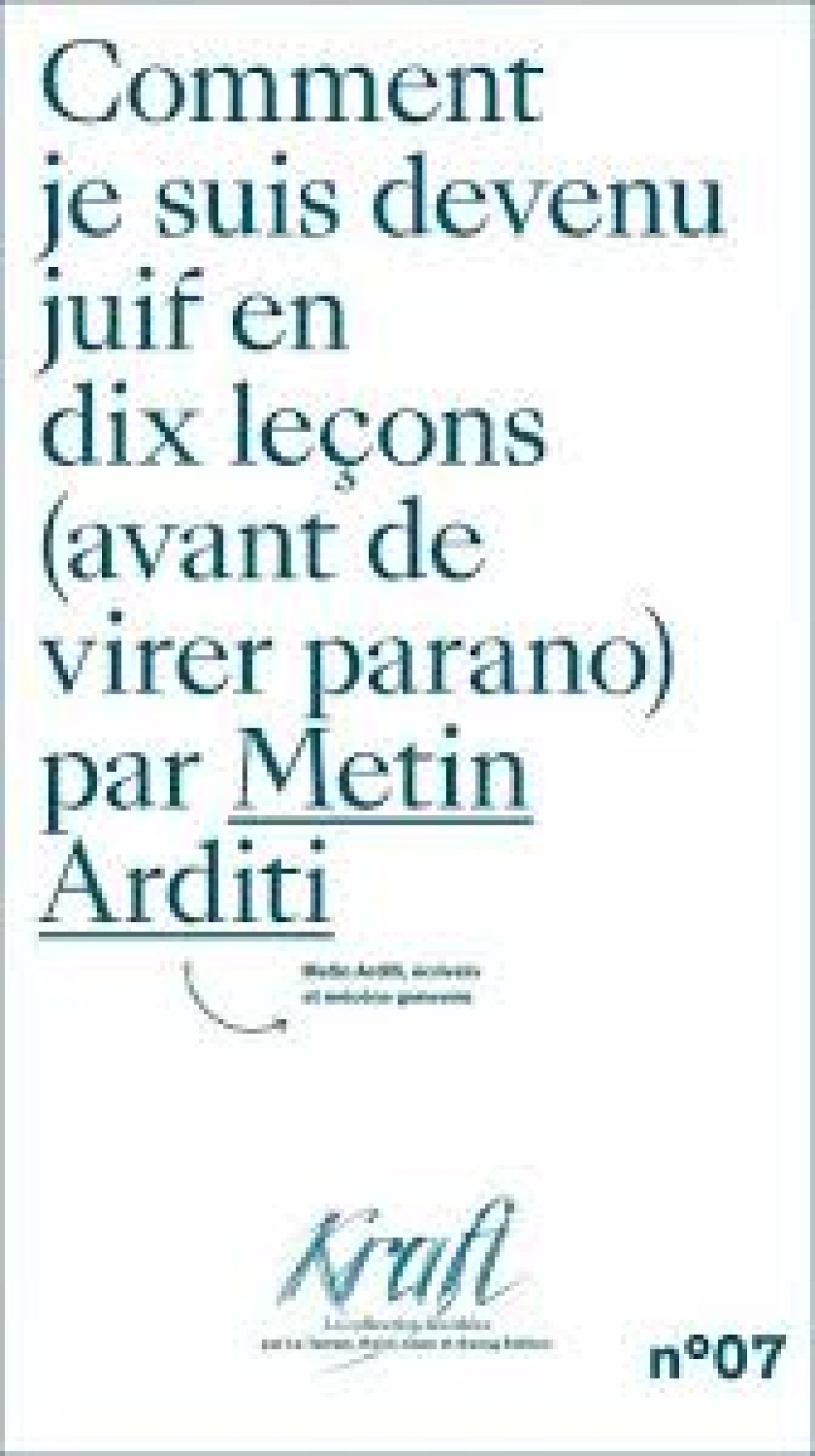
«Comment je suis devenu juif en dix leçons (avant de virer parano)», Metin Arditi, Editions Georg, en parité avec «Le Temps» et «Heidi.news». Kraft, La collection des idées, No 7.



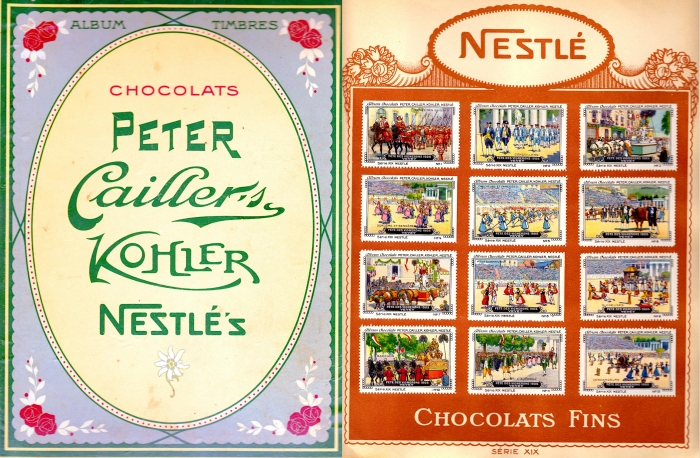

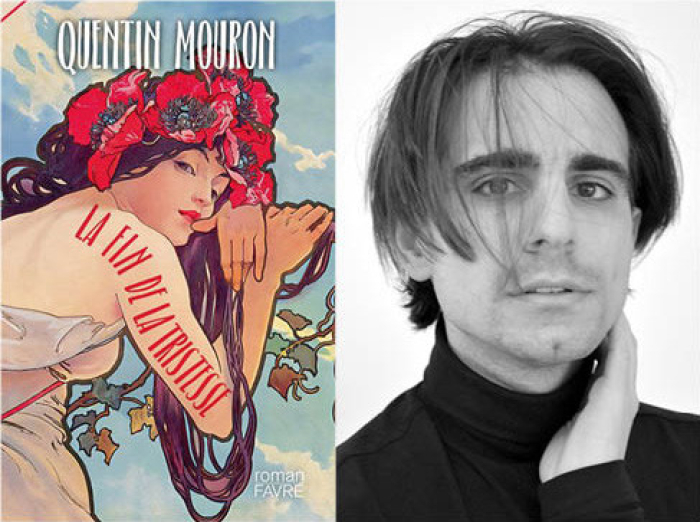
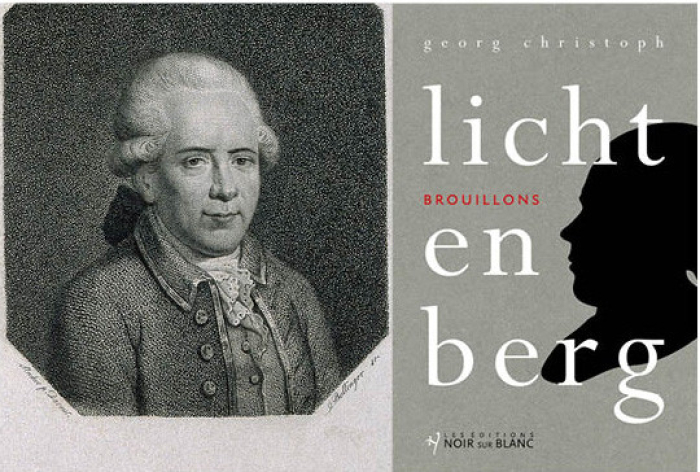
VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire