Culture / L’ombre portée des totalitarismes
La progression de l’extrême-droite populiste dans plusieurs régions névralgiques du monde; l’instabilité géopolitique internationale liée à la guerre en Ukraine et les dangers sérieux de conflagration nucléaire; les vives inquiétudes liées aux pandémies ainsi que les preuves estivales accablantes concernant le réchauffement climatique apportées par la canicule. La situation planétaire n’incite guère à l’optimisme. Elle peut aussi faire craindre un retour aux pires heures qu’a connues l’humanité au cours du XXème siècle. Ces pages très sombres de l’histoire contemporaine ont profondément marqué le cinéma dans le passé. Et elles continuent d’inspirer au présent le travail de réalisateurs, comme en témoignent plusieurs des films projetés cette année au Festival du film de Locarno.
L’art du silence de Maurizius Staerkle Drux, My neighbor Adolf de Leon Prudovsky et Skazka (Fairytale) d’Alexander Sokurov ont été présentés en première mondiale au bord du lac Majeur. Ces trois films ont permis aux spectateurs de s’interroger sur la représentation de la violence extrême, du totalitarisme et de leurs conséquences au cinéma. Ces thèmes sont abordés avec brio dans le travail de Costa-Gavras, récompensé cette année à l’âge de 89 ans pour l’ensemble de son œuvre. Ils apparaissent aussi de manière très frappante dans celle de Douglas Sirk (né Detlef Sierck), à laquelle une magnifique rétrospective a été consacrée. Retour critique.
L'art du silence
Comment sortir de l’enfermement intérieur? Comment transcender un traumatisme et se reconstruire? Le jeune réalisateur suisse Maurizius Staerkle Drux s’intéresse au célèbre mime Marcel Marceau. Son vrai nom est Marcel Mangel. Enfant de la Shoah, il s’est engagé dans la résistance. Il a fait passer des enfants juifs en train de France en Suisse. Marcel Mangel leur apprenait à se taire car il était essentiel de ne pas faire de bruit pour éviter de se faire repérer. Son propre père et d’autres membres de sa famille sont morts à Auschwitz. Après la guerre, il fut incapable d’évoquer cette partie tragique et héroïque de sa vie. Il se perfectionna dans l’art du mime après avoir découvert Charlie Chaplin.
Maurizius Staerkle Drux a choisi de tourner ce film parce qu’il a lui-même grandi au côté d’un père sourd. La vie de ce dernier a été transformée lorsqu’il a vu le mime Marceau pour la première fois. Christoph Staerkle découvrait qu’il était possible d’exprimer ses émotions sans la parole, sans recourir à des mots. Ensuite, ce père est devenu mime et il s’est spécialisé dans la parodie.
Dans l’Art du silence, le réalisateur interroge l’épouse de Marcel Marceau et ses deux filles, ainsi que son petit-fils qui se forme à la danse. La célébrité du mime s’est construite peu à peu. Le couple a enseigné ensemble l’art théâtral. Leurs filles évoquent un père relativement absent, qui se confondait presque entièrement avec le personnage de Bip qu’il avait créé. Quant à son petit-fils, il avait six ans lors de la mort de son grand-père. Il n’en garde pas de souvenir précis. Cependant, il a une conscience affutée d’avoir grandi dans une famille d’artistes extraordinaire. L’Art du silence revient enfin avec délicatesse sur la carrière de Marcel Marceau, son rapport très particulier à la création. Il se met en quête de son personnage. La caméra capture le souffle poétique qui habite le mime Marceau lorsqu’il imite le papillon. Marceau et Bip avaient pour vocation d’incarner l’amour universel. Ils étaient la réponse à la tragédie que Marcel Mangel avait dû surmonter, à l’indicible, au fait d’avoir perdu sa famille, son père et les circonstances horribles de leur disparition. Ayant joué en Allemagne après la Shoah, Marceau avait même serré la main de nombreux Allemands. Parmi eux se trouvait peut-être – il en était conscient – le bourreau de son propre père.
My neighbor Adolf
A l’instar de l’Art du Silence, My neighbor Adolf de Leon Prudovsky évoque lui aussi, sur le mode de la fiction, la question de la difficulté à surmonter un traumatisme. Un rescapé ayant perdu toute sa famille dans la Shoah, réfugié en Argentine dans les années 1960, vit seul dans une grande maison totalement délabrée. Il est sans le sou; il n’a pu recréer une famille, ni développer des relations sociales normales. Le protagoniste est persuadé que son nouveau voisin, n’est autre qu’Adolf Hitler, qu’il avait pu apercevoir brièvement en personne en 1936. Il décide alors de prouver son étrange théorie en récoltant des preuves objectives. Mais personne ne le croit, pas même le consulat d'Israël (dont l’intervention pour capturer le haut dignitaire et criminel de guerre Adolf Eichmann avait été décisive dans la réalité au moment des faits). Le protagoniste tente de dialoguer avec son voisin nouveau venu pour confirmer ses soupçons. S’approcher du Mal en personne n’est de loin pas une mince affaire… Au fur et à mesure que l’intrigue se noue, le héros se rend compte que son voisin, avec lequel il partage une passion pour le jeu d’échecs, souffre, lui aussi, d’une grande solitude. Celle-ci est avant tout d’ordre moral et spirituel. Et pour cause: s’il n’est pas Hitler en personne, il en a bien été l’un des sosies officiels durant toute la période du Troisième Reich! Puis, quand le régime nazi s’est effondré, il est devenu un criminel d’un genre différent. Toujours escroc, il a continué à vendre des toiles peintes à la façon d’Hitler à des nostalgiques du régime et à des détraqués.
Le protagoniste principal est-il victime du syndrome de Stockholm? Très bien interprétés par David Hayman et Udo Kier, toujours est-il que les deux voisins paraissent inséparables. Ils sont tour à tour agressifs, pitoyables et pathétiques. L’originalité du film réside dans les lieux où le récit se déploie: deux masures perdues dans la pampa argentine, ainsi que dans le ton décalé des dialogues et le comique de situation. La quête obsessionnelle à laquelle se livre le héros donne lieu en effet à des quiproquos grotesques. Le film pose en creux la question de la mémoire et de la responsabilité individuelle et collective. Mais son humour noir n’aurait vraisemblablement pas pu être employé il y a quelques décennies. Il aurait probablement suscité des réactions scandalisées. Aujourd’hui encore, gageons que tout le monde ne sera pas convaincu par les choix opérés par le cinéaste pour traiter de sujets aussi graves.
Comme l’a rapporté notamment le Hollywood Reporter, à l’heure actuelle, la polémique autour de ce film porte sur un autre enjeu. Un groupe de réalisateurs et d'artistes israéliens ont demandé en vain au Festival du film de Locarno de renoncer à la projection en première mondiale sur la Piazza Grande du long métrage My Neighbor Adolf «en raison des conditions "racistes" et "explicitement politiques" liées à son financement». Ce film a été en grande partie financé par le Rabinovich Foundation’s Israel Cinema Project, le plus grand fonds dédié au financement cinématographique en Israël. Cette fondation obligerait contractuellement les producteurs à accepter que leurs films n'incluent aucune déclaration ou message niant «l'existence de l'Etat d'Israël en tant qu'Etat juif et démocratique». Selon le groupe ayant interpellé la direction du Festival, cette exigence va à l'encontre des rapports d'organisations de défense des droits humains telles qu'Amnesty International, Human Rights Watch et B'Tselem, qui ont toutes décrit Israël comme déployant un système d'«apartheid» contre les Palestiniens.
Shazka (Fairytale)
C’est le film d’un artiste très talentueux, d’un homme extrêmement cultivé connu aussi comme un défenseur de la liberté et de la démocratie. Comme à son habitude, Alexander Sokurov parvient à nous surprendre en créant un univers visuel aussi impressionnant qu’inhabituel. Tout dans l’image relève de la monumentalité, d’un «baroque» volontairement excessif. Doit-on se risquer à classer Skazka dans le genre du film fantastique? Ou du film noir? Le spectateur est plongé en tous les cas dans un univers irréel et sombre qui évoque la fantasmagorie. Celle-ci est l’art de projeter des fantômes ou des figures diaboliques en public. Influencé par son ami et maître Andrei Tarkowsky, Alexander Sokurov joue avec la possibilité d’animer, d’agrandir ou de rapetisser l’image par des manipulations optiques multiples. Cependant, l’univers dans lequel est plongé le spectateur dans ce film est surtout, à proprement parler, cauchemardesque. Sokurov nous montre une brochette de dictateurs. Pas n’importe lesquels. Il s’agit certainement des plus sanguinaires dictateurs du XXème siècle, ceux qui ont incarné le pouvoir totalitaire de la façon la plus sinistre et exemplaire, à savoir Hitler, Staline et Mussolini. Grâce à un procédé de synthèse, l’écran nous confronte aux silhouettes authentiques et aux vrais visages des protagonistes. Les trois criminels se promènent dans les limbes et s’arrêtent à plusieurs reprises devant des hautes portes symbolisant l’entrée du paradis. Hitler déclare espérer y accéder pour y retrouver Napoléon. Les portes s’entrouvrent et l’on aperçoit le visage de l’empereur. Sokurov fait converser entre eux les dictateurs. La médiocrité de leur personnalité et de leur caractère est mise en exergue sous toutes les coutures. Ils sont fats. Ils ont les idées courtes. Ils sont incapables de développer un propos au-delà d’un slogan; ils ânonnent toujours les mêmes mantras politiques de leur parti. Ils se font entre eux les compliments les plus ridicules sur leurs habits. Staline affirme être fier d’avoir assassiné la moitié de la Russie. Mais, allongé sur son lit de mort, il se plaint que ses bottes lui font mal. Hitler déclare regretter de n’avoir pas pu détruire Paris. Les trois dictateurs sont à la fois incultes et haineux; ils demeurent toujours aussi assoiffés de pouvoir et de destruction. Ils apparaissent devant des charniers inconscients et satisfaits. Leur errance est interminable. Certes, ils ne parviennent finalement pas à entrer au paradis. Leurs actes ne vont pas être cautionnés par Dieu; Seul Churchill apparaît à un moment donné nimbé d’un peu de lumière. Hitler, Staline et Mussolini restent réduits à leur pure corporalité, grotesques, dénués du moindre remord, encore et toujours animés par une haine viscérale et abjecte.
Alexander Sokurov a déclaré récemment: «L’humanisme est bel et bien mort et sans doute pour longtemps». On peut dès lors voir son film comme une allégorie du retour du totalitarisme. Son film semble être conçu comme un avertissement contre les discours démagogiques qui pullulent aujourd’hui un peu partout et qui parviennent malheureusement toujours et encore à mobiliser les foules. Le réalisateur cherche-t-il à nous interpeller, à nous questionner sur les dangers qui nous guettent en nous plongeant dans cet univers de mort et de ténèbres? Cependant, Skazka n’esquisse pas de réponse à la question du «pourquoi». On comprend que le cauchemar pourrait redevenir réalité si ces trois-là parvenaient à rejoindre le paradis; si leurs émules contemporains parvenaient eux aussi à progresser dans leurs desseins. Cependant, une interrogation demeure comment des êtres aussi primaires, aussi haineux, aussi primitifs ont-ils pu mobiliser de telles foules? Le film n’aborde pas la question. Szaka sonne comme une alerte, comme un avertissement salutaire, en cherchant à susciter et à catalyser les émotions du spectateur. Parce qu’il est dénué de portée didactique vraiment explicite et compte tenu de sa forme esthétique particulièrement originale, certains spectateurs risquent cependant de passer à côté du sujet de ce film.
Costa-Gavras: une voix contre les dictatures et le totalitarisme récompensée
Le 11 août, à l’occasion de la remise d’une récompense méritée pour l’ensemble de son œuvre, le premier film de Costa-Gavras, Compartiments tueurs (1965), a été projeté dans l’atmosphère enchanteresse de la Piazza Grande. A l’écran, on a pu reconnaître plusieurs de ses amis, restés fidèles tout au long de sa carrière, en particulier Simone Signoret, Yves Montand et Jacques Perrin. Le succès de Compartiments tueurs en 1965 avait de quoi surprendre. Konstantinos Gavras, dit Costa-Gavras, était arrivé à Paris en 1955 à l’âge de vingt-deux ans. Son statut d’exilé et ses origines sociales modestes contrastaient avec celles de ses contemporains parisiens issus de la bourgeoisie. Costa-Gavras a gardé un souvenir très vif de la famine vécue en Grèce comme enfant. Et du dur travail effectué avec les paysans de son village pour survivre entre 1939 et 1945. Il a été témoin de la répression par les troupes royalistes des sympathisants communistes, pour la plupart d’anciens résistants au nazisme, dont celle vécue par son propre père. Son œuvre sera profondément marquée par le souvenir de la Seconde guerre mondiale, du nazisme et de l’exil. Son deuxième film, Un homme de trop (1967), a aussi été projeté au Tessin. Le cinéaste évoque l’atmosphère très particulière qui régnait sur le tournage de ce film dans le Massif central dans ses passionnantes mémoires Va où il est impossible d’aller (Editions du Seuil, 2019). Il attribue cette ambiance aux thèmes encore très chauds et chargés de signification abordés dans le film - la guerre, la clandestinité, l’héroïsme, l’ambivalence, etc – ainsi qu’à la jeunesse et à l’énergie débordante des acteurs présents sur le tournage. «Un homme de trop fut un échec assez cuisant à sa sortie. Puis, une bataille juridique a duré trente ans autour des droits du film. Aujourd’hui pourtant, cinquante-cinq ans plus tard, la critique aussi bien française qu’américaine, est très élogieuse à son propos», a souligné le cinéaste. Costa-Gavras a réalisé en plus de soixante ans de carrière plusieurs œuvres majeures du cinéma politique. Consacrés aux dictatures et au totalitarisme, ces films ont marqué des générations de cinéphiles et de militants engagés. On peut citer en particulier Z (1969), l’Aveu (1970), Etat de siège (1973), Missing (1982), Section spéciale (1975), Music Box (1989)et Amen (2002). Ses films ont exploré avec brio les mécanismes du pouvoir et de la violence. Ils interrogent aussi subtilement les notions de responsabilité et de moralité chez les individus et au sein des groupes humains. Ils n’ont pas pris une ride.
Hitler's Madman de Douglas Sirk (1943)
Ce film fait partie des réalisations incontournables pour quiconque s’intéresse à la représentation de la terreur totalitaire au cinéma. Les festivaliers locarnais ont eu la chance de le découvrir ou de le re-découvrir lors de la rétrospective consacrée à Douglas Sirk. En grande partie reprise à la Cinémathèque suisse à partir du 24 août, cette rétrospective propose un sélection de longs métrages issu de la période allemande du réalisateur. Cependant, elle se focalise surtout sur les années qui ont suivi sa fuite du régime nazi en direction des Etats-Unis. Durant cette «période américaine», Sirk travaille pour les plus grands studios hollywoodiens et développe son style en plaçant les émotions au centre de ses préoccupations.
«On a reconnu en lui, depuis longtemps, le maître du mélodrame américain; son point de vue critique sur les Etats-Unis, sa sensibilité féministe, ont été analysés. Avec le recul, on découvre une productivité et une diversité étonnantes: 40 films en vingt-cinq ans, avec au milieu une interruption de quatre ans due à l’exil», souligne Bernard Eisenschitz, co-curateur avec Roberto Turigliatto de la magnifique rétrospective locarnaise et auteur d’un superbe ouvrage Douglas Sirk, né Detlef Sierck, qui vient de paraître aux éditions de l’œil. Sierck a en effet d’abord été un metteur en scène prolifique de théâtre, en prenant la direction après la Première guerre mondiale du théâtre de Chemnitz, puis de Brême et de Leipzig. Ensuite, il s’est voué corps et âme au cinéma. Il a réalisé sept longs métrages en trois ans pour la UFA. Mais, en 1937, Goebbels met la main sur la UFA, qui sera désormais au service de l’Etat nazi. Sierck est attaqué car il a épousé une femme juive. Plutôt que d’accepter les compromis, il choisit de s’exiler avec elle. Après une errance de deux ans à travers l’Europe, il arrive aux Etats-Unis. En 1943, un groupe d’exilés fait appel à lui pour diriger Hitler’s Madman (1943).
«Le genre du mélodrame a longtemps été considéré comme un genre moins important que le drame, le film historique ou le film de guerre. Or, c’est un des genres les plus difficiles au cinéma. Pour ne pas paraître ridicule, il faut donner aux symboles l’apparence de la réalité pour susciter des émotions et bouleverser le spectateur», a fait remarquer Lionel Baier, réalisateur et responsable du Département cinéma de l’Ecole d’art cantonal de Lausanne (ECAL), avant la projection du film au Cinéma Grand Rex de Locarno. Hitler’s Madman est un vrai film de fiction, mais sa qualité est presque documentaire. Il a été tourné dans le temps record d’une semaine en dehors des studios. Puis, il été repris par les producteurs de la MGM convaincus de son potentiel. On ne peut qu’être subjugué par l’extraordinaire précision de la mise en scène. Les événements atroces du printemps 1942 racontés dans le film sont quasiment contemporains du tournage. Sirk construit son récit autour de la destruction du village de Lidice et de ses habitants par les nazis en représailles pour le meurtre du SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich par les partisans tchèques. Il dépeint non seulement avec une parfaite lucidité et sans la moindre ambiguïté la violence et le sadisme des hauts dignitaires nazis, mais aussi l’extraordinaire courage d’une partie des villageoises et des villageois qui leur opposent une résistance, quand bien même ils sont conscients que celle-ci va les conduire vers une mort certaine. Sirk honore avec justesse et talent leur capacité extraordinaire à trouver la force nécessaire pour résister.
Les films du passé comme du présent au sujet du phénomène totalitaire, à l’instar de ceux projetés lors de cette 75ème édition du Festival de Locarno, convoquent des images puissantes et durables. Les questionner est une nécessité pour consolider les valeurs et l’imaginaire démocratiques.




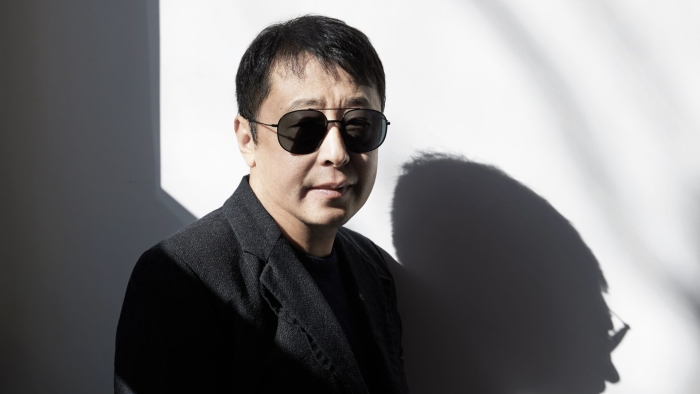



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire