Culture / Caméras françaises
Après avoir consacré l’an dernier une rétrospective à l’âge d’or hollywoodien, les Cinémas du Grütli de Genève proposent jusqu’au 19 janvier une plongée au cœur des classiques du cinéma français de 1930 à 1968. Coup de projecteur sur plusieurs films et cinéastes emblématiques de cette période d’effervescence créative.
«T'as de beaux yeux, tu sais»
La réplique devenue mythique de Jean Gabin à Michèle Morgan est tirée du film Le Quai des Brumes de Marcel Carné.
Le film est sorti en 1938 adapté du roman Le Quai des Brumes de Pierre Mac Orlan publié en 1927. Jean Gabin y joue le rôle d’un déserteur de la Coloniale arrivé dans le port du Havre et qui cherche à se cacher avant de pouvoir quitter le pays.
Grâce à un sympathique SDF, Jean trouve un abri dans une baraque du port où il fait la connaissance d’un peintre original et de Nelly, une jeune orpheline de dix-sept ans dont il s’éprend. En dépit de leur passion et du goût retrouvé par le héros pour l’existence, le destin, tragique, va l’emporter. Nelly soupçonne Zabel (Michel Simon) d'avoir assassiné Maurice, son amant. Pour défendre Nelly, Jean assassine Zabel. Alors qu'il s'enfuit pour rejoindre le bateau qui doit l'emmener au Venezuela, il est tué par Lucien (Pierre Brasseur), un jeune voyou local dont il s'est attiré les foudres.
Le film est interdit sous l’Occupation allemande par la censure française et devra attendra mai 2011 pour entrer dans la catégorie des «tous publics». Il est projeté en Italie avec des dialogues modifiés par la censure fasciste qui change le personnage du déserteur incarné par Jean Gabin en un militaire en permission. En France, le scénario passe le cap de la censure mais le représentant du ministère de la Guerre demande que le mot «déserteur» ne soit pas prononcé dans le film.
Avant de s’emparer de la caméra, Carné a d’abord été un brillant critique de cinéma. Au moment de l’avènement du parlant, il nourrissait une forte nostalgie pour le cinéma muet. Il rêve d’un cinéma parlant qui ne soit pas trop théâtral. Filmer la parole doit permettre selon lui de répondre aux exigences d’un «réalisme populaire», reflétant fidèlement la France des années 1930, à l’opposé de conventions du théâtre de boulevard. Son Quai des Brumes exsude un réalisme pesant. Le temps gris, la pluie, les pavés luisants, les aubes sinistres annoncent le triomphe de la fatalité. Le destin tragique s’empare des individus, comme une brume. Le quai est un carrefour du malheur où s’entrechoquent des êtres comme issus de nulle part et de partout. Leurs tentatives de rédemption sont entièrement vouées à l’échec.
Le genre du réalisme poétique s’est déployé aussi bien dans les fantaisies de René Clair que dans certains drames de Raymond Bernard. Il a reçu l’apport des émigrés d’Allemagne et d’Europe centrale et a pris corps, autour de Jean Gabin, dans les films de Julien Duvivier et de Marcel Carné, de 1935 à 1939. Avec Le Quai des Brumes et Le Jour se lève, le réalisme poétique est spécialement associé à Jacques Prévert, scénariste-dialoguiste, et à Marcel Carné. Empreint d’une atmosphère pessimiste, le régime de Vichy reprochait au réalisme poétique son influence délétère. Il met le genre à l’index en lui imputant une part de responsabilité dans la défaite de 1940.
La Règle du jeu
L’affiche de La Règle du jeu (1939) de Jean Renoir illustre l’évolution théâtrale des événements au château du marquis Robert de la Chesnaye qui organise une soirée avec sa femme Christine. Jurieux, un aviateur téméraire, est amoureux sans espoir de Christine. Son ami Octave, un musicien manqué, fait aussi partie des invités. Marceau, un braconnier engagé depuis peu comme domestique, est épris de la femme de chambre de Christine, Lisette, ce qui provoque l’ire du mari, le garde-chasse jaloux Schumacher.
Au premier abord, le film a l’air d’une comédie légère habilement formatée et faite de malentendus amoureux. Cependant, peu à peu, la légèreté s’estompe pour laisser place à une atmosphère plus lourde faite d’instabilité morale, alors que la France s’apprête à entrer dans la guerre. Renoir effectue en fait une analyse du système français des classes sociales et réalise, selon ses propres dires, le portrait «d’une société qui danse sur un volcan».
Un jeu de caméra très soigné et une chorégraphie haletante transforment l’espace intérieur du château en labyrinthe et en scène de vaudeville. La bande-son masque une théâtralité exacerbée, provoquant une impression intriguante de dialogues superposés. La scène de la partie de chasse, avec ses longs plans-séquences et sa tonalité quasi documentaire, fait poindre une violence sourde sous le vernis de l’élégance mondaine.
Le film a été prohibé par le gouvernement français à cause de son effet soi-disant démoralisant. Il n’est redécouvert dans sa version originale qu’à la fin des années 1950. Très apprécié par les réalisateurs de la Nouvelle Vague, encensé par François Truffaut en particulier, La Règle du jeu est un des films les plus commentés de l'histoire du cinéma. Il a influencé un nombre très important de scénaristes et de réalisateurs, comme notamment Robert Altman (Gosford Park, 1981), Woody Allen, Eric Rohmer, Nicole Holofcener, Lisa Cholodenko et Satyajit Ray.
A l’instar du critique Léon Moussinac, les professionnels du cinéma comme Jean Renoir, Jacques Becker et Georges Sadoul avaient compris le rôle du cinéma comme média de masse, comme agent d’une communication à visée sociale et politique et non pas seulement esthétique. Jean Renoir entreprend la production de «films sociaux» formatés pour l’exploitation régulière, dont les plus célèbres sont la Vie est à nous (1936) et La Marseillaise (1938). Il se fait connaître du grand public avec Le Crime de Monsieur Lange, écrit par Jacques Prévert (1936), La Grande illusion (1937) avec Jean Gabin et Eric von Stroheim et La Bête humaine (1938) adapté du roman d’Emile Zola avec Jean Gabin.
«Tendresse et violence» des bas-fonds
Né à Paris d’un père français et d’une mère écossaise, Jacques Becker a été l’assistant, l’ami et le disciple de Jean Renoir. Révélé sous l’Occupation par Dernier atout (1942), Goupi Mains rouges (1943) et Falbalas (1944), ses films témoignent de sa connaissance subtile des milieux sociaux et d’une rare intelligence psychologique.
Dans les années 1950, Jacques Becker dirige deux de ses meilleurs longs-métrages Casque d’or (1952) et Touchez pas au grisbi (1954). L’intrigue de Casque d’Or a pour cadre le Paris des «Apaches», gangs rivaux de la Belle époque. Le tout est reconstitué jusqu’aux moindres détails. Les personnages se déplacent, parlent et agissent de manière extrêmement crédible. Leur jeu est tel qu’il donne aux spectateurs, comme le remarque Becker lui-même, «l’impression qu’ils continuent à vivre hors écran, entre les scènes et qu’ils existaient avant même le début du film».
Les amants maudits, Marie et Manda, incarnés par Simone Signoret et Serge Reggiani, sont bouleversants et inoubliables. Ainsi, la chanteuse et pianiste Eunice Kathleen Waymon, futur icône du jazz et du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, prit pour pseudonyme Nina Simone: «Nina» pour niña, petite fille en espagnol et «Simone» en référence à Simone Signoret car l’artiste fut éblouie par la prestation de Simone Signoret dans le film de Becker.
La force des liens qui les unit est immédiatement perceptible. Manda (Reggiani) est tendre et déterminé, sous des abords fragile et impénétrable. Marie (Signoret) est à la fois décidée et vulnérable. La majorité de l’action se déroule dans les rues et les estaminets enfumés de Paris. Cependant, au milieu du film, Becker octroie aux amants une courte idylle au bord de la rivière. D’autres scènes d’extérieur évoquent «Une partie de campagne» de Jean Renoir. Echec commercial à sa sortie, Casque d’or suscitera l’admiration des futurs représentants de la Nouvelle Vague. François Truffaut loua le film en particulier, et à très juste titre, pour «la tendresse et la violence» de son évocation du passé.
Le mouvement orchestré
«Le goût du luxe chez Max Ophuls masquait, en réalité, une grande pudeur; ce qu’il recherchait – un tempo, une courbe – était si frêle et cependant tellement précis, qu’il fallait l’abriter dans un emballage disproportionné comme un bijou précieux que l’on enfouirait dans quinze écrins toujours plus vastes, s’emboitant les uns dans les autres», nous dit François Truffaut dans Les films de ma vie (p. 308).
Comme le père de la Nouvelle Vague, Max Ophuls s’inspire de l’énergie de la vie qu’il cherche à capturer. «Ma caméra, et on me l’a du reste suffisamment reproché, est en mouvement car elle s’adapte au rythme de la scène. Je ne travaille pas à l’avance, le plus souvent, mais j’attends de voir comment la scène évolue au studio. Je suis seulement transporté par le mouvement qu’il y a dans un film, non par le mouvement externe, mais par le mouvement interne» (Max Ophuls, Radio bavaroise, 1954).
Parmi les premiers films de Max Ophuls, le plus acclamé est Liebelei (1933). Cet opus comprend un certain nombre d'éléments permettant de reconnaître la signature du cinéaste: des décors luxueux, une attitude féministe et un duel entre un homme plus jeune et un homme plus âgé.
Conscient des dangers liés à l’ascension des nazis, Max Ophüls, juif né à Sarrebrück en Allemagne, s'enfuit en France en 1933. Il devient citoyen français en 1938. Après l'armistice de 1940, il voyage à travers la Suisse et l'Italie, où il réalise La Femme de tout le monde (1934). En juillet 1941, avant de partir pour les Etats-Unis, il fait escale au Portugal, à Estoril, à Casa Mar e Sol. Une fois arrivé à Hollywood, défendu par le réalisateur Preston Surges, acquis de longue date à son style, il réalise un certain nombre de films appréciés par la critique.
De retour en France, il adapte La Ronde (1950) d'Arthur Schnitzler, qui remporte le BAFTA Award du meilleur film en 1951, Lola Montes (1955) avec Martine Carol et Peter Ustinov, ainsi que Le Plaisir et Les Boucles d’oreille de Madame De (1953). Ce dernier, avec Danielle Darieux et Charles Boyer, couronne sa carrière.
Dans Madame De, d’après le roman de Louise de Vilmorin, Danielle Darieux, alors l’héroïne emblématique de Max Ophuls, se débat avec les tracas d’une grande dame, coquette, futile et dépensière. Soudain touchée par la passion amoureuse, elle va devoir affronter tous ses périls. Le style baroque et lyrique décrit à la perfection le tourbillon de la vie mondaine 1900, son calendrier réglé et son cortège d’us et coutumes: caprices, bals, sentiments dissimulés, élans du cœur et rivalités masculines (Charles Boyer et Vittorio de Sica). Le cinéaste porte un regard amusé, mais critique et acéré sur l’art du mariage, le bonheur que l’institution bourgeoise fait miroiter et qui cache mal l’implacable subordination des femmes.
Max Ophüls est décédé en 1957 à Hambourg d’une maladie cardiaque rhumatismale alors qu'il tournait des intérieurs sur Les Amoureux de Montparnasse. Il a été enterré au cimetière du Père Lachaise à Paris. Ce dernier film a été réalisé par son ami Jacques Becker.
Amour vécu, amour perdu, d'une beauté sans égale
La ville d’Hiroshima est hantée par la mémoire de la Seconde Guerre mondiale et de l’usage de la bombe atomique contre les civils. Au cours de son séjour sur place, une Française va revivre dans les bras d’un Japonais l’amour auquel elle a succombé pendant la guerre avec un soldat allemand. Cette aventure lui avait valu d’être tondue et de subir l’humiliation et l’opprobre à la Libération. L’écriture incantatoire de Marguerite Duras et la caméra avant-gardiste de Resnais plongent le spectateur dans un vertige amoureux et existentiel. Le récit littéraire – tout comme le récit filmique adapté de ce dernier – est celui de l’amour et de son impossibilité, à la fois pratique et morale. L’amour vécu et l’amour perdu, passé et présent, se vivent à la fois dans le cadre du récit et à travers son souvenir, ce qui leur confère une portée obsédante, d’une beauté sans égale.
Hiroshima mon amour a déconstruit les concepts classiques du récit cinématographique et exposé, de manière nouvelle pour l’époque, les notions de mémoire et d’oubli. Le film évoquait les différents traumatismes liés à la Seconde Guerre mondiale. Avec 2,2 millions d'entrées en France, il a obtenu un immense succès. Hiroshima mon amour est récompensé en 1959 par le prix Meliès ex æquo avec un autre film qui, comme lui, connut un très grand retentissement et devint tout de suite un classique du cinéma: Les Quatre cent coups de François Truffaut.
Réalisateur d'Hiroshima Mon amour (1959) et de L’année dernière à Marienbad (1961), Alain Resnais a été rapidement considéré comme l'un des grands représentants du courant de la Nouvelle Vague. Il est aussi perçu comme l’un des tenants de la modernité cinématographique européenne, avec Roberto Rossellini, Ingmar Bergman et Michelangelo Antonioni, en raison de sa façon de questionner la grammaire du cinéma et de battre en brèche la narration linéaire classique.
Alain Resnais est reconnu pour sa propension à créer des formes inédites et à enrichir les codes de la représentation cinématographique par le biais d’apports d’autres arts: littérature, théâtre, musique, peinture ou bande dessinée. On retrouve dans son œuvre des sujets historiques, la mémoire, l'engagement politique, l'intimité, la réalité de l'esprit, le rêve, le conditionnement des êtres, la mort, la mélancolie et l'art.
Hiroshima mon amour est présenté hors compétition au Festival de Cannes en 1959. Il divise alors les spectateurs. Le film fait parler de lui très loin à la ronde. Il s’attire les grâces de la critique et du public. Pour Louis Malle, «ce film fait faire un bond dans l'histoire du cinéma». Jean-Luc Godard s’estimera plus tard envieux du film: «Je me souviens avoir été très jaloux de Hiroshima mon amour. Je me disais: "Ça c'est bien et ça nous a échappé, on n'a pas de contrôle là-dessus"».
Une femme dans la ville
Le courant de La Nouvelle Vague du tournant des années 1960 est devenu un modèle de l’art au cinéma sur le plan international. Il a combiné la subjectivité du créateur, sa maîtrise totale de l’œuvre et la transgression des nombreuses normes, à la fois culturelles et morales.
Ce courant a redonné une vigueur au cinéma français. Il lui a offert une immense bouffée d’oxygène, faisant respirer le milieu jusqu’alors très hermétique et hiérarchisé de l’industrie cinématographique française. Depuis la fin de la guerre et jusqu’au milieu des années 1950, Henri-Georges Clouzot, Jean Delannoy, Claude Autant-Lara, Christian-Jaque et Marc Allégret dominent en effet la production et les studios. Ces cinéastes se réclament d’une «tradition de la qualité» grâce à leur important savoir-faire. Cependant, le système qu’ils ont érigé est très défavorable à la jeunesse et au renouvellement des cadres. Comme l’explique Antoine de Baecque, «parmi la vingtaine de réalisateurs de la Nouvelle Vague ayant laissé une empreinte durable, on peut discerner sinon quelques écoles, du moins certaines filiations. Le groupe issu des Cahiers du cinéma, celui dit des Jeunes Turcs devenus cinéastes tels que Claude Chabrol, François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Eric Rohmer, véritable noyau dur de la Nouvelle Vague. Les auteurs Rive Gauche ensuite, appellation spatiale, culturelle, politique, littéraire, certains travaillant avec les écrivains du Nouveau Roman: Alain Resnais, Jacques Doniol-Valcroze, Pierre Kast, Chris Marker, Agnès Varda, Jean-Daniel Pollet. Ceux que l’on pourrait regrouper sous le nom d’"aventuriers de la caméra", adeptes des expériences de caméra légère, de cinéma direct, pris sur le vif, proches de l’école documentaire, tels que Jean Rouch, François Reichenbach, Pierre Schoendoerffer. Quelques francs-tireurs, inclassables, autodidactes de la caméra, comme Jacques Demy, Jean-Pierre Mocky ou Jacques Rozier. Enfin, un dernier groupe plus éclaté encore, comportant de jeunes cinéastes issus du cinéma commercial (ils ont fait une carrière d’assistant dans les années 1950) mais portés par la vague au point de s’identifier à elle (Roger Vadim, Louis Malle, Edouard Molinaro, Claude Sautet, Philippe de Broca)». (Dictionnaire de la pensée du cinéma, Antoine de Baecque & Philippe Chevallier, Presses Universitaires de France, 2012, pp. 518-519).
Lors de son émergence, le cinéma de la Nouvelle Vague est avant tout apprécié pour l’authenticité des images de la jeunesse qu’il véhicule et sa façon d’explorer les rapports amoureux. D’après l’historienne et critique du cinéma Genève Sellier, du fait que les cinéastes qui en sont issus étaient quasiment tous des hommes, le cinéma de la Nouvelle Vague allait privilégier l’expression de la subjectivité et le culte de la nouveauté formelle au détriment des enjeux de société. De jeunes acteurs masculins incarnent le rôle d’alter-egos des réalisateurs alors que les personnages féminins représentent un mélange d’archaïsme et de modernité. Les deux représentantes les plus célèbres de la Nouvelle Vague sont Jeanne Moreau, incarnant l’amoureuse éperdue ou la femme fatale, ainsi que Brigitte Bardot, icône ambigüe de la culture de masse. En dépit des films passionnants de Marguerite Duras et d’Agnès Varda ou du regard indomptable de Jacqueline Audry (treize long-métrages à son actif), le cinéma de la génération Nouvelle Vague est resté tributaire d’un regard masculin souvent misogyne, et de son imaginaire tel que façonné par des siècles d’éducation ainsi que par l’influence des arts et des lettres (Geneviève Sellier, La nouvelle vague, un cinéma au masculin singulier, Paris, CNRS Ed., coll. Cinéma & Audiovisuel, 2005, 217 pages).
La cinéaste Agnès Varda s’intéresse aux mouvements d’émancipation collectifs. Elle a signé plusieurs œuvres marquantes sur le mouvement d’émancipation féminine. Réponse de Femmes: notre corps, notre sexe (1975) explore d’un point de vue féministe le rapport des femmes à leur corps. L’une chante, l’autre pas (1976) évoque, par-delà les barrières sociales existantes, la question du droit à l’avortement. Cléo de 5 à 7 (1962) peut se lire comme un appel à une conscientisation féministe. L’héroïne de cette fiction est une diva de la chanson. Son personnage satisfait à tous les critères esthétiques et comportementaux du glamour médiatique. Des cheveux blonds permanentés; la perfection surfaite du maquillage; la taille de guêpe et les talons aiguilles; l’allure, mais aussi le discours et les manières hyper stéréotypées: Cléo est l’incarnation de l’idéal féminin sur papier glacé. Pourtant, elle ne respire de loin pas le bonheur. Elle attend les résultats d’une analyse médicale. Son esprit tourmenté lui fait croire à l’imminence de l’annonce d’une maladie cancéreuse qui viendrait rapidement l’emporter. Son angoisse de mort est symbolisée par une peur panique d’atteinte à son intégrité corporelle. Celle-ci n’est que le reflet de son obsession à voir sa beauté, son seul et unique atout dans sa triste manche existentielle, à jamais préservée. L’exploration de cette névrose très spécifique, qui prend dans certaines scènes carrément la forme d’une angoisse de mutilation (verbalisée par l’héroïne), est une critique de la fétichisation du corps féminin dans une société où règne encore la domination du masculin, de ses fantasmes et de ses valeurs. Le spectateur est bientôt l’heureux témoin de la transformation intérieure de l’héroïne. Celle-ci s’opère en écho à la rébellion qu’elle va mettre en œuvre contre les codes et usages qui l’avaient jusqu’ici enfermée. Cette libération s’effectue au travers d’une déambulation, à pied et virevoltante, par les rues de Paris. Dans la culture occidentale, la flânerie était jusqu’à récemment l’apanage quasi exclusif du masculin. L’affirmation de l’héroïne se joue donc dans l’acte de flâner. La transformation intérieure implique un changement d’attitude vis-à-vis du monde extérieur. Une porte d’accès vers l’Autre s’ouvre alors que la caméra, comme en écho à ce nouveau regard, adopte une multiplicité de points de vue sur la ville.
Décor enchanté
Comme Agnès Varda, son compagnon Jacques Demy est venu à la réalisation par le court-métrage. Ils font tous deux partie de la constellation de la Nouvelle Vague. Cependant, leurs films sont très différents. Enclin à la rêverie poétique et aux sentiments exacerbés, Jacques Demy se laisse très volontiers aller au lyrisme. Il s’attarde longuement au pays des amours contrariées et des aventures passionnées. Ses personnages féminins sont parés d’une auréole quasi mythique. Le blanc laiteux prévaut dans ses films en noir et blanc. Il affectionne particulièrement les couleurs pastel. Cependant, le rose, le bleu et le jaune, si présents dans ses films en couleur, ne sont pas censés évoquer uniquement la béatitude.
Les parapluies de Cherbourg (1964) raconte l’histoire d’un amour brisé par la guerre d’Algérie. Les acteurs parlent une prose mélodique sur une musique enivrante de Michel Legrand. La musique est une composante cruciale du récit cinématographique. Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo et les autres interprètes du film sont doublés par des chanteurs dont les voix ressemblent parfaitement aux leurs. Les rues, les maisons, les décors, les costumes changent d’apparence et de couleurs en fonction des états d’âme et des pensées des personnages. Romantique, tendre, mélancolique, le film échappe toutefois à la niaiserie et au happy-end. Selon l’actrice Virginie Ledoyen, il fait l’effet d’un «bonbon empoisonné». En 1964, Les parapluies de Cherbourg reçoit le prix Louis-Delluc, la Palme d’Or du Festival de Cannes, le prix de l’Office catholique du cinéma et, enfin, le prix Meliès 1965.
Playtime
Dans ce film «comique» sorti en 1967, Jacques Tati incarne une nouvelle fois Monsieur Hulot, le personnage populaire qui a joué une partition cruciale dans ses films précédents, Les Vacances de Monsieur Hulot (1953) et Mon oncle (1958).
Playtime se déroule dans un Paris moderniste en proie à la surconsommation permanente. L’histoire est structurée en six séquences, liées par deux personnages qui se croisent à plusieurs reprises au cours d’une journée: Barbara, une jeune américaine en visite à Paris accompagnée de touristes américaines, et Monsieur Hulot, un Français déconcerté et perdu dans une modernité trop grande pour lui. La venue des voyageuses, plus ou moins aisées, dans la mégalopole française, est annonciatrice du tourisme de masse.
Le film est dépourvu d’une vraie narration. Il met en scène la frénésie d’un monde animé par la recherche du profit et de l’utilité, mais aussi par la soif de loisirs et de divertissements caractéristique des décennies 1960 et 1970.
Le personnage de Monsieur Hulot, avec son manteau à carreau porté comme une cape à l’anglaise, sa silhouette élancée et sa pipe, fait corps avec Jacques Tati. L’acteur-réalisateur s’est comparé à Charlie Chaplin ou à Buster Keaton.Toutefois, il a renoncé à faire de son personnage comique le cœur de ses films et il a choisi plutôt de mettre en avant ses très nombreux figurants.
La vie sociale a cependant un goût quelque peu amer dans Playtime comme dans d’autres des réalisations de Tati car les gens ne s’y parlent pas vraiment. Le vieux camarade de service militaire rencontré par hasard semble ainsi ravi de montrer à Hulot son nouvel appartement, mais pas intéressé à prendre de ses nouvelles et à échanger avec lui. Les personnages vivent dans une culture des apparences qui empêchent une réelle communication. Tati observe la société contemporaine avec l’œil d’un anthropologue ou d’un sociologue. Il se moque abondamment du monde moderne, en particulier de la technique. Cependant, le regard qu’il porte sur l’humanité demeure bienveillant. Ses personnages sont plus burlesques que méchants ou violents. Même les plus caricaturaux d’entre eux conservent une part attachante ou paraissent la retrouver au gré des péripéties.
L’univers de Playtime est celui du gigantisme urbain et de la modernité technologique, tout en couleur bleu, gris ou violet pâle. On comprend à peine les mots prononcés le plus souvent en anglais par les personnages. En dépit de la quasi absence de dialogues dans ses films, Tati apporte un soin très prononcé aux bandes-son. Totalement composée en postsynchronisation, travaillée avec un soin et une minutie extrêmes, la bande-son permet par la précision de chaque élément, de donner l’impression d’une ruche dans laquelle les personnages évoluent et interagissent de manière bruyante. De l’avis de nombreux critiques, l’on peut reconnaître immédiatement un film de Tati en écoutant la bande-son, sans les images.
Pourtant, à propos de Playtime, Jacques Tati estimait que «ce film n’est pas fait exactement pour un écran, mais fait pour l’œil». «Il considérait en effet que ce film était moins le sien que celui du spectateur. "Les plans sont ainsi conçus que si vous voyez le film deux ou trois fois, ce n’est déjà plus mon film. Cela devient le vôtre. Vous reconnaissez les gens, vous savez qui ils sont et vous ne savez même plus qui a dirigé le film. C’est n’est pas un film qu’on signe comme Fellini Roma"», ajoutait Tati avant de conclure dans cet entretien en anglais par "Playtime is nobody".» (Playtime (1967), Emmanuel Dreux, Dictionnaire de la pensée du cinéma, Antoine Baecque et Philippe Chevallier, Presses Universitaires de France, 2012).
Playtime est entré dans les annales pour son immense décor et sa scène de fond spécialement construits pour l’occasion, connus sous le nom de «Tativille». Ils ont grandement contribué au budget colossal du film, évalué à 17 millions de francs (environ 3,4 millions de dollars américains en 1964). Le tout a exigé le travail d’une centaine d’ouvriers ainsi que d’une centrale électrique dédiée. Les crises budgétaires et autres complications ont fait s’étirer le calendrier de tournage sur trois ans, dont 1,4 million de francs de réparations après que le décor a été mis à mal par des tempêtes.
Tati faisait observer un brin malicieusement que le coût de construction du décor n’était pas supérieur à ce qu'il aurait coûté s’il avait recouru aux actrices Elizabeth Taylor ou Sofia Loren pour incarner le rôle principal!







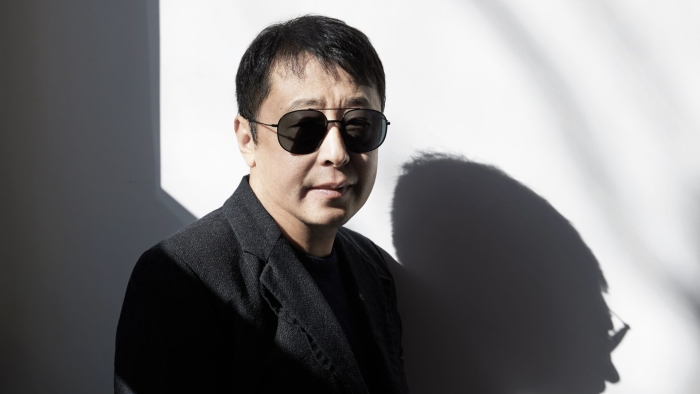



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire