Culture / L’édition, c’est sport en Suisse romande
Les Uppercut se lisent d’une traite. Le temps d’un match de foot. On se les prend dans la figure, on en ressort parfois secoué, voire carrément groggy, et pourtant prêt à en encaisser un autre. Ce qui tombe bien, parce qu’on n’a que l’embarras du choix parmi ces 23 micro-romans secs et percutants publiés entre 2017 et 2023. Il y est question de sport, de toutes sortes de sports, sous la plume de nombreux auteurs romands. L’initiateur de la collection n’est autre que l'éditeur lausannois Giuseppe Merrone, fondateur des éditions BSN Press. Entretien.
Sabine Dormond: En 12 ans d’existence, les éditions BSN Press ont publié des ouvrages de genres très divers et de très nombreux auteurs de la région. Combien au fait?
Giuseppe Merrone: Dans les 150 livres de littérature générale, des numéros de la revue A contrario qui traite de sciences sociales, la collection Campus qui publie des thèses et des travaux de recherche, une collection d’essais Verum factum, la nouvelle collection de polars Tenebris, la collection Uppercut centrée sur le sport et des livres hors collection.
Qu’est-ce qui caractérise la ligne éditoriale de BSN Press?
A moins d’avoir une maison spécialisée, une ligne se définit d’abord par exclusion. Je ne me sentirais pas à l’aise par exemple dans le registre de la science-fiction. Ma ligne est pluraliste, elle cherche à couvrir un éventail de publications littéraires ou scientifiques aussi large que possible dans les domaines que je maîtrise, en veillant à ce qu’on ne puisse pas me coller une étiquette politique. Au début, c’est plus par raisonnement stratégique ou économique que j’ai axé sur le polar. J’ai voulu me démarquer des grandes maisons déjà implantées sur la place et combler un créneau qui me semblait peu investi chez les éditeurs suisses. J’avais des auteurs emblématiques du roman noir comme Jean Chauma qui me donnaient de la crédibilité dans ce genre. Ensuite le roman noir est devenu le truc à la mode et on s’est noyé dans la masse.
Qu’est-ce qui vous a donné l’idée d’y ajouter une collection d’un genre particulier et pourquoi l’avoir appelée Uppercut?
Un éditeur n’est pas simplement un amoureux de la littérature, mais aussi quelqu’un qui doit raisonner en termes entrepreneuriaux. On cherche à proposer quelque chose de nouveau dans le catalogue. Le sport me semblait peu présent, même s’il y a des traditions littéraires autour de la boxe et du vélo. Or, c’est un phénomène social massif qui en dit beaucoup sur notre monde. Il me semblait qu’on pouvait tirer profit de cette lacune à travers une approche originale. La double contrainte pour les auteurs était de traiter une discipline sportive, tout en respectant un format très court. Pour rester dans la logique des noms latins, j’aurais pu appeler cette collection Pugiles, mais le nom Uppercut s’est immédiatement imposé à moi. Il synthétise bien l’esprit de cette collection qui cherche le KO immédiat plutôt que le combat de longue durée.
Pourquoi avoir imposé ce format qui correspond plus à la novella qu’au roman?
L’idée de départ était que ces romans courts puissent se lire pendant la durée d’un match de football. J’ai voulu transposer à la littérature les critères de brièveté et d’efficacité imposés au sport. Cette collection constitue dans sa conception une métaphore de l’événement sportif.
En quoi le sport est-il révélateur de notre société ou quelles problématiques sociétales s’expriment à travers cette thématique?
Le sport dans la pluralité de ses expressions est présent dans de multiples dimensions de la vie: qu’il s’agisse du sport professionnel avec l’argent et le dopage pour corolaires ou de l’activité physique comme souci de soi et volonté d’amélioration personnelle, des disciplines officielles et moins officielles, du spectaculaire ou de l’intime, il peut être ciment social, aliénation ou dépassement de soi. Le réel est trop large pour être appréhendé sans une organisation du regard. A travers un angle d’attaque comme le sport, on peut donner une cohérence à un monde trop disparate et chaotique.
Est-ce que tous les sports ont été traités au fil des diverses parutions?
De loin pas. Le premier texte sur le foot va paraître en novembre, il a fallu six ans pour qu’on m’en propose un. Les sports importants n’ont pas été abordés, les auteurs m’ont plutôt soumis des propositions assez marginales comme l’escrime, la voile, la course automobile, le fitness, la danse, le MMA. Ils essaient de contourner la contrainte formelle que je leur impose en prenant le sport comme prétexte. Ce faisant, ils réalisent malgré tout l’idée générale implicite.
Certains auteurs ont donc joué avec les limites de votre conception du sport?
Si quelques textes font entrer les lecteurs dans la discipline sportive avec des connaissances précises, d’autres traitent une question sociale à travers le sport. C’est aussi ce que j’attendais. La performance sportive n’est souvent pas au cœur du propos. On me propose des histoires de meurtres, de dépendance, d’enfance maltraitée, de violence conjugale, de migrants, etc.. Tous les auteurs ont fini par parler de quelque chose qui leur tenait à cœur ou qui les touchait de près. Le sport apparaît parfois même de façon très abstraite, à travers la structure du livre.
Et vous-même, quels sont les sports que vous pratiquez ou qui vous passionnent?
J’ai pratiqué le football de manière intensive, la boxe et le vélo comme entraînement, bref les sports de l’immigration. Pour le ski, on n’avait jamais vu la neige dans mon milieu. Les autres sports, je les ai pratiqués à l’école de manière épisodique. Puis l’aïkido quand j’ai vécu au Japon.
Est-ce que les livres que vous avez publiés donnent envie de découvrir de nouveaux sports ou ont-ils plutôt un effet dissuasif?
Ça dépend de l’auteur, certains dissuadent de le pratiquer, d’autres présentent le sport comme une rédemption. Certains ont écrit sur le sujet, alors qu’ils ont une aversion pour le sport et se sont pris au jeu. Mais ces micro-romans ne sont pas des manuels pour la vie saine, au contraire, ils portent souvent des regards assez sombres sur le monde.
Qu’est-ce que cette collection révèle de vos auteurs et de leur rapport au sport?
Etonnamment, il y a de vrais sportifs parmi eux. Les auteurs ne sont pas tous des adeptes du bistrot, de la clope et de l’alcool. Ça va d’un extrême à l’autre: Laure Croset cherche tous les moyens de contourner la thématique, alors que Florian Eglin est plutôt à la hauteur des pratiques qu’il décrit.
L’accueil réservé à cette collection a-t-il été à la hauteur de vos attentes?
Les premiers concernés lui ont réservé un accueil favorable, ce sont eux qui ont le plus vite adhéré à l’idée. Je reçois énormément de tapuscrits pour cette collection. Sans avoir de données statistiques, j’ai aussi l’impression que beaucoup de lecteurs apprécient la collection. Ce n’était pas gagné d’avance, parce que les gens qui lisent n’ont pas forcément d’intérêt pour le sport et les sportifs ne sont pas forcément des lecteurs. Au départ, la presse a eu de la peine à cerner l’intention et beaucoup de critiques ont regretté la brièveté de ces romans. Une critique récurrente qui s’adressait plus à l’éditeur, puisque les auteurs ne faisaient que respecter le format demandé. Maintenant, ce reproche a disparu et les échos médiatiques sont plus favorables. Il a fallu un temps d’adaptation.
Et vous-même, êtes-vous content du résultat?
Ce qui me plait dans la formule, c’est la nécessité de resserrer le propos. Souvent, ça écarte de nombreuses maladresses qu’on trouve dans les romans, comme les longueurs et les défauts de constructions. Bref, je trouve que la contrainte a été payante, elle a stimulé la créativité et le résultat est souvent bien ficelé. C’est un exercice intéressant à tous points de vue, même pour l’humilité, car certains ne s’y étaient jamais livrés et ont eu plus de peine que prévu. Au final, il y a même eu deux livres primés.
Est-ce aussi une forme de sport que de se lancer dans l’édition en Suisse romande et qu’est-ce qui caractérise ce métier?
C’est du sport de le faire en tant qu’indépendant. Dans ces conditions, il faut réussir à vivre de ses compétences. Cela demande de concilier la pertinence littéraire et la pertinence économique de ses choix. Pour la plupart des gens, une maison d’édition relève plus de la passion que du profit. Avec un cadre associatif et en publiant trois livres par années à côté de son activité professionnelle, on peut raisonner en ces termes. Mais pour un éditeur indépendant, c’est aussi une entreprise. D’un point de vue purement commercial, arriver à vivre dignement est déjà un bon résultat. Comme l’écriture, le métier principal n’est pas celui qui nous nourrit. C’est un sport, mais ça ne doit pas être une guerre.




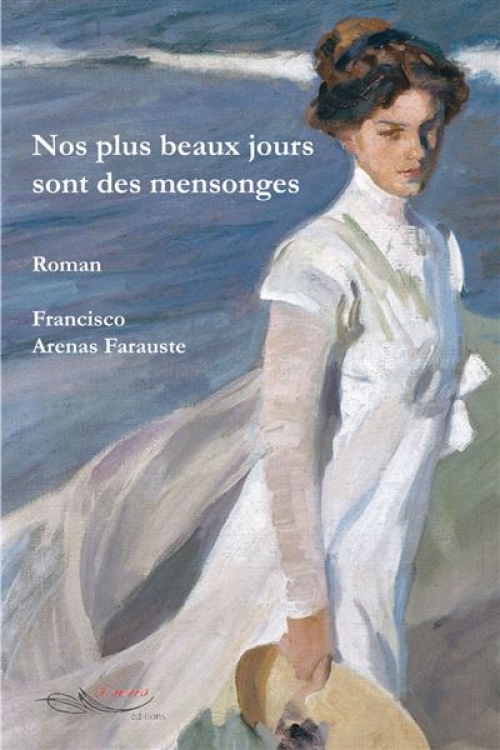



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire