Culture / Allan Ball, dans «Mon oncle Frank», exorcise la malédiction frappant les homos
Après «American beauty» et «Six Feet Under», le réalisateur américain aborde un sujet qui lui tient à cœur avec autant d’humour que de profonde empathie.
Cela se passe à la fin des années 40 du siècle passé – si présent encore au demeurant à tant d’égards – quelque part en Caroline du Sud où un brave père de famille très fermement accroché à sa lecture de la Bible, comme il sied en ses régions de petits blancs puritains, surprend son aîné Frank au lit, tendrement enlacé à un autre beau garçon du voisinage au prénom de Sam, et lui lance le lendemain matin qu’il lui interdit absolument de jamais revoir son ami sans quoi il les tuera tous deux comme le recommande le Dieu juste et bon promettant les glaces brûlantes de l’enfer aux pécheurs tombés dans ce vice affreux.
Sur quoi le jeune Frank, terrifié par la double menace de son père et du Dieu qui surveille et punit, de se précipiter auprès de Sam, de l’enjoindre pieusement de ne plus jamais l’approcher et de s’amender sur le chemin de la seule vie normale; et Sam, peu après, de noyer son désespoir dans les même eaux du lac où il a découvert avec Frank l’exultation des corps en leur sensuelle et solaire innocence, laissant au cœur du survivant une blessure inguérissable et autant de culpabilité.
Si ce traumatisme existentiel est évoqué par quelques retours en arrière très émouvants, le récit linéaire de Mon oncle Frank passe par la voix d’une jeune fille de 18 ans, Elizabeth dite Beth, nièce de Frank.
Elle-même passionnée de lecture, Beth s’est toujours sentie proche de Frank, aussi sensible que bienveillant à son égard mais maltraité par son père, sans qu’elle ne se l’explique à chaque fois que, de New York où il a fui depuis des années et a fait une carrière de prof de lettres, Frank revient à Creekville qu’elle-même va quitter pour des études que son oncle-mentor lui a recommandées comme choix de vie personnelle et indépendante.
Un réalisme imprégné de poésie
Alan Ball, dont on se rappelle le «poème» que constituait American beauty, est ce réalisateur capable d’exprimer visuellement la magie d’un instant par la seule «danse» d’un sachet vide tournoyant dans la brise, autant que de dévoiler la part cachée des êtres comme il l’a fait dans la série non moins mémorable de Six feet under, abordant les rites funéraires avec une drôlerie alliée à l’acuité d’une observation très fine des mœurs de la middle class américaine. On se rappelle d’ailleurs, à ce propos que le thème de l’homosexualité se trouvait déjà abordé dans la série par le truchement du plus jeune fils de la famille des croque-morts…
Pour autant, le «thème» en question, traité mille fois par le roman ou le cinéma lors des cinq dernières décennies, et qui alimente aujourd’hui une kyrielle de courts et moyens métrages classé LGBTQ (un genre en soi sur Youtube où le productions asiatiques surabondent en romances à l’eau de rose), ne constitue pas la part majeure et originale de Mon oncle Frank, petite fresque sociale et psychologique incisive et souvent comique qui nous conduit d’abord à Creekville, pour les «présentations», puis à New York où Beth fête son admission à l’université et retrouve son oncle en compagnie de son premier petit ami Bruce, découvrant du même coup le compagnon de Frank de longue date (ignoré de presque tous) en la personne du Saoudien Walid solide et sympa, ingénieur dans l’aéronautique et fatigué du jeu de cache-cache de son couple dont l’existence reste également cachée à sa propre famille.
A l’époque d’un nouveau militantisme fleurant souvent la revanche, Mon oncle Frank semblera peut-être trop gentil au «milieu» par ailleurs très composite que désigne le fameux acronyme à rallonge. Or ce film s’adresse à tout le monde, brassant les sentiments de tout un chacun et sans se moquer particulièrement des «arriérés» naturellement ou culturellement homophobes.
L’oncle Frank lui-même apparaît «comme tout le monde», sans trace des maniérismes convenu à la manière de La Cage aux folles ou de The boys in the band, il n’a jamais fait de coming out - d’ailleurs la chose n’est pas un must en ces années Nixon ─, et lorsque le supposé boyfriend de Beth lui fait des avances en jeune homo-qui-s’assume sûr que sa beauté lisse est irrésistible, il l’envoie paître.
Quant à Beth, qui ne sait rien du traumatisme initial vécu par son oncle, elle se fiche de sa «différence» et cède illico au charme de Walid, lequel fera plus tard craquer la mère de Frank qui a toujours su à quoi s’en tenir à propos de celui-ci – «les mères sentent ces choses», dira-t-elle elle-même.
Que tout s’apaise, faute d’être résolu…
Bref, c’est tout un entrelacs subtil de relations familiales ou sociales qu’Alan Ball fait jouer par le truchement de personnages très finement dessinés, un dialogue souvent piquant et des interprètes d’une sensibilité à l’avenant, qu’il s’agisse de l’irrésistible Sophia Lillis dans le rôle de Beth, de Paul Bettany marquant toutes les nuances de fragilité et de courage caractérisant Frank, ou de l’acteur libanais Peter Macdissi (Walid) dont l’intelligence du jeu n’a d’égale que son aura naturelle.
Si les actions successives se situent à l’aube des année 50 dans un État où l’homosexualité est punissable, puis au début des années 70 où elle se vit plus librement dans les «niches» culturelles des grandes villes, les observations et les questions que pose ce film, impliquant en outre, par Walid, la situation au Moyen-Orient, devraient toucher chacune et chacun en cela que, par delà les «préférences sexuelles», il se rapporte à l’ensemble des réactions que nous vivons dans nos relations intimes, dans nos famille ou nos quartiers, nos emplois ou nos voyages.
Si le mariage pour tous est aujourd’hui légal en Caroline du Sud, en 1973, le testament du père de Frank révèle, à la famille réunie stupéfiée, que son fils ne mérite que d’être déshérité et banni du clan…
Or, paradoxalement, cette fureur vengeresse posthume se retourne contre le patriarche en rapprochant la famille du «maudit», au point que chacun dans l’ultime scène «trouve sa place», selon les mots de Beth.
Est-dire que tout soit résolu? Probablement pas, mais le regard d’Alan Ball témoigne, au moins, d’un essai de pacification – où Beth et Walid ont les premiers rôles – qui relève autant de la bonté de chacun que d’un souci d’équité partagé.
En cette période de pandémie, Mon oncle Frank, qui a obtenu le prix du public au dernier festival de Deauville 2020, est visible en streaming sur la plateforme d’Amazon Prime Video.





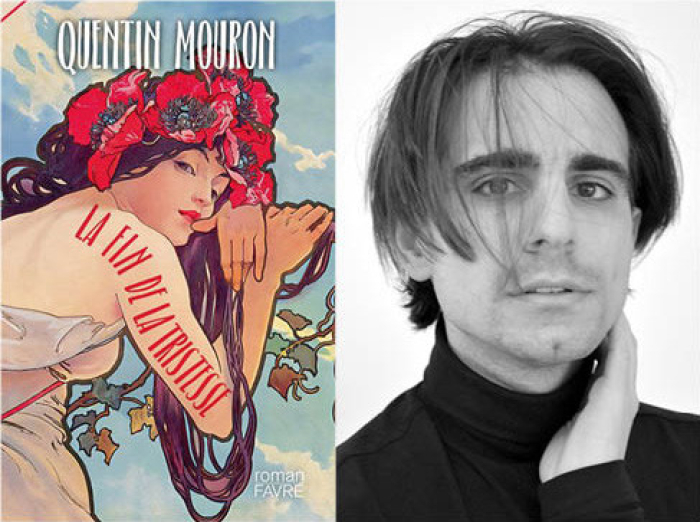
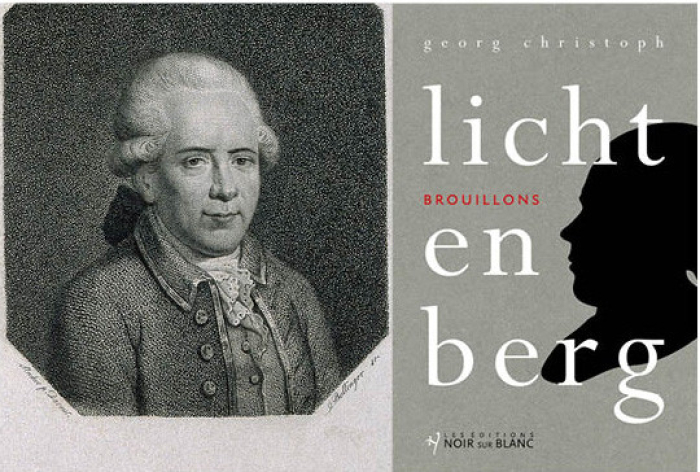

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
2 Commentaires
@Gio 19.02.2021 | 08h41
«Merci pour cette belle critique. Des années ont passé depuis que trois de mes copains à la fin des années 70, avaient tout bonnement été flanqués à la porte de chez eux par leurs parents; en disant parents, c’est à leur père respectif que je pense, les femmes n’avaient pas vraiment leur mot à dire. Merci d’avoir mentionné qu’il ne sera pas question uniquement d’homosexualité qui est devenue la normalité dans pratiquement toutes les séries qu’on nous propose aujourd’hui. J’ai hâte de découvrir ce film.»
@cldega 21.02.2021 | 12h30
«Merci pour cette belle critique qui m'a vraiment donné envie de voir le film.
Et Ô bonheur, j'ai Amazon Prime Video. J'y vais de ce pas.»