Culture / Et la Suisse sortait de l’Histoire
Pour la première fois depuis sa parution en 1977, le roman d’Henri Debluë, «Et Saint-Gingolph brûlait», est réédité aux éditions de l’Aire. Récit de l’irréel comme de l’impuissance, il met en avant les ressorts et les ravages psychologiques de la neutralité de la Suisse en 1939-1945. A partir d’un drame survenu à la frontière, Debluë montre comment les citoyens se sont trouvés exclus du cours de l'histoire et du monde, réduits à de rêveuses créatures apathiques et égoïstes.
«Au bord de chaque fleuve, il existe des anses immobiles, où s’organise une vie stagnante, somnolente, hors des courants.»
De 1939 à 1945, dans le fracas du monde, la Suisse est cette anse immobile. A Montreux, au bord du lac, quelques créatures des rivages somnolent; s’agitent dans des flaques leur semblant souvent la mer. Ce sont les personnages du roman d’Henri Debluë, Et Saint-Gingolph brûlait.
Le narrateur n’a pas de nom, tout comme cette histoire n’a pas de héros. Nous sommes en 1943 et il attend. De partir pour l’école de recrue, d’abord. Et surtout, que quelque chose se passe. Il lit les quelques nouvelles que la presse diffuse, avec une indifférence «pathologique», avoue n’avoir «guère l’esprit politique», en dehors de quelques vues sur la lutte des classes; et il regrette. «Nous étions accoutumés à l’improbabilité d’un danger immédiat». L’histoire, la vraie, avec ses dangers et ses héros, se trouve de l’autre côté des frontières, de l’autre côté du lac. «Nos frontières étaient fermées, et nous vivions dans le sentiment qu’elles l’étaient à jamais, nous ne les franchirions plus». Le calme est une prison, en 1943, sur le quai des Fleurs.
Le désert des Helvètes
Aussi tout est entouré d’une brume de rêve, d’un sentiment d’irréalité; le mot revient à plusieurs reprises sous la plume d’Henri Debluë. Comme confinés dans une chambre de malade – la comparaison est de l’auteur – les Suisses ne font que percevoir confusément les bruits et les voix du dehors. «Mais le sentiment d’irréalité n’élude pas le malheur; il en est parfois le plus sûr augure.»
Le lac étant l’immobilité absolue, reflet de celle de l’existence des Suisses, mise entre parenthèses, on pense au Rivage des Syrtes de Julien Gracq. Les grands hôtels de la rive sont comparés à des vaisseaux endormis, les riches clients habitués ayant déserté. A quelques rares exceptions, dont un officier allemand, le patron de Wang, Chinois égaré en pleine Europe et compagnon d’ennui du narrateur. Tous deux errent devant la boutique d’art oriental, au pied du Montreux-Palace, cette «fissure dans le mur de la claustration nationale».
Il semble que toute l’existence, que tout le destin du monde, et le leur même, soit vu comme à travers une vitrine. Après tout, que risque-t-on à se promener dans Montreux en pleine nuit? «Une contravention»... Ce sera la première mention de la tragique ironie qu’il y a à faire comme si de rien n’était quand le continent est à feu et à sang.
Wang, lui, n’est préoccupé que par un désir de vengeance vis-à-vis de son employeur, dont il se plaint des chicanes. «Peut-être l’humiliation quotidienne lui donnait-elle un succédané de destin?» On pense plus encore au Désert des Tartares, dans cette attente que rien ne vient résoudre, dans cette tension stérile sur fond de guerre.
Et tous sont seuls. «Chacun retourne à la solitude de son destin». Est-ce à dire que la Suisse n’a donc pas de destin national? Rien qui fédère les hommes entre eux, en dehors des règlements, du respect des lois et de la police, parce qu’il le faut bien? Au temps du Réduit national, le pays est justement décrit par Henri Debluë comme un monde rétréci, clos et sans horizon, barricadé. On se défie de l’extérieur, en atteste le personnage du bien nommé Krakra. S’adonnant à la xénophobie la plus crasse, Krakra n’aime pas les Juifs ni les francs-maçons, sans que l’on sache bien pourquoi. Il s’en prend violemment à Wang, parce qu’il est étranger. Il approuve Hitler, parce qu’il préfère être tranquille chez lui, entre gens qui lui ressemblent.
Surtout, que rien ne vienne troubler la lisse surface du lac.
Quand quelque chose arrive...
Le personnage de l’Urne, un original hanté par une histoire fantasmagorique d’urne funéraire et d’héritage, est décrit à sa première apparition comme «indifférent, comme Wang tout à l’heure, à l’incendie du Bouveret, que j’avais moi-même oublié». Car quelque chose s’est passé. En pleine nuit, un avion s’est écrasé sur le village valaisan du Bouveret, que l’on voit depuis Montreux, et a causé un grand incendie ravageant la forêt. La lueur de l’explosion a un instant illuminé les façades muettes de la rive, des vitrines ont volé en éclats, et depuis un moment, les sirènes hurlaient dans l'indifférence générale.
La Suisse, jouant son rôle de pays neutre avec zèle, sous-entend l’auteur, refuse le survol de son territoire aussi bien par les avions alliés que par les Allemands, aussi est-il arrivé qu’un appareil britannique soit abattu. En l’occurence, on ne sait s’il s’agit ou non d’un accident.
Les Montreusiens réveillés accourent en robe de chambre, scrutent la montagne, échangent impressions et stupéfaction. Mais bientôt, les bouches baillent, chacun retourne à son sommeil. A l’irréalité de l’événement succède la déception devant sa réalité. «Ce n’était rien», semble-t-on dire, ce n’était que ça... Et le calme retombe comme une chape, on parlera de l’avion écrasé le lendemain dans les journaux.
Les personnages sont pourtant saisis d’une imagination fertile et morbide. Henri Debluë les décrit aussi comme des marins enfermés dans la cale d'un navire, cherchant à deviner par miettes et bribes ce qui se passe sur le pont. Ainsi le narrateur, dans une promenade nocturne, croit-il apercevoir près d’un chantier un amoncellement de cercueils d’enfants. Quelle déception, une fois encore, lorsqu’il comprend que ce ne sont que des marches d’escaliers! Il ne reste aux hommes frustrés par le réel, inaccessible ou pas à la hauteur, que les rêves.
Point culminant de l’irréalité, du fantasmatique et du fantomatique où baigne le narrateur, le roman contient deux longs récits de rêves. Dans le premier apparaissent des visages qui l’«ignoraient en toute innocence». On fera facilement le parallèle historique. Puis des visages aux lèvres cousues, qui parviennent tout de même à parler. Alors, se souvient le narrateur, «j’avais éprouvé la certitude de voir le vrai visage de l’héroïsme». Le second récit est celui d’un cauchemar que le narrateur fait dans le train qui le ramène à Montreux, après avoir terminé son service militaire. Il se voit parader dans le hall d’un grand hôtel, toiser les garçons, dans une grande insouciance. Puis «la situation s’était dégradée de manière assez rapide, mais imperceptiblement. Tout s’était joué dans d’infimes détails. Ainsi qu’il en va le plus souvent des fatalités, les éléments s’étaient combinés sans ruptures ni degrés visibles, dans une sorte de fondu-enchaîné.» Comme il en va de l’histoire du monde... Tâchant de donner un sens à ce cauchemar, qui se termine par une séance de torture, le narrateur relève: «ce qui me frappait, c’était l’indifférence.»
Les rêves offrent une vision symbolique du réel, du présent de la guerre. Paradoxalement, ils sont le lieu de confrontation à la réalité. Le narrateur y est le jouet sans volonté des événements (et la Suisse l’est-elle aussi?).
Mais ces songes, l’imagination et ses ruses, l’attente sans objet, sont tout de même préférables, car moins décevants, à un véritable événement. Le crash de l’avion au Bouveret, de ce fait, paraît être la péripétie majeure du roman, alors qu’elle n’est pas celle annoncée par le titre; juste un fait divers de la guerre, une anecdote à peine, dans le cours de l’histoire, qui éclaire de ses lueurs d’incendie le quotidien alangui des personnages.
Les peuples heureux n’ont pas d’histoire
Le narrateur a donc fini par revenir du service militaire en novembre 1944. Et un autre événement est arrivé. Mais... Il s’est produit en son absence.
La tragédie de Saint-Gingolph a eu lieu dans la nuit du 22 au 23 juillet 1944, le roman la transpose au 1er septembre. Le massacre est l’acte de représailles de la Wehrmacht et des SS contre des actions de la Résistance dans le village franco-suisse de Saint-Gingolph, situé sur la frontière entre la Haute-Savoie et le Valais. Les autorités de la partie suisse tentèrent de négocier, mais le commandement de la garnison allemande maintenait que l’ordre était donné de raser le village. Armés de lance-flammes, les SS incendièrent les maisons, les granges, et prirent des otages. Le gigantesque incendie était visible depuis la rive vaudoise du Léman, dans l’après-midi du 23 juillet.
Mais cet événement majeur et traumatisant, tant pour les civils que pour les militaires suisses, forcés de ne pas intervenir, n’occupe qu’une page sur les 150 que compte le roman. Comme s’il était un archétype de tout ce qui pouvait arriver dans une guerre voisine à laquelle on ne prend pas part, il ne suscite pas l’étonnement ni l’effroi du narrateur. «Les soldats de la Brigade de montagne 10 assistaient au meurtre»; «les petits gars avaient dû se contenter d’attendre». Comme si cet épouvantable épisode n’était, de toute façon, pas non plus à la hauteur de l’imaginaire et de l’attente. L’absence du narrateur suggère même qu’il ne le «méritait» pas.
Quant au titre, avec cette étrange conjonction de coordination «et», il évoque une concomitance, la coexistence à égale valeur du réel de la guerre et du réel quotidien, banal: «Lorsque je me trouvais à l’école de recrue, l’Urne est mort, Camille pratiquait le marché noir, Wang était en prison... et puis Saint-Gingolph brûlait, cette année-là», peut-on entendre dans ce titre.
Finalement, les Suisses, enfermés dans la neutralité de leur Etat, vivent et voient la guerre, même sous ses aspects les plus crus, à la manière des ombres projetées sur les parois de la caverne. Les témoins de l’incendie n’ont, précisément, assisté qu’à un incendie. Le reste relevait de l’imagination.
Il faut bien dire que ces traits sont assez communs à l’humanité entière: le confort de la courte-vue et de l’égoïsme, le frisson du sensationnel à condition que ce ne soit pas devant notre porte... C’est ce que dénonce Henri Debluë, en prenant la Suisse pour exemple de cette pente naturelle, de cette «fusion de la conscience» qui anesthésie les esprits. Ainsi le roman constitue-t-il un violent réquisitoire, étayé par les faits, contre la politique de la Suisse pendant la Seconde guerre mondiale. Une attaque en règle contre la neutralité, qui met hors de l’histoire un peuple entier, et le condamne de fait à une indifférence de spectateur capricieux. Qui réduit ses citoyens à des infirmes, qui met hors-jeu les soldats et les hommes de la rue.
La dernière phrase, comme un espoir de transcendance, appelle à la réalisation de ces aspirations frustrées à l’héroïsme et à l’action. «Il me paraît impossible que la promesse de l’enfance ne soit jamais tenue», que les Suisses n’aient pas de destin, ni individuel, ni national.





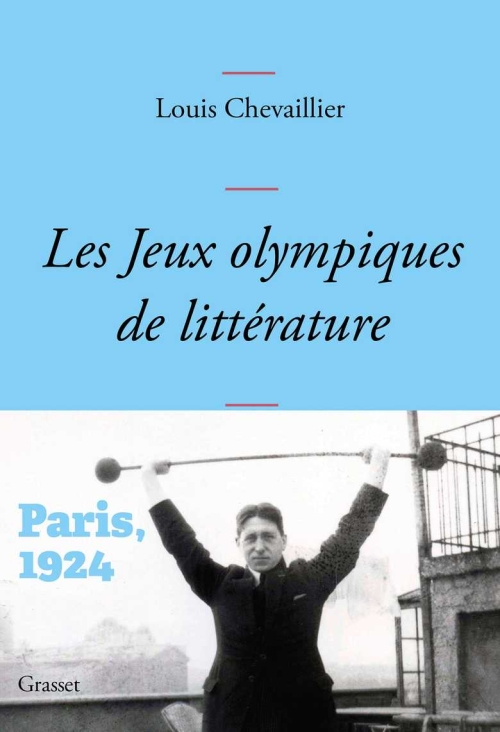



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
2 Commentaires
@alexgi 09.09.2023 | 16h11
«Je n'ai pas lu ce bouquin mais je suis d'accord avec l'auteur. Il est en effet regrettable que la Suisse n'ait pas participé dans un camp ou un autre à la guerre. On aurait de beaux monuments aux morts dans chaque commune sur lesquels on pourrait lire les noms de nos pères ou grands-pères; Lausanne, Bâle ou Genève auraient été coventrysées bien avant d'être piétonnisées et avec un peu de chance Villars-sur-Glâne serait devenue notre Oradour. On aurait même peut-être des images de Conseillers fédéraux et de hauts fonctionnaires de l'époque pendus pour faits de Collaboration devant les ruines du Palais fédéral. Bref, quelques dizaines ou centaines de milliers de morts auraient rendu les manuels d'histoire suisse moins ennuyeux. Quelle saloperie la neutralité !»
@JLK 22.09.2023 | 14h57
«Au rappel peu glorieux dont il est question à propos du livre d'Henri Debluë, l'on peut ajouter une page du grand Ramuz, datant de 1916, où l'écrivain, avisant la rive d'en face depuis sa fenêtre, se dit qu'en effet il est terrible de penser aux jeunes gens qui se font massacrer là-bas, mais qu'en somme il est non moins affreux, voire pire, de penser à eux de notre rivage paisible, et pendant ce temps son confrère Blaise Cendrars saigne...»