Culture / Un plaidoyer universaliste pour la nation
L’enseignement manque beaucoup à Didier Lemaire. Ce professeur de philosophie qui a exercé pendant 20 ans dans un lycée de Trappes (Yvelines) s’en est retiré après avoir dénoncé la montée de l’islamisme dans sa ville et reçu pour cela des menaces. On le ressent à la lecture de cette «Petite philosophie de la nation», adressée tant aux spécialistes qu’aux novices en philosophie politique. Avec pédagogie et méthode, il fait le tour d’un objet assez peu discuté au contraire d’autres grands mots comme l’Etat, la démocratie ou encore la citoyenneté.
Nous avons bien eu, en France, l’occasion d’une petite empoignade suite à une formule du Président Macron. «Une nation, c’est un tout, organique», a-t-il déclaré lors de son interview du 14 juillet dernier, pour souligner l’importance du travail et de la production dans le financement de notre modèle social, auquel, grosso modo, il s’agit de mettre chacun sa pierre. Aussitôt, les «anti» ont fondu sur le qualificatif d’«organique», dans lequel transparaitrait (forcément) une référence à la vieille tradition d’extrême-droite barrésienne, voire un saupoudrage de nationalisme poutinien. Des éditoriaux et des analyses ont été échangés quelques jours durant, et de nation, il ne fut plus question.
Quelques définitions
Didier Lemaire n’entend pas faire une histoire philosophique de la nation mais «cerner une notion que nous ne comprenons plus». Quelques définitions s’imposent donc pour démarrer. La nation trouve son origine, en France, en 1789, lorsque le peuple se dote d’une représentation politique qui fonde et garantit la souveraineté des lois. Mais le peuple n’est qu’une partie de la nation. Celle-ci englobe, du fait de la stabilité des institutions politiques, tous les citoyens passés, présents et à venir «dans une continuité historique». Ainsi, la nation «constitue une réalité au-delà des citoyens eux-mêmes, une réalité abstraite et générale».
«La nation est la condition de la représentation du peuple», elle existe à partir du moment où les représentants du peuple sont rassemblés. Comme cela est proclamé lors du Serment du Jeu de Paume, le 20 juin 1789, «partout où ses membres sont réunis, là est l’Assemblée Nationale».
Pour le dire encore autrement et s’écarter de ces origines franco-françaises, «si la nation n’était pas souveraine, source de toute autorité, elle ne serait plus la nation. Un individu, un roi, ou un corps social règnerait sur elle.» De manière imagée: «au théâtre, la nation serait le personnage couché sur le papier, tandis que le peuple serait voué à l’incarner». Dans une incise qui concerne particulièrement la Suisse, l'essayiste ajoute que la présence d'une langue unique n'est pas une condition sine qua non pour faire nation. Le multilinguisme suppose «seulement» un degré plus élevé dans l'élaboration de la culture politique.
La thèse de l’auteur, c’est que la gauche s’est, depuis plusieurs décennies, en France comme dans d’autres pays occidentaux, rendue coupable d’avoir abandonné la nation comme une idée désuète, en l’occurrence à la droite. Plutôt que de demeurer attachés à ce que Marx considérait comme une «communauté illusoire», les partis de gauche se sont tournés vers la défense des minorités, ayant également abandonné la lutte des classes. Ainsi combattent-ils la nation telle qu’elle fut conçue par les révolutionnaires de 1789, aussi bien que le principe de non discrimination1.
Didier Lemaire plaide pour l’application de ce seul principe. Non qu’il établisse de facto et de manière performative l’égalité des droits qu’il proclame, mais parce qu’il est précisément le garant de l’existence même de la nation. L’égalité de fait ne peut se réaliser que dans et par l’universalisme.
Contrairement à la tradition des essais politiques des XVIIème et XVIIIème siècles, Petite philosophie de la nation se prête peu à la description des différents régimes contemporains. Didier Lemaire souligne pourtant qu’il est crucial pour nos démocraties de comprendre à nouveau ce qu’elles sont. Sans attendre que l’adversité nous y oblige. Car «en dehors du peuple ukrainien, quel peuple, aujourd’hui, sait encore ce que signifie être une nation?»
L’individu...
Le pivot du raisonnement, c’est l’individu. Un parti pris qui peut sembler contre-intuitif: comment mettre l’individu au cœur d’une conception universaliste? L’individu, qu’il ne faut pas entendre au sens d’une célébration de l’individualisme, synonyme d’égoïsme et de repli sur soi, est la particularité de notre civilisation, explique l’auteur. Nous sommes les héritiers de la (re)découverte de la subjectivité par les humanistes, du Cogito de Descartes, de l’art du portrait de Rembrandt ou des destinées des personnages des romans classiques. L’originalité du propos est d’utiliser l’individu comme outil pour penser tout à la fois contre le totalitarisme et le délitement de la nation. Car, comme le posent les définitions préalables, la nation n’est que politique. Elle n’a rien à voir avec l’essence ou l’identité des peuples, et il n’existe donc rien de tel qu’une «identité nationale».
L’individu est la clé de l’universalisme dès lors que l’on comprend qu'il «ne se définit par aucune autre qualité particulière. On ne peut le caractériser que par la faculté de dire ‘je’».
C’est le contraire de l’assignation à une place, à une fonction (comme le fait Platon dans la République, rappelle le professeur), à une classe (Marx) ou encore une identité, une origine. C’est la possibilité laissée aux hommes de choisir leur vie. En ce sens, et pour tacler une première fois les mouvements multiculturalistes woke, que «la culture d’origine n’est qu’une origine dont on a oublié les origines».
La nation n’est que l’«expression de la reconnaissance politique de l’individu dans la société»; elle est «formée d’individus qui se reconnaissent les uns les autres comme tels».
... et ses ennemis
L’auteur défend ici un positionnement de gauche humaniste et universaliste. La portée de l’essai est d’autant plus grande qu’il désigne ses ennemis – et les ennemis de la nation – sous la forme de concepts, pas par des exemples circonstanciés, ce qui accroit le pouvoir clinique de la démonstration.
Il pose la nation comme rempart au nationalisme. Dans le nationalisme, le «nous» institué par le droit est transformé en un «nous métaphysique». Il est la conséquence de la création d’un mythe identitaire, un discours de communion aux contours aussi vagues que ceux d’un portrait astrologique: nous sommes ceci et cela, les autres sont ceci et cela de différent...
Mais, ajoute-t-il, le nationalisme n’est pas l’apanage de la droite. Celui-ci est en effet également, et ce qui semble paradoxal, porté par la gauche néomarxiste. Une grande partie de l'essai est consacrée à cet argument et à un appel à la vigilance. «Le nationalisme de demain sera probablement postnational», «antiraciste», «pour lui, la vraie nation est l’image inversée de celle des nationalistes classiques (...) et tant pis pour les personnes qui ne veulent pas se définir par la couleur de leur peau!»
Là où ce type de nationalisme «en négatif» menace sérieusement l’unité de la nation, c’est par le rôle et la nature qu’il octroie à l’individu. Individu qu’il rejette, en réalité, sous le prétexte que c’est à la société de constituer l’homme, et non l’inverse. Aucune responsabilité politique, «hormis la loyauté au groupe» n’est conférée au citoyen. L’individu n’est plus un sujet autonome.
Assigner les individus d’abord à leur appartenance aux «dominants» ou aux «dominés», sans possibilité d’émancipation, constitue à ce titre un mode de pensée fasciste, une organisation clanique et contraire au principe d’égalité. Et la charge contre ce que l’auteur désigne comme «le sophisme woke» va plus loin encore. Ce dernier mine la possibilité même de la société fondée sur des relations entre individus, c’est-à-dire la nation. Il sape les fondements de l’état de droit: «les relativistes voient l’universalité des lois comme la forme déguisée de l’oppression puisque cette universalité ne serait jamais que celle d’une culture, la nôtre en l’occurence, imposée aux autres cultures.» Et se rend coupable, sous couvert d’antiracisme, de conceptions identitaires peu différentes de celle de l’extrême-droite traditionnelle, racistes. «Ils traitent les individus comme de simples spécimens interchangeables d’un groupe culturel défini par des caractères intangibles et immuables».
Veille et compréhension
Le nationalisme, de quelque bord qu’il soit, prospère sur l’affaiblissement de la nation, autant qu’il y contribue. Pour parer à cela, Didier Lemaire propose bien sûr de renforcer le rôle de l’éducation (nationale), comme ciment de la nation, dans l’émancipation des individus.
La menace est bien réelle, et elle est, affirme-t-il, totalitaire. Dans un dernier mouvement, l’auteur définit en effet le totalitarisme comme l’extermination (physique, psychologique ou bien les deux) de l’individu. La surveillance exercée par ces régimes sur leur population abolit l’autonomie. La délation et la suspicion qu’ils entretiennent détruisent toute possibilité de lien. La terreur intellectuelle est instaurée dès lors que les individus, déjà assignés à des groupes («dominants» ou «dominés» ici) sont enfermés dans les catégories de «bons» et «mauvais», de «victimes» et «coupables». Sur le modèle de la secte (et l’on reliera la dimension religieuse du totalitarisme soulevée par Didier Lemaire à l’exposé du philosophe Jean-François Braunstein dans La religion woke, Grasset, 2022), les «purs» condamnent les «impurs» pour ce qu’ils sont, pour ce qu’ils pensent, et annihilent toute possibilité de dialogue.
Seules la vigilance et surtout la compréhension qu’une nation a d’elle-même peuvent élever des barrières pérennes contre les dérives totalitaires. Didier Lemaire reprend ici les vues de l'anthropologue Marcel Mauss: «une nation serait une société qui a conscience d’elle-même en tant que société, pas seulement en tant que groupe ou qu’unité distincte d’un autre groupe». Et «la nation, c’est le pouvoir de la société se donnant une unité par l’institution réfléchie de son organisation politique». Elle est nourrie, créée et recréée par un idéal fédérateur qu’il faut entretenir et surtout comprendre, même et d’abord au sens physique.
Or, nous comprenons-nous encore nous-mêmes? Comprenons-nous encore ce que nous sommes? Cet enjeu de compréhension et d’entretien d’un idéal commun est mis à l’épreuve par les crises qu’une société traverse, et que nos sociétés traversent de fait ces dernières années. Quand les difficultés économiques fragmentent l’unité nationale, quand les désaccords politiques et sociaux isolent les citoyens, chacun campé sur ses positions, quand la perte de sens les fait se tourner vers des mouvements religieux, au sens large, se pose en effet le défi de la compréhension: que sommes-nous, que sommes-nous les uns pour les autres, comment voulons-nous continuer de vivre ensemble?





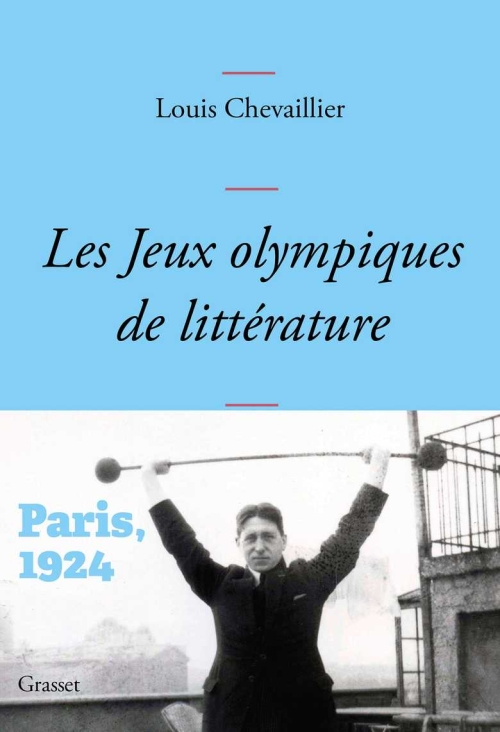



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire