Culture / L'irrépressible amour de Gérard Prunier pour un continent insensé
Comme le dessinateur Robert Crumb auquel par moments il peut faire penser, Gérard Prunier va sur ses 80 ans, et, avec un indéniable brio, il vient de réussir sa première incursion dans le domaine de la fiction. Son recueil de treize nouvelles, «L’Amour est plus dangereux que la mâchoire des crocodiles», navigue sur une trentaine d'années et entre six pays d’Afrique de l’Est.
Il ne s’agit pas d’une autobiographie mais d’une série de vignettes sur les spécimens incroyablement divers d’individus mâles et femelles que Gérard Prunier a croisés, aimés, détestés, de gens avec qui il a fraternisé ou pas et que, parfois, il a vu mourir.
A mi-chemin entre le Corto Maltese d’Hugo Prat et le Charles Marlow d’Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, avec un côté délires sexuels à la Crumb donc, décrivant à la fois des moments quotidiens et des trips hallucinés, burlesques et saccadés, son livre se passe entièrement dans une région du monde dont il est un spécialiste universitaire reconnu et pour nous, de langue française, une région restée exotique parce qu’anglophone, et dont nos médias ne nous parlent quasi jamais, celle de la Corne de l’Afrique et des Grands Lacs.
Enseignant
La première nouvelle, «Rites funéraires», se passe en Ouganda. Au loin, mais très loin, on entend des rafales de tirs d’armes à feu, on tue. Nous sommes au crépuscule, à l’heure du gin and tonic, au bord du fleuve avec des aigrettes, des hérons gris, des hippopotames, des vipères, des orchidées et des hibiscus. Puis au matin, arrivant d’Entebbe, cela fait une semaine qu’ils dérivent, des cadavres apparaissent, de grotesques ballons entourés de nuages de mouches vrombissantes et gonflés par des gaz de décomposition. Qui va les enterrer? Les collègues africains ne peuvent pas. On pourrait les considérer comme des complices de ceux qui les ont exécutés. Robert se propose mais il veut un muzungu (un blanc) avec lui. C’est la première récurrence de ce terme, leitmotiv du livre. Le narrateur se propose. Avec Robert, ils se partagent une bouteille de waragi et d’acres petits cigares rwandais. Sortir les corps de l’eau est archi galère car ils éclatent en dégageant d’épouvantables gaz méphitiques.
Un salaire de coopérant représente quatre fois un salaire de métropolitain. Notre conteur est, selon la tradition anglo-saxonne qui veut qu’on s’occupe du corps et de l’esprit, prof d’histoire et de natation dans la meilleure école secondaire catholique du pays. Au cours d’un coup d’Etat organisé par les Anglais, Idi Amin Dada a pris le pouvoir et tout ce qui pense, journalistes, universitaires, politiciens, s’est enfui en Tanzanie. Les soldats des ethnies qui soutenaient Milton Obote disparaissent. On jette leurs corps en tas dans la brousse et les hyènes viennent les dévorer. On fait de même avec les journalistes américains trop curieux.
«Pourquoi veux-tu rester en Afrique?» demande Robert à notre héros.
«Parce que vous êtes vivants. Avec tout votre pus et tout votre sang. Avec toute votre folie. Parce que l’Europe est morte et que vous êtes vivants», lui répond-il.
«Votre jupe est trop courte», la seconde nouvelle, se passe aussi en Ouganda.
Idi Amin Dada, de retour de Libye, décide d’expulser tous les Indiens du pays. Le récit nous parle de Maria, une Indienne catholique, dont le frère est prof, collègue du narrateur. Tous leurs amis sont noirs mais elle, elle veut épouser un Indien issu d’une famille de brahmanes. Ou un muzungu catholique. Suite à une énième attaque des partisans de l’ex président Obote, attaque facilement repoussée, Idi Amin Dada décide de faire interdire les coiffures afro, les cheveux longs, les minijupes, les perruques, les barbes et les produits éclaircissant la peau. Du coup, Maria est arrêtée, car elle porte une pseudo minijupe. Mais la fliquette qui l’a arrêtée se laisse acheter, elle veut qu’on lui offre une vraie minijupe en cuir de Carnaby Street, lieu qui incarnait à l’époque, en 1972, tout ce qu’il y avait de plus désirable en matière de vêtements. Le narrateur, lui, part rejoindre la guérilla en Tanzanie.
Journaliste
Journaliste africaniste, touchant de maigres piges assurant sa survie, ça n’était pas un vrai métier, écrit-il, juste une vocation issue de l’irrépressible amour qu’il ressentait pour ce continent insensé. «Le monde était beau et tout neuf et la guerre n’était qu’un vague prétexte pour le serrer contre ma poitrine.» Dans la nouvelle «Nyabiingi», il situe l’action en 1991 et au Rwanda où a lieu une petite guerre négligée. Perdu dans les nuages et les Grands Lacs, il y a d’énormes cactus vert sombre, des fleurs qui poussent en étant déjà sèches sur leur tige, des arbres monstrueux aux noms inconnus, une flasque de cognac, des cigarillos, une hutte, une femme nue aux petits seins pointus, à la taille moyenne, mince et nantie d’un pubis modeste d’une toute jeune fille, qui du bas ventre avale son sexe turgescent, un tremblement de terre les accompagne. Il coïte avec le divin! il éjacule et s’évanouit, c’était une apparition, la déesse Nyabiingi.
Trois ans plus tard, le 6 avril 1994, deux missiles abattent l’avion du président Habyarimana et les radicaux hutu massacrent 800'000 Tutsi et Hutu modérés. Et lui, devant cette horreur insondable, pleure de toute l’impuissance qui l’habite.
Interprète
«Virginité» est sise à Nairobi, au Kenya, en 1977, où le narrateur est interprète pour une équipe de la RAI qui tourne un documentaire sur les autruches. Il y rencontre Sarah, femme à la poitrine plantureuse, à la bouche charnue, à la peau ébène et mate, qui irradie la santé et dont l’apparence est modeste, et sa prononciation de l’anglais excellente, et qui lui donne l’occasion de nous apprendre qu’il aime à pratiquer le cunnilingus, qu’il considère son pénis comme étant l’archet d’un violon qui permet de voler au-dessus des nuages et qu’il est un adorateur de ce «vagin africain» auquel il attribue «la maturité d’une figue, la splendeur d’un fruit de la passion et la douceur de la pulpe de la papaye».
Fermier et chauffeur de camion
Dans «Ananas», à Bahar el-Fil, au Soudan, en 1983, il joue au fermier. Mais là, il se retrouve avec des milliers de fruits détruits, des milliers de dollars perdus, 40 poulets volés, son airedale décapité. Il a envie de pleurer. Cela fait quatre ans qu’il est là. Il fait moitié-moitié avec le propriétaire. Les deux premières années, il n’a rien gagné. Il cultive des mangues et des ananas, écrit des articles pour des périodiques américains genre National Geographic Magazine, boit du gin Melotti. La troisième année, il remet plusieurs milliers de dollars au proprio qui lui dit: «Tu es le diable. Tous les Blancs sont des diables. Cinq mille dollars! Et avec une terre pareille!»
Là, Osman, son aide, qui a la démarche souple, féline et silencieuse des Dinka, lui annonce qu’il doit le tuer mais qu’il ne veut pas le faire. Par contre, il doit partir et vite. On raconte partout qu’il est un ami des Arabes, ce qui équivaut à un baiser de la mort. Ainsi, après quatre ans d’épreuves, de lutte et de danger partagés, ils finissent sa dernière bouteille de bordeaux ensemble avant qu’il ne fuie en Ethiopie.
Dans «Les moutons de l’aube», en Somalie, en 1989, on voit passer une Kalachnikov avec deux chargeurs collés ensemble à coup de gros ruban adhésif, un avion qui vole trop haut pour être un bombardier, et Abdi qui a vécu longtemps à Aubervilliers et qui chauffe du café sur un feu d’épines craquantes pendant que notre conteur, qui a très bien dormi, ouvre lentement les yeux et découvre encore et à nouveau une beauté sauvage qui va droit au cœur, un ciel sans nuage, des épineux frangés de verdure. Eh oui, ainsi qu’il l’écrit: «Ils ont tout le temps du monde mais tout de suite ils n’ont pas beaucoup de temps. Dans l’immensité temporelle indifférenciée où ils vivent, il y a de subites accélérations suivies d’immenses plages d’indifférence.»
Un dernier mot sur l'auteur
Gérard Prunier, chercheur au CNRS, a écrit une vingtaine de livres, décrivant des ethnies de l'Afrique de l'Est, la crise rwandaise, la famine au Darfour, l’Ethiopie contemporaine ou une description fouillée de ce pays qui existe mais qu’aucun Etat ne reconnaît, le Somaliland. Il a effectué des missions en Egypte, au Soudan, en Ouganda, au Kenya, en Ethiopie, à Djibouti, en Somalie, au Rwanda, au Burundi et au Congo-Kinshasa. En 1994, il conseille les militaires français dans le cadre de l'opération Turquoise qui se déploie au Rwanda et assiste Jean-Christophe Rufin qui a pour mission de tenter d’éviter des affrontements entre les troupes du Front patriotique rwandais (FPR) et les militaires français. Il est détaché du CNRS comme directeur du Centre français des études éthiopiennes à Addis-Abeba de 2001 à 2006.
Bref
Dans ce revivifiant petit livre, on tranche la gorge à un ancien Premier ministre, on châtre le maire de la capitale, on massacre à tour de bras. Tout ce qu’il raconte est tellement horrible! Et après, paradoxalement, cette vie fait tellement envie. Cet humour noir, ce burlesque si abrasif. Cette fresque qui fuse de noms de chefs d’Etat, d’un feu d’artifice de dictateurs, Idi Amin Dada, Milton Obote, Yoweri Museveni, Juvénal Habyarimana, d’une foultitude de mouvements politiques, genre NRM, UFM, FPR, KANU, ou IPK, étrange poésie lettriste, d’une infinité de routes, de villes, de Zanzibar à Djibouti, d’engagements, d’affiliations partisanes, de langues, tel l’amharique, le somali, le luganda et le swahili, de dialectes, de tribus, d’ethnies, d’Acholi, Langi, Alur, Lugbara, de Luo et autres Kikuyu, de fruits, de fleurs, d’arbres, d’animaux.
Oui, cet ouvrage rend grâce et justice à la vie mouvementée et aventureuse dans laquelle, sans jamais être dupe, Gérard Prunier a aimé, adoré tout, terre et gens, où, en toute modestie, il fait l’amour à l’Afrique, à un fleuve de vie qui charrie des cris, des cadavres mais aussi de l’amour, tellement d’amour, et de la vie donc, de l’énergie et du mouvement, la vitalité elle-même telle qu’elle fut incarnée en ces décennies insensées.





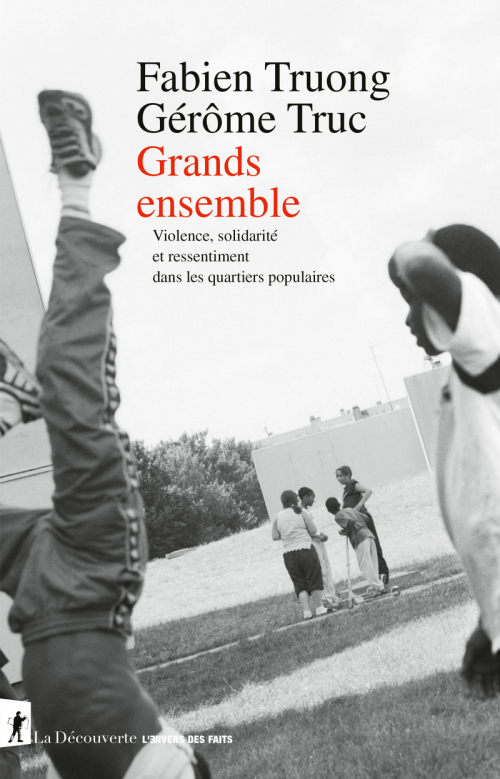

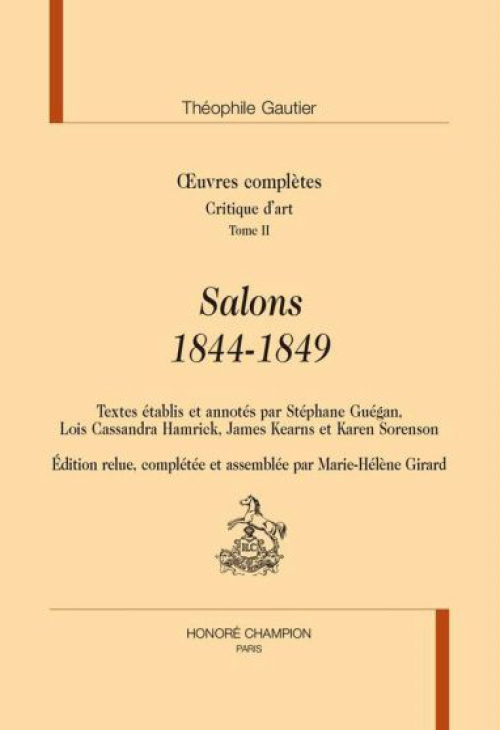
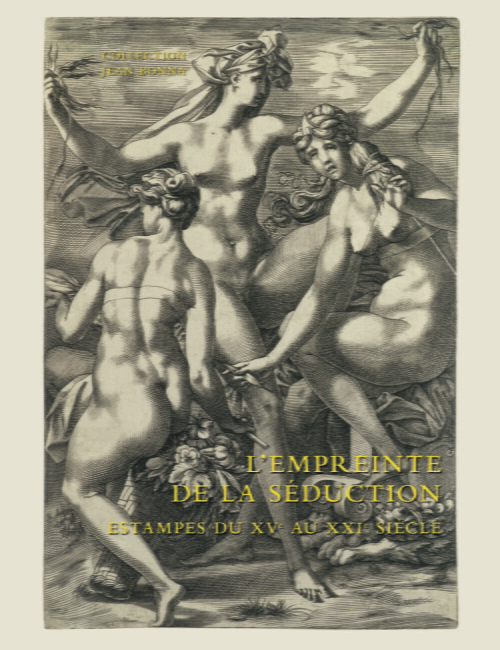
VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire