Culture / Comment j'ai aidé ma mère
Dans son roman Ainsi parlait ma mère, dont l’intrigue est située en Belgique, Rachid Benzine, franco-marocain natif des Yvelines, plus connu jusqu’ici comme anthropologue de l’islam, se plonge dans l’intimité secrète d’une mère et d’un fils. A lire, en ces temps mauvais de coronavirus, où l’humanité retrouve le sens du dévouement.
On pense – ou pas – aux trémolos d’Aznavour («J’habite seul avec maman…»). Il y a un peu de cet état des lieux dans le roman de Rachid Benzine, Ainsi parlait ma mère. Un fils de 54 ans, quatre frères aînés depuis longtemps partis du nid, faisant le choix de vivre avec sa vieille mère dans le deux pièces familial, à Schaerbeek, en périphérie de Bruxelles. Un quartier d’immigrés marocains, comme les protagonistes de cette histoire – on pense au Chat de Granier-Deferre, aussi, pour le pittoresque du duo figé dans son jus, bien que tout ici soit amour, mais un amour plein d’embarras.
Emmaillotés de tiers-monde, encombrés de paramètres dominants-dominés, les critiques occidentaux ont tendance à culpabiliser face à un livre tel que celui-ci. Si bien qu’ils se réfrènent, se privent d’y voir tout ce qu’il montre, prennent des gants, de crainte de «blesser», de «manquer de respect» en dévoilant ce que le narrateur, pourtant, expose dans sa nudité. Beaucoup n’ont pas encore admis que la fiction en usage dans la deuxième génération de l’immigration maghrébine, a moins vocation à libérer cinéastes et écrivains d’une improbable aliénation occidentale, qu’à les affranchir de la tutelle des origines. Non qu’il n’y ait pas de racisme – il est partout et nulle part –, mais le racisme est moralement plus facile à combattre que le poids des appartenances et leurs vicieux dilemmes. Non qu’il faille accabler les siens pour plaire aux «Français» ou aux «Belges» ou aux «Suisses», mais il convient de ne rien taire lorsque l’on fait l’inventaire des sentiments.
Franco-marocain originaire de Trappes dans les Yvelines – son «Schaerbeek» –, Rachid Benzine s’est fait connaître comme anthropologue de l’islam. Puis il a écrit une pièce de théâtre, ensuite encore un roman épistolaire sur fond de djihad. Avec Ainsi parlait ma mère, il poursuit sa route fictionnelle, ignorant les rappels à l’ordre du «parti unique de la banlieue», un carré d’incorruptibles, pour qui tout descendant de l’immigration maghrébine est une sorte de moudjahid devant à tout prix éviter de jouer contre son camp.
Benzine accouche donc ici d’un récit où il est question d’un petit dernier quinquagénaire prenant soin de la femme qui l’a mis au monde dans cette Belgique bien éloignée du Sud marocain initial. Il est professeur de lettres à l’Université catholique de Louvain. L’unique lettreux du petit clan avec sa mère pourtant illettrée, qui s’évade dans la lecture cent fois recommencée, par la bouche du fils, de La peau de chagrin de Balzac – le tempo du livre. Cette peau-là est celle du temps et de l’espace qui se réduisent, de la vie qui diminue alors que les plus belles choses semblaient à portée de main, enfin si peu dans le cas présent, mais elle est aussi cette peau d’amour parfumée d’ambiguïtés, qui réunit une mère et son fils.
Celui-ci avait sept ans à la mort de son père, un de ces hommes-machines, immigré tout tendu vers une seule fonction, ramener la paie, s’accordant un minimum d’évasion, qu’on pourrait dire féminine, dans le feuilletage de Modes et Travaux. Lui savait lire. Il travaillait au pilon de Bruxelles, rapportait au foyer papiers et revues destinés à caler meubles et appareils, au divertissement par ailleurs.
L’une des phrases-clés du livre: «Mes parents et moi nous avons vécu ensemble mais jamais en même temps.» L’on comprend alors que, pris de regrets, ce grand enfant pour ainsi dire unique, le narrateur, veuille réparer ce défaut de synchronisation en se donnant à sa mère bientôt alitée chez elle. Chose impensable se dit-on, il lui fait sa toilette intime, la chouchoute, l’emplit de sa présence filiale. Il découvre qu’elle a peut-être eu des émois pour un autre que son père, qu’elle a été autonome et non pur agent de sa condition de mère dévouée. Bref, il tombe des nues, lui le fils maghrébin qui se refuse d’envisager la moindre sexualité, pire, le moindre désir charnel, chez sa sainte maman. Tout cela est dit et amené par le narrateur avec tact, mais sans trop de délicatesse non plus, sinon ce serait enfouir à nouveau sous la «pudeur» – l’arme sociale des dictateurs et des bigots – l’humanité du vivant.
Le fils a, dans son adolescence, comme tant d’autres de la deuxième génération, eu honte de ses parents, de leur accent prononcé, de celui de sa mère, qui, ne sachant lire et parlant à peine le français, apprenait par cœur des bribes de phrases dans cette langue pour se faire comprendre des administrations. Cela tombait souvent à côté du but recherché, créant un effet comique. Le lecteur, en particulier l’Européen, s’imagine ici toutes les détresses passagères, les petites et grandes humiliations ressenties par ces parents, à la merci d’un monde en tout point étranger, mais qui n’était globalement pas mauvais. Le fils le dit à un moment: il a honte d’avoir eu honte de ses géniteurs. Mais de cette pelote de remords, il ne fait pas une boule de haine dirigée contre le pays d’accueil.
C’est là le message politique de Rachid Benzine, message suggéré en pointillés, adressé à ce parti unique de la banlieue, à ce carré d’incorruptibles, où la figure des parents «humiliés», dont certains prédicateurs faisaient grand cas auprès de leurs jeunes auditoires, sert à l’occasion de carburant à l’action militante. Rien de cela ici.
Evidemment, la lecture d’Ainsi parlait ma mère prend une dimension encore plus forte à l’heure du coronavirus, qui touche tous les milieux, les incorruptibles comme les modérés, les riches comme les pauvres. Les parents, les pères, les mères, n’ont jamais été aussi proches de leurs enfants, physiquement ou en pensées.







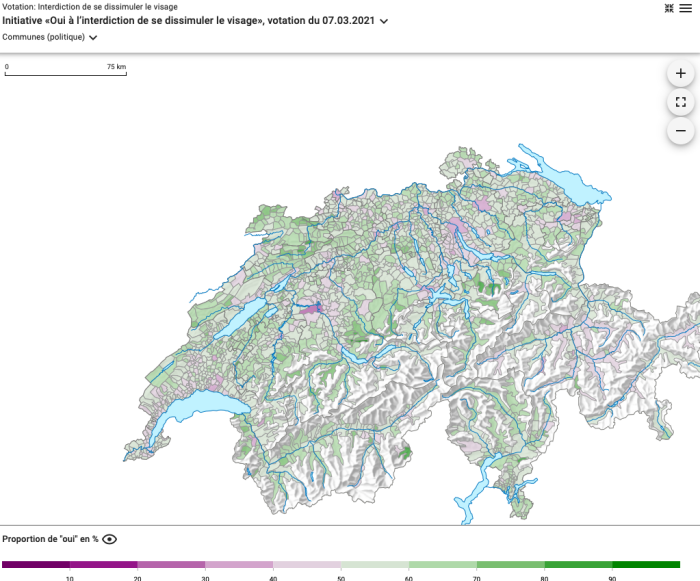

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire