Culture / Marco Ferreri disséqué
C’est le premier livre en français sur le cinéaste italien. «Marco Ferreri. Le cinéma ne sert à rien», de Gabriela Trujillo, est un réexamen critique de ses films. Que peut-on, que devons-nous en conserver? Qu’est ce qui mérite d’être revu et pourquoi? Quarante ans de carrière, trente-cinq films, de nombreux prix et, avec «La Grande bouffe», un scandale absolu qui fait écran au reste de l’œuvre.
Aux débuts des années 50, ayant abandonné des études de vétérinaire, Ferreri part en Espagne où il entre dans la réalisation cinématographique par le film publicitaire. Puis en réalisant trois films qui d’emblée naviguent dans un univers ironique, grotesque, paradoxal, teinté d'humour noir et dont le contenu provocateur lui vaut les foudres de la censure. Rentré en Italie dans les années 60, il tournera des comédies, principalement autour de sujets scabreux et de la vie conjugale: un homme est sexuellement épuisé par son épouse, un entrepreneur de spectacle exploite une femme à la pilosité abondante, un professeur dans un collège de jeunes filles installe des WC dans sa classe…
Une obsession pour les rapports homme/femme
Marco Ferreri s’auto-désignera alors comme étant le cinéaste du mauvais goût par excellence. Passant du parti communiste italien au gauchisme, puis à une critique de la société de consommation, il finira par se cantonner dans une obsession exclusive: les rapports homme/femme. Dans les années 1970, son goût pour les sujets sulfureux s'intensifie. Ses films analysent les névroses qu'engendrent la productivité industrielle et l’accumulation capitaliste. Ils se terminent généralement par la fuite, l'automutilation ou la mort volontaire de leur personnage principal. En 1969, Dillinger est mort que Michel Piccoli habite de toute sa grâce, marque un tournant dans son œuvre: un cadre rentre chez lui, se prépare un bon repas, éteint et allume la radio et la télévision, découvre un vieux revolver, tue sa femme endormie et s'en va. «Merveilleux de simple évidence», dira Godard. En 1973, La Grande Bouffe, l’un des plus beaux films d’amitié entre hommes, œuvre obscène et scatologique, vision apocalyptique truffée de scènes de mastications, de vomis, de pets, de défécation, de masturbation et de fellation, compétition boulimique à la fois sexuelle et alimentaire, lui accordera son moment de gloire, sa principale et seule réussite commerciale.
L’année suivante, ce sera Touche pas à la femme blanche auquel Gabriella Trujillo consacre un chapitre entier, démonstration laborieuse traçant un parallèle peu convainquant avec les autonomes italiens, un mouvement politique d’ultragauche qui, en 1977 à Rome, mélangera revendications politiques et sexuelles. Tourné en quelques jours en 1974 dans le chantier de démolition des Halles à Paris, ce sera le plus retentissant de ses échecs commerciaux. Ensuite, les films qu’il réalise à partir du milieu des années 1980, tel l’insipide I Love You (1986) avec Christophe Lambert, et le totalement raté Y a bon les blancs (1988), dans lequel les personnages masculins harcèlent sans cesse les personnages féminins en n’hésitant pas à les traiter de salopes, baigneront dans la laideur et la vulgarité télévisuel des années Berlusconi.
Ses idées fixes et son esthétique
Faisant preuve de nonchalance à tous les niveaux − mise en scène, scénario, direction d’acteur − ses films poussent jusqu’à des conséquences absurdes une idée initiale dont la mécanique inéluctable dirige l’avancée du film: un couple cherche un appartement, une femme a besoin de se marier pour accomplir sa vocation de mère, un homme pose une unique question à laquelle personne ne peut répondre, alors que sa femme dort un homme traîne chez lui, une femme veut se constituer un harem masculin, le dernier couple de l’humanité réapprend à vivre, deux vieux dans une maison de retraite veulent s’aimer, un garçon est amoureux de son porte-clefs, une bande de potes mangent jusqu’à en mourir, un valide veut lui aussi sa petite carriole d’handicapé.
Gabriela Trujillo ouvre son livre sur une mise en relation des films de Ferreri avec l’œuvre d’autres artistes, liste qui nous aide à comprendre ce qui a manqué au cinéaste pour devenir l’égal de ces grands artistes. «Le cinéma de Marco Ferreri est polymorphe, inégal, charpenté, piquant et brut. S’y mêlent la démesure rabelaisienne, la rigueur matérialiste du néoréalisme italien, l’audace révolutionnaire de Glauber Rocha et l’anarchisme de Carmelo Bene; les nœuds sentimentaux des fictions d’Antonioni traités avec le mordant démoniaque de Goya; la flamboyance et le kitsch des Trente Glorieuses, suivies de la laideur abyssale des années Berlusconi; la rage de Pasolini et Fassbinder; la lucidité de Kafka ou de Pavese, le scepticisme de Moravia ou de Wittgenstein, la mécanique baroque de Sade et de Jarry; l’imagination bâtisseuse, libertaire d’un Fourier voué à l’échec, mais aussi l’émoi solaire, inconsolable, de Camus.»
Comparaisons écrasantes et magistrale faute de goût car ces comparaisons ne peuvent que souligner à quel point chez Ferreri tout s’affiche en superficie et n’a aucune profondeur! Il détestait les intellectuels et qui de plus intellectuel, par exemple, que Pasolini ou Fassbinder? Quant à la comparaison avec Kafka, Pavese, Goya ou Sade, elle est carrément grotesque tant elle est écrasante! Tous ces auteurs ont en commun d’avoir une esthétique forte, un style très travaillé, un univers personnel, et c’est cela qui manque tant à Ferreri, une forme, un lyrisme et une réflexion poussée, une pensée.
Au final, Marco Ferreri apparaît comme un plat moraliste et presque tous ses scénarios sont d’une linéarité temporel affligeante: un homme normal, appartenant aux classes moyennes, vit une crise existentielle qui le pousse à des excès mortifère et qui, de digressions pessimistes en excès suicidaires, finit par se noyer dans ce qu’il dénonce.





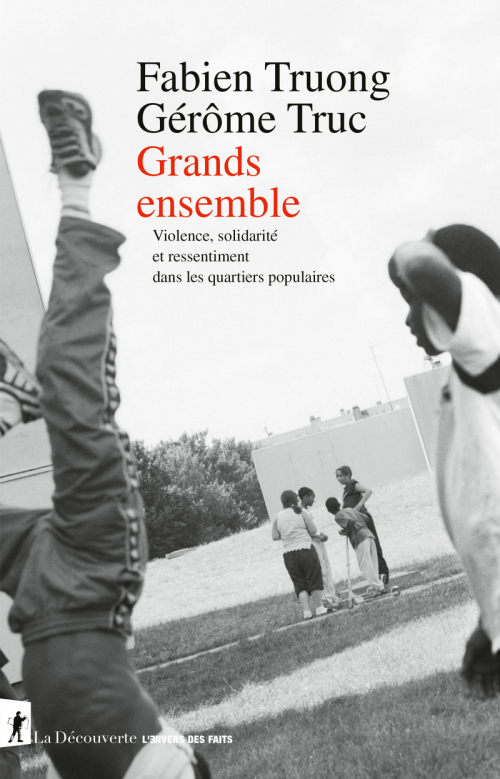

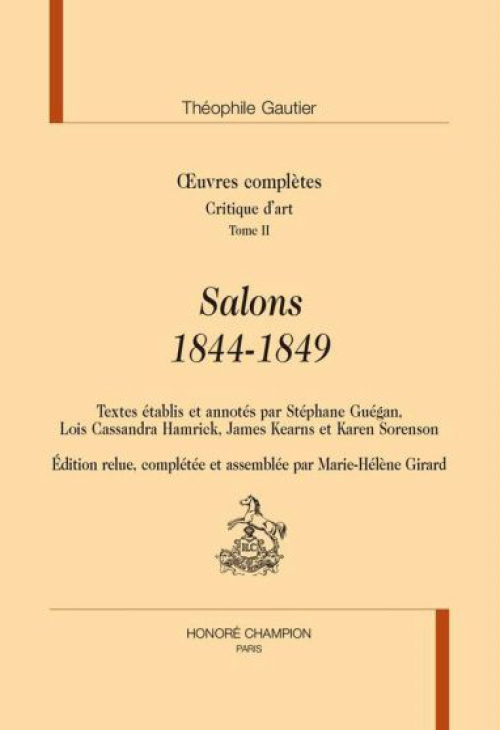
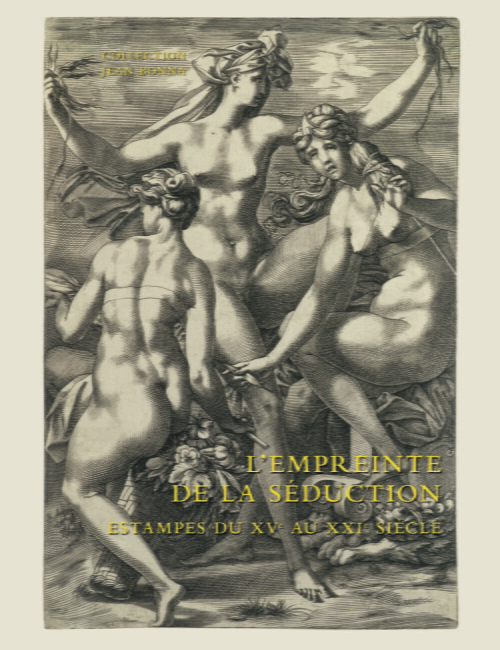
VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire