Analyse / Une société de privilèges n’est pas une société démocratique
Si nous bénéficions toutes et tous de privilèges, ceux-ci sont souvent masqués, voir niés. Dans son livre «Privilèges – Ce qu’il nous reste à abolir», la philosophe française Alice de Rochechouart démontre les mécanismes qui font que nos institutions ne sont pas neutres et que nos sociétés sont inégalitaires. Elle propose de réinventer le politique.
«A la loterie de la vie, j’ai eu de la chance. Je suis blanche, née dans une famille aisée à Paris, issue d’une classe sociale élevée. Je respecte le contrat hétérosexuel, et je suis (pour le moment) ni trop jeune, ni trop âgée. Je ne suis pas en situation de handicap. Je suis multiprivilégiée.» Alice de Rochechouart ne triche pas, elle sait d’où elle parle, elle le dit. C’est une philosophe. Elle adhère à l’idée de Gilles Deleuze selon laquelle la philosophie consiste à créer des concepts, des concepts qui servent «non seulement à comprendre mais aussi à agir: à construire et à détruire». Elle s’attaque aujourd’hui aux privilèges, pour mieux comprendre de quoi il s’agit et pour enfin nous en débarrasser – pour autant qu’on souhaite le faire; nombreux sont les privilégiés qui souhaitent le rester.
Les privilèges n’ont pas disparu
En France, le 4 août 1789, les députés réunis à l’Assemblée constituante annonçaient triomphalement l’abolition des privilèges. L’égalité était inscrite sur le fronton des mairies, tout allait bien aller dans le meilleur des mondes. Pour Alice de Rochechouart, croire à la disparition des privilèges relève de l’illusion. Certes, les statuts juridiques réservés aux nobles ou au clergé ne sont plus en vigueur mais, relève-t-elle, les avantages injustes se sont transformés en mécanismes invisibles, inscrits dans les institutions, les habitudes, les normes. Les privilèges d’aujourd’hui ne disent pas leur nom: ils se cachent dans la facilité avec laquelle certains accèdent aux ressources ou dans le peu d’empêchements qu’ils rencontrent à l’inverse d’autres qui les subissent constamment. «Les privilèges sont le fondement de notre société moderne. Autrement dit, il n’y a pas "des" privilèges, il n’y a que des privilèges.» Or, poursuit l’autrice, «si nous vivons dans une société de privilèges, nous ne vivons pas vraiment en démocratie».
Avantage ou privilège?
Pour bien saisir les propos d’Alice de Rochechouart, il faut comprendre ce qu’est un privilège, ne pas le confondre avec un avantage. Gagner un concours ou une distinction grâce à un travail acharné est un avantage. Bénéficier d’un réseau social ou d’une réputation héritée, sans effort particulier, relève du privilège. Cela n’a rien d’abstrait, les privilèges contemporains sont bien connus: être un homme plutôt qu’une femme, blanc plutôt que racisé, valide plutôt qu’handicapé. Ces privilèges, explique l’autrice, ne signifient pas que la vie est pour autant «facile» pour ceux qui les détiennent − être par exemple un homme blanc hétérosexuel sans handicap n’empêche pas de se retrouver au chômage. Mais les privilèges évitent à ceux qui en bénéficient d’affronter certains obstacles. Ne pas être interrogé sur sa légitimité, ne pas avoir à justifier sa présence dans un espace, ne pas être réduit à une différence: voilà des privilèges invisibles, mais puissants. «Les privilèges sont le système d’avantages injustes dont bénéficient certains groupes sociaux au détriment des autres, et qui révèlent les rapports de domination entre les individus.»
Repenser le politique
La modernité politique, loin d’éradiquer les mécanismes de privilège les a simplement déplacés. La démocratie représentative, censée garantir l’égalité, reproduit des hiérarchies. Les institutions se veulent neutres mais la manière dont elles fonctionnent profite souvent aux mêmes catégories de population. Les privilèges n’ont pas disparu, ils se sont adaptés. Combien y-a-t-il d’ouvriers dans les parlements, dans les gouvernements? Qui y prend les décisions importantes? A quelles classes sociales appartiennent ces gens, qu’elles études ont-ils suivies, de quoi ont-ils matériellement hérité? Sont-ils majoritaires dans la société ou particulièrement privilégiés?
Il y a trois manières de légitimiser les privilèges: en les naturalisant – les plus forts commandent aux plus faibles parce c’est «naturel»; en les invisibilisant – nous sommes toutes et tous égaux; avec la théorie du mérite – laquelle prétend que les privilèges ont été justement gagnés. «Un privilège n’est pas quelque chose que l’on possède: c’est une position de pouvoir par rapport à d’autres groupes sociaux.»
Alice de Rochechouart se livre à une critique radicale des institutions. Pour elle, il ne suffit pas de dénoncer les injustices, il faut s’attaquer aux cadres qui les rendent possibles: la forme de notre démocratie, nos règles de délibération, notre conception même de la légitimité politique. «Abolir les privilèges, ce n’est pas corriger à la marge, c’est repenser l’édifice tout entier.» Elle cite d’autres philosophes avec lesquels elle a des accords théoriques: Michel Foucault, Jacques Rancière, Frédéric Lordon. Des penseurs radicaux dans leur critique du monde.
Une question dérangeante
La question des privilèges n’est pas facile à aborder, car nous en avons toutes et tous, à divers degrés. Les reconnaître suppose un effort de lucidité, les abandonner exige un grand courage politique et personnel. Et la culpabilité est sans intérêt; à ce propos, Alice de Rochechouart cite l’écrivain américain James Baldwin: «Je ne m’intéresse pas à la culpabilité d’autrui. La culpabilité est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre. Je sais que vous n’avez pas commis ce méfait, et je ne l’ai pas commis non plus, mais j’en suis responsable parce que je suis un homme et un citoyen de ce pays, et vous êtes également responsable pour la même raison. Tous ceux qui s’efforcent d’être lucides doivent commencer par rejeter le vocabulaire que nous avons longtemps utilisé pour masquer la réalité, pour mentir sur la véritable nature des choses.»
Des propositions
Privilèges n’est pas un mode d’emploi, c’est de la philosophie. Alice de Rochechouart n’est pas une militante, elle cherche des pistes. Par exemple, avec Michel Foucault, une éthique à la foi individuel et sociale, une alliance et des liens entre l’individu et le collectif. Avec Frédéric Lordon, elle espère les passions qui peuvent déclencher de nouveaux projets de société, parce que «nous ne sommes pas des individus purement rationnels, mais des êtres de désir.» Avec Jacques Rancière, elle refuse la hiérarchie des intelligences: «Nous devons agir, écrire, parler en présupposant que nous nous adressons à des égaux. C’est la condition de l’émancipation et de la démocratie véritable.»
«Les concepts sont comme des briques. On peut les utiliser pour construire une maison ou pour fracasser des vitres», écrivaient les philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari dans Mille Plateaux. Alice de Rochechouart fait les deux: construire et fracasser. «Pour abolir les privilèges, il faut tout changer. (…) Pendant la révolution française, les privilèges ont été un concept tellement puissant et mobilisateur qu’ils ont contribué à mettre fin au féodalisme. Je suis convaincue qu’il peut en être de même aujourd’hui face au capitalisme. A nous de réinvestir ce concept, et de lui donner toute sa force séditieuse.»



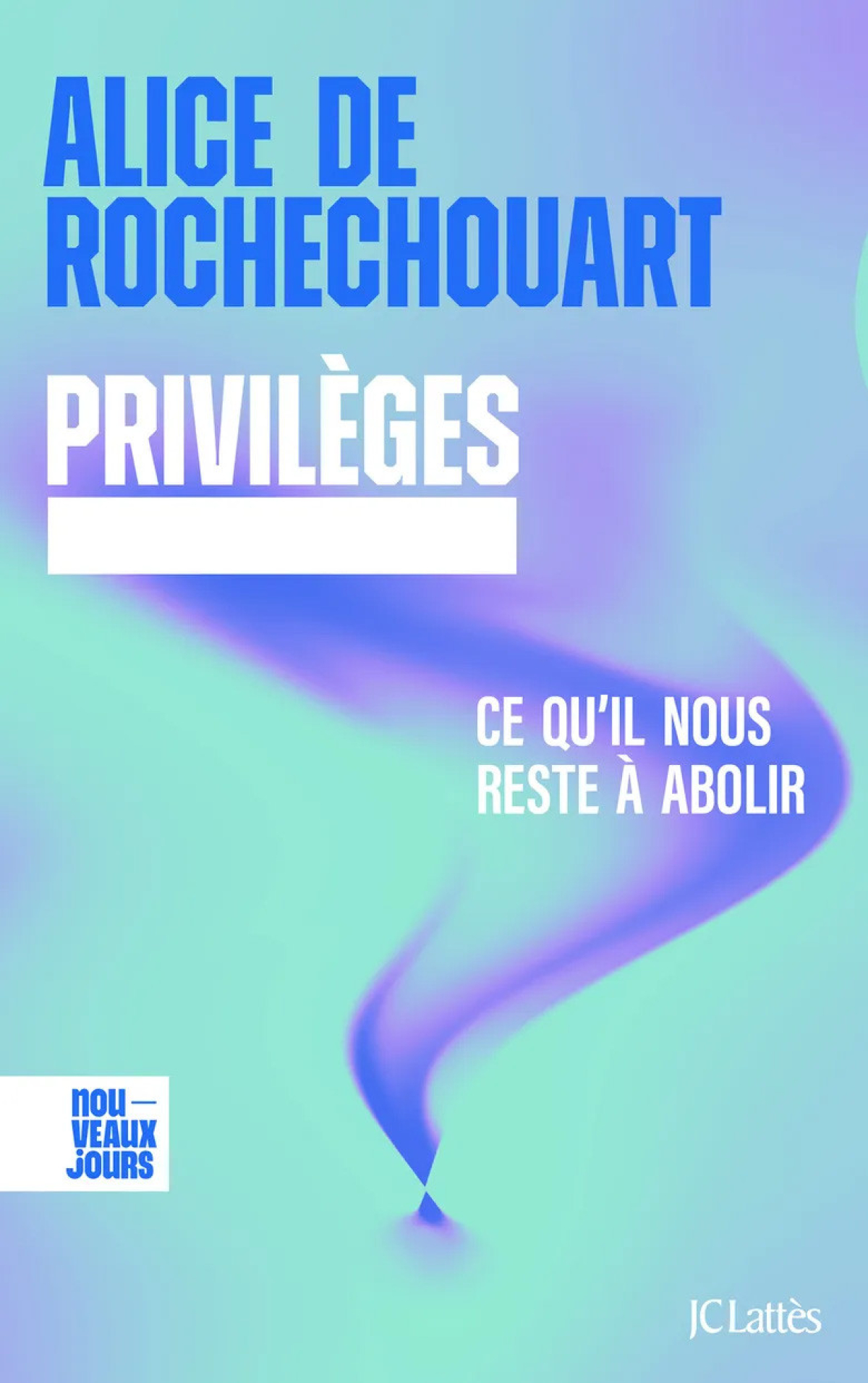


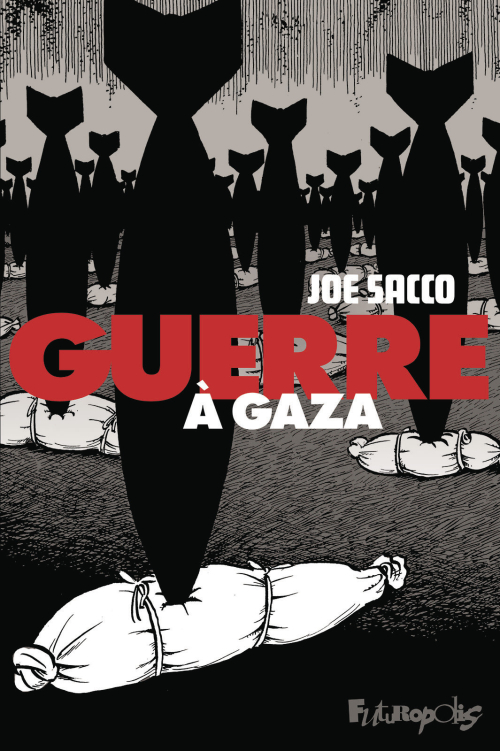
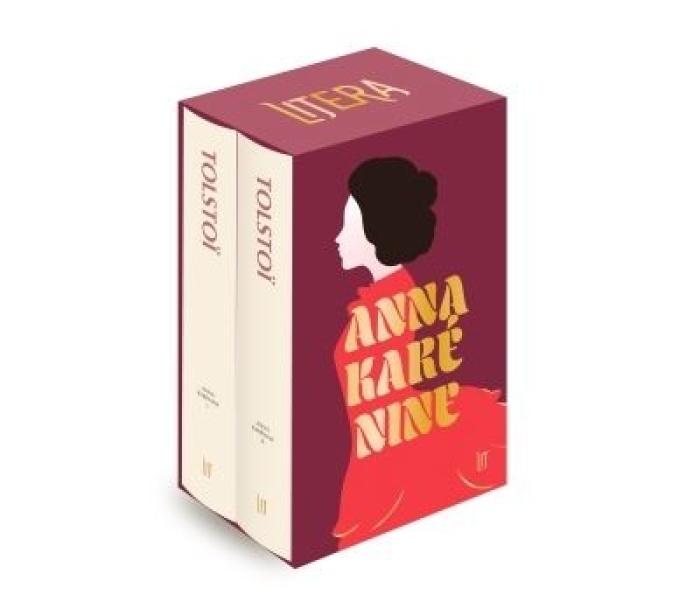

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
1 Commentaire
@Cleo 26.09.2025 | 17h27
«Excellent article qui soulève une problématique qui a toujours existé et malheureusement n'est pas prête d'être solutionnée.
On aimerait fortement y croire!
Mais comment imaginer que pouvoir et argent qui voyagent main dans la main et font le lit des privilèges puissent se transformer?»