Analyse / Plaidoyer pour l’humilité intellectuelle
Les constats dressés dans le dernier essai de Samuel Fitoussi, «Pourquoi les intellectuels se trompent», ont de quoi inquiéter. Selon l’essayiste, l’intelligentsia qui oriente le développement politique, artistique et social de nos sociétés est souvent dans l’erreur et incapable de se remettre en question. Des propos qui font l’effet d’une bouffée d’oxygène et portent un message profondément éclairant et revigorant.
La constatation initiale, à savoir que les intellectuels – l’intelligentsia, la classe supérieure, l’élite intellectuelle selon le contexte – se sont trompés (et continuent à le faire), et demeurent presque systématiquement dans l’erreur une fois leur opinion exprimée publiquement, peut surprendre. Mais, dans les faits, elle n’a rien d’étonnant tant les exemples sont nombreux et patents: l’intelligentsia française ou britannique qui, au début années trente du siècle passé, persiste à ne pas voir, et donc à nier, les dangers de la montée du nazisme; des personnalités comme Sartre, Beauvoir ou Arthur Koestler qui s’obstinent à considérer l’URSS de Staline comme le meilleur monde possible et à justifier ses crimes en vertu d’une idéologie qu’ils considèrent comme supérieure; le refus, là aussi «irréversible», de certains journalistes à admettre les horreurs commises par le régime de Mao; ou encore la focalisation exclusive, et sans doute coupable, sur les victimes du régime de l’apartheid, au détriment d’autres drames sur le continent africain (pour ne mentionner que les exemples les plus saillants).
Se raviser est plus coûteux que se tromper
Nourri par de très nombreux historiens, philosophes et penseurs tant français qu’anglo-saxons (en particulier Raymond Aron, George Orwell et Jean-François Revel) et jonglant avec une foule d’études sociologiques ou psychosociales, Samuel Fitoussi analyse par le menu les raisons d’un tel aveuglement de l’élite pensante (alors que spontanément on tend à penser que plus une personne est formée, moins elle se trompe). Outre plusieurs mécanismes psychologiques auxquels les êtres humains et en particulier l’élite succombent (le paradoxe de Tocqueville, les biais de prestige, de vérité illusoire, du monde juste, etc.), voici, en substance, l’explication: pour les intellectuels, passé un certain stade, se raviser est socialement beaucoup plus coûteux que se tromper. En revanche, ils ont beaucoup, voire tout à perdre en changeant d’avis. Ils préfèrent dès lors persister dans l’erreur.
Des idées absurdes qui pourtant font mouche
Si l’essai se limitait à ce constat, il s’agirait certes d’une contribution originale et bienvenue au débat d’idées. Mais heureusement l’analyse des faiblesses idéologiques se décline en une série de réflexions connexes, par exemple: la tendance des intellectuels à attribuer les problèmes aux structures sociales (et jamais au désintérêt ou à l’échec personnel) et le désir de les résoudre «par le haut» (selon le schéma: l’intellectuel dénonce, propose des solutions et «se» propose pour les mettre en œuvre), la facilité effrayante avec laquelle une idée absurde ou dangereuse peut faire mouche si elle est défendue par certaines personnes «prestigieuses»; le conformisme social et l’absence de diversité intellectuelle, aujourd’hui plus répandus que jamais, avec pour corollaire le manque de débats sur la validité de telle ou telle solution, ou encore l’influençabilité de l’électorat (et même la malléabilité de sa morale).
Une analyse courageuse de l’université contemporaine
Une autre qualité de l’essai réside dans son habileté à ouvrir des parenthèses (l’argument clé étant souvent donné entre parenthèses) et à s’engager dans des excursus, dans un va-et-vient fécond entre le centre de la réflexion et son illustration. Comme au chapitre 5 par exemple, intitulé L’université, temple de l’irrationnel?, placé, sans doute pas par hasard, au centre du livre. Ce que d’aucuns pourraient lire comme une polémique facile sur l’université contemporaine s’avère une analyse courageuse et nécessaire de ses dérives. Fitoussi la présente en effet comme un haut-lieu de l’uniformité intellectuelle, mais aussi de la rationalisation d’idées erronées et de la course aux diplômes, où il faut avoir certaines idées, souvent de gauche (largement surreprésentée dans ce milieu) pour «réussir». L’auteur l’analyse judicieusement, et avec l’appui de plusieurs expériences de pensée, comment les sciences sociales (notamment) produisent des diplômés surnuméraires, dont le travail ne peut se justifier qu’à l’aune des «maux» que ceux-ci dénoncent, dans une reproduction éternelle des mêmes schémas idéologiques.
Rendre compte de la richesse de cet essai en quelques lignes est une illusion. On y découvre un plaidoyer riche et sincère, soutenu par une ironie amère mais pleine de fraîcheur, pour l’esprit critique (un scepticisme de fond vis-à-vis des idées dont la «valeur» n’est due qu’au prestige de celles et ceux qui les soutiennent), l’absence d’interdits de pensée et l’humilité idéologique, seuls gages d’une vraie confrontation des idées et de progrès dans nos démocraties.

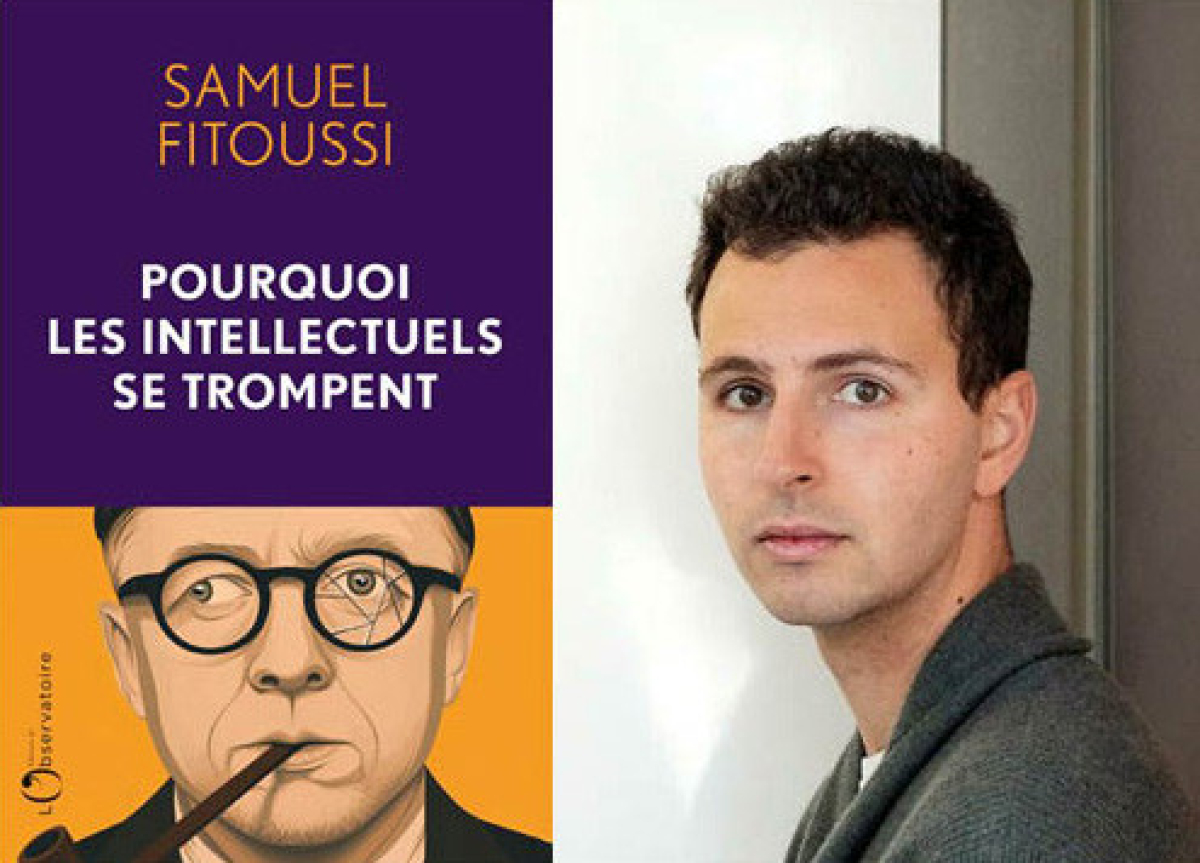
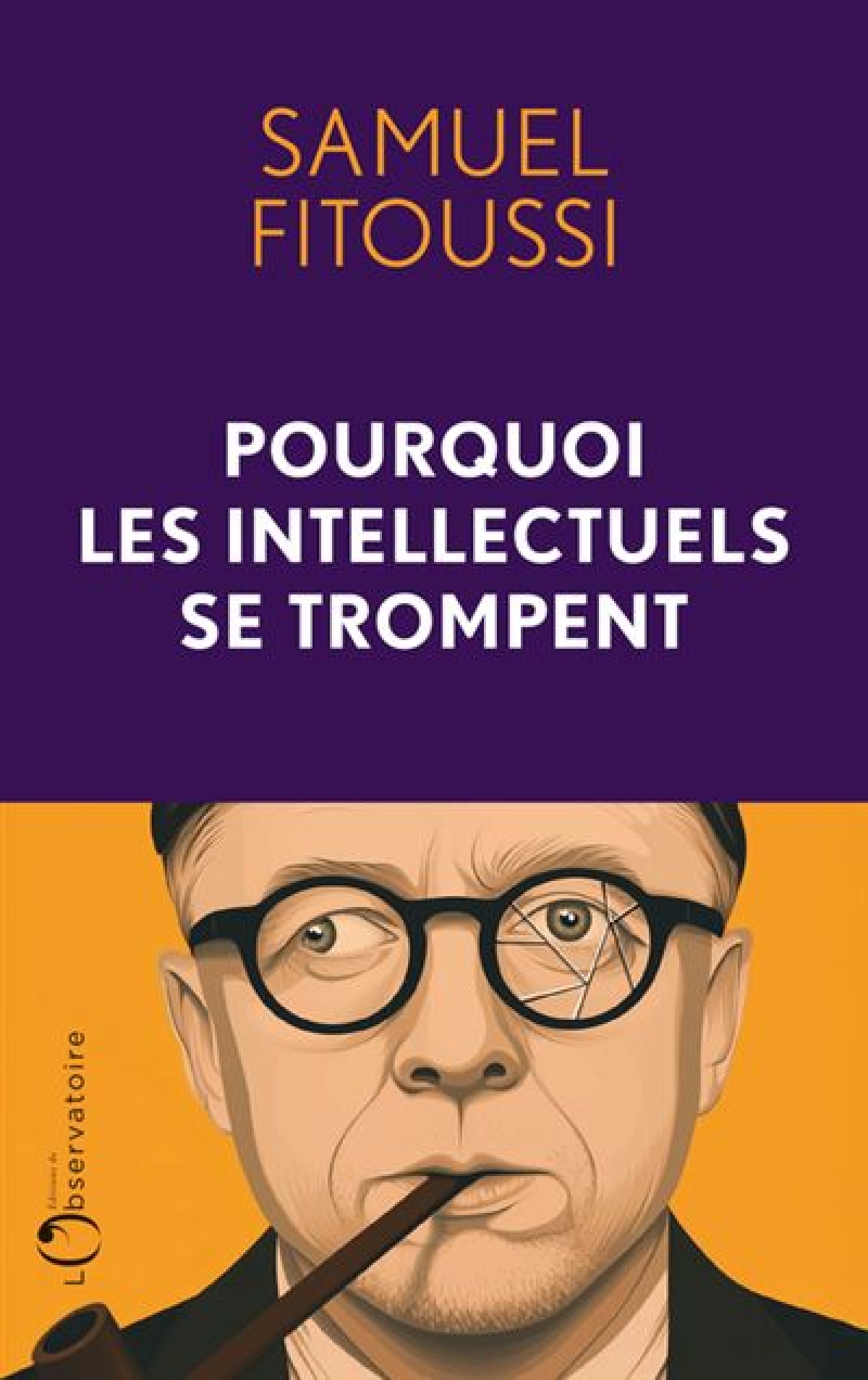

VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire