Lu ailleurs / L’immunité de groupe, une histoire d’inégalités
Laisser circuler le coronavirus pour atteindre l’immunité collective? Un pari qu’a notamment voulu tenter le Royaume-Uni, avant de se résoudre au confinement de la population. Dans un article du New York Times, l’historienne Kathryn Olivarius de l’université de Stanford apporte un éclairage sociologique et historique sur cette pratique.
Les spécialistes avancent que pour qu’un virus cesse de circuler dans une population, il faut qu’il ait rencontré au moins de 60% de celle-ci et qu’ainsi soit constituée une immunité collective, appelée aussi immunité grégaire ou immunité de groupe.
Pour accélérer la sortie de crise, ce pari peut être tentant. En particulier aux Etats-Unis, où la relance de l’économie est vitale pour les désormais 33 millions d’Américains inscrits au chômage, sans compter les travailleurs non éligibles aux aides gouvernementales et qui se retrouvent sans ressources. Le site internet conservateur The Federalist vantait à la mi-mars ces jeunes gens se faisant volontairement infecter pour retourner plus vite au travail. Cette semaine, l’Etat de Washington a mis en garde contre les «Covid-19 parties» organisées pour accélérer la contamination et donc l’immunité des participants. Cette pratique est qualifiée d’«extrêmement dangereuse» par les autorités, et d’incertaine, puisque le monde scientifique n’a pas encore de position ferme sur le développement des anticorps contre le SARS-CoV-2.
Mais la question de l’immunité est au cœur des préoccupations autour du déconfinement et du retour à la «vie d’avant». Puisque nous ne disposons pas encore d’un vaccin ni d’un traitement sûr et efficace, le développement d’anticorps par une large partie de la population apparait comme une solution désespérée.
On a ainsi évoqué le «passeport sanitaire» pour voyager, garantie que l’on n’était plus ni porteur ni potentiellement malade, mais aussi comme condition pour l’emploi. Un nombre suffisant de jeunes gens, dans la force de l’âge et en pleine santé, après avoir subi l’épreuve du feu, rien de tel pour remettre une économie sur les rails...
Corona-capitalisme
Pour qualifier l’expérience bien différente que font de la pandémie les télé-travailleurs et les autres, l’historienne Kathryn Olivarius parle, dans la rubrique Opinion du New York Times du 16 avril dernier, de «corona-capitalisme».
Nombre de médias et de chercheurs l'ont remarqué, le coronavirus est un révélateur des inégalités déjà existantes. Les classes sociales défavorisées sont touchées prioritairement par la maladie. En France, on constate une surmortalité en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de métropole. Aux Etats-Unis, où les soins médicaux coûtent de véritables fortunes si l’on n’est pas assuré, c’est la communauté afro-américaine qui paie le plus lourd tribut en particulier à New York. Au Royaume-Uni, les personnes issues de minorités ethniques constituent le tiers des patients admis en réanimation, alors qu’elles ne représentent que 14% de la population (selon les chiffres donnés par le Journal de Montréal).
Les raisons sont multiples. Les antécédents médicaux tels que l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, facteurs aggravants de la maladie à coronavirus, sont plus répandus dans les catégories populaires. A quoi s’ajoutent la défaillance du système hospitalier ou la surcharge de celui-ci dans les régions les plus pauvres, la promiscuité dans les logements, et surtout l’impossibilité de télétravailler: ce sont les employés de supermarchés, les livreurs, les agents de nettoyage ou de sécurité, les chauffeurs de bus, de taxi ou de VTC, bref, les «petites mains» invisibles qui font aujourd’hui tourner le monde et en paient le prix.
Il faut bien comprendre, souligne Kathryn Olivarius, que nous nous appuierions sur ces personnes pour atteindre l’immunité collective, et ainsi relancer l’économie. Or, cela reviendrait à ce qu’une frange favorisée de la population, celle qui a les moyens de s’isoler, profite de l’immunité acquise par une frange défavorisée de la population, celle qui travaille au contact des autres, au prix de sa santé et même de sa vie; ce qui est éthiquement discutable. Et cela s’est déjà produit par le passé.
La fièvre jaune et l’immunoprivilège
Kathryn Olivarius étudie l’histoire du Deep South américain et particulièrement les épidémies de fièvre jaune qui ont frappé la région au cours du XIXème siècle. En Louisiane, la notion d’immunoprivilège est venue renforcer des inégalités déjà existantes et prégnantes.
Le virus de la fièvre jaune est transmis par les animaux, le moustique comme vecteur et le singe comme hôte. Il a semé la terreur en Louisiane pendant tout le siècle, de manière quasi ininterrompue. En l’espace de soixante ans, la Nouvelle-Orléans a connu vingt-deux vagues épidémiques qui ont tué au moins 150’000 personnes au total sur la période (la population de la ville au milieu du XIXème siècle est estimée à 100’000 habitants). Le taux de létalité de la fièvre jaune est d’environ 50%, les victimes meurent dans des conditions particulièrement terribles: ictère (coloration de la peau en jaune due à un dysfonctionnement du foie, d’où le nom «fièvre jaune»), vomissements de sang coagulé, très forte fièvre... Cependant, il existait une certitude: lorsqu’un malade avait guéri, il était immunisé.

Death of Aurelio Caballero due to yellow fever in Veracruz, 1892 © MET
«Lorsqu’un virus ravageur rencontre les forces du capitalisme, la discrimination immunologique ne devient qu’une manifestation supplémentaire des inégalités, dans une région déjà marquée par les disparités raciales, ethniques, de genre et de niveau de vie.»
Avant la guerre de Sécession (1861), la société de la Nouvelle-Orléans était construite autour de l’esclavage, compartimentée. La pyramide sociale, en temps d’épidémie, pouvait être schématisée ainsi selon l’historienne: au sommet, les riches propriétaires terriens blancs et immunisés contre la fièvre jaune, ensuite, les populations blanches, favorisées mais nouvelles arrivées et non immunisées, enfin, le reste de la population, c’est-à-dire des citoyens blancs pauvres, et la population noire.
Pour les nouveaux arrivants blancs en Louisiane, la contamination à la fièvre jaune équivalait à un «baptême de la citoyenneté»; la preuve que la personne avait été élue par Dieu pour s’installer sur ce territoire et y prospérer en toute sécurité. La spécialiste cite le témoignage de Gustav Dresel, immigré allemand dans les années 1830, qui désespère de contracter le virus pour pouvoir s’intégrer: «Je cherche partout une place de comptable, mais engager un jeune homme qui n’a jamais été exposé (à la fièvre jaune) est un pari perdant.»
A la Nouvelle-Orléans, en temps d’épidémie, l’immunité influait sur la possibilité de contracter une assurance-vie, un crédit, d’obtenir un logement, de trouver un emploi et même de se marier. Les immigrés de fraiche date s’efforçaient donc d’être contaminés en dormant ensemble dans des dortoirs exigus et insalubres, voire dans le lit d’une personne qui venait de succomber à la maladie. Pour un homme pauvre, l’immunoprivilège était la garantie de pouvoir s’élever socialement par le travail, l’absence d’immunité condamnait à la pauvreté.
Autre conséquence, alors que les moustiques de la Louisiane ne pratiquaient aucune forme de racisme, l’instrumentalisation de l’épidémie par les esclavagistes. La ségrégation raciale était brandie par ces derniers comme une mesure sanitaire, et même «humanitaire», puisqu’elle obligeait à la distanciation physique entre esclaves et propriétaires, entre Noirs et Blancs, entre riches et pauvres.
La valeur marchande d’un esclave immunisé contre la fièvre jaune, alors que peu d’entre eux avaient accès aux soins médicaux, était augmentée de 50%. En décimant les esclaves, le virus permettait aux propriétaires de s’enrichir en spéculant sur cette marchandise humaine.
Les autorités municipales rechignaient à l’installation d’équipements sanitaires, au nettoyage des espaces urbains et aux mesures de quarantaine, arguant que la solution au virus était plus de virus. Plus de virus pour les classes populaires, contraintes de travailler malgré les risques, et pour les esclaves.
La conclusion à laquelle parvient Kathryn Olivarius est que, concernant le virus qui nous préoccupe actuellement comme pour n'importe quelle crise épidémique, le passeport sanitaire ou l’immunité comme condition à l’emploi ne feraient que doubler des inégalités sociales déjà très présentes et aux conséquences déjà dramatiques. Les plus faibles et les plus vulnérables seraient encore «punis» en étant forcés de s’exposer à une maladie qui, rappelons-le, peut être mortelle même pour des individus jeunes et en bonne santé.




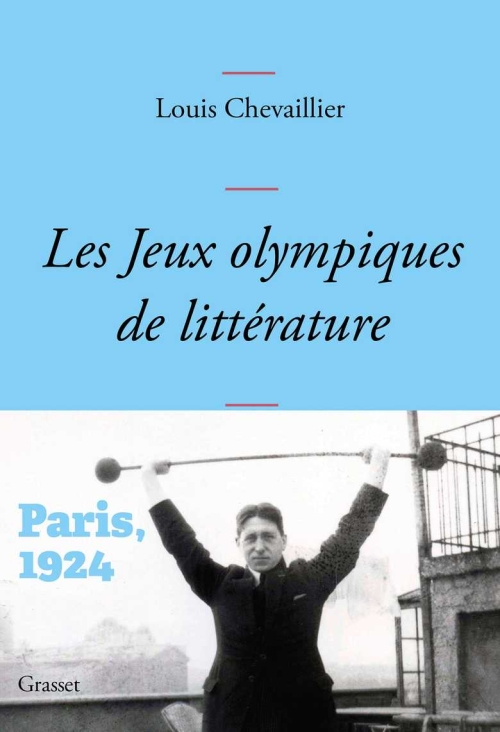



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
1 Commentaire
@bouboule 07.08.2020 | 07h55
«Mais comment expliquer les taux de mortalités dans les pays des Balkans, et la Grèce? qui sont loin d'être riches, surtout ce dernier pays...»