Actuel / Tu seras un homme, mon fils!
Essayiste et professeure de philosophie, Olivia Gazalé soutient l’idée que la domination masculine découle d’une construction sociale de la virilité qui comporte aussi des injonctions très contraignantes pour les hommes. Ces injonctions font peser une énorme pression sur leurs épaules et créent une catégorie de sous-hommes rassemblant notamment les homosexuels, les efféminés et tous les hommes appartenant à des cultures jugées inférieures. Le fascisme est la forme la plus extrême de ce système de valeurs. Dans son ouvrage paru en 2017 chez Robert Laffont sous le titre «Le mythe de la virilité, Un piège pour les deux sexes», Olivia Gazalé remonte jusqu’à l’aube de l’humanité pour questionner les rapports de domination ou de vénération entre les deux sexes à travers une approche pluridisciplinaire qui, seule, permet de bien traiter un sujet.
Pouvez-vous résumer en quelques lignes le postulat de base de votre livre Le mythe de la virilité?
Je me suis aperçue que, dans la littérature féministe classique, la problématique du sexisme n’était jamais abordée sous l’angle de la condition masculine. Or, les hommes sont aussi prisonniers d’archétypes qui rejettent hors de la virilité tous ceux qui n’y correspondent pas.
Le sexisme dessert les deux sexes. C’est une construction historique, un mythe inventé pour justifier l’infériorité de la femme et des «sous-hommes», pour la présenter comme naturelle. Il faut déconstruire l’idée que la domination est naturelle. Le mythe de la virilité pose l’homme comme un être supérieur à tout (à la femme, à l’animal, à l’environnement) et légitime la prédation. L’idée que le monde lui appartient et qu’il a tous les droits dans une optique de pure domination lui revient aujourd’hui en boomerang.
En quoi la condition masculine est-elle un asservissement?
Pour paraphraser Simone de Beauvoir, on ne naît pas viril, on le devient. Les garçons sont dressés, amputés d’une partie de leur sensibilité. Les injonctions à la virilité sont coercitives, discriminatoires et paradoxales. Coercitives, parce que l’homme est tenu de se montrer puissant, maître de soi, conquérant, héroïque, victorieux. Discriminatoires, parce que les hommes qui ne correspondent pas à ces stéréotypes sont exclus, humiliés, asservis. Paradoxales, parce qu’on attend d’un vrai homme à la fois la puissance sexuelle et la maîtrise de soi. L’ostentation phallique et la capacité de sublimer ses instincts.
Qu’est-ce que les hommes ont à gagner d’une société plus égalitaire?
Tous les hommes qui souffrent des injonctions virilistes gagneraient à s’en libérer. Les homosexuels et tous ceux qui sont pas en position dominante. Et même le mâle dominant quand il est père d’une fille ou d’un fils non dominant. L’injonction à être l’unique pourvoyeur de ressources et à faire carrière peut être très pesante. Il y a beaucoup de cas de burnout et de suicide parmi les hommes. C’est mal perçu pour un père de demander congé pour les enfants. Une femme qui perd son emploi ne subit pas l’opprobre de la société.
Pourquoi êtes-vous remontée jusqu’à la préhistoire?
La découverte que les prérogatives étaient mieux réparties dans la préhistoire m’a incitée à m’intéresser au basculement. Pendant des millénaires, on n’avait pas compris le rôle fécondant du mâle. La reproduction était perçue comme un pouvoir surnaturel attribuable à la femme seule. On était dans des sociétés matrilinéaires.
À partir d’Aristote, on a pensé que le sperme contenait des homoncules déjà préformés qui ne faisaient que croître dans l’utérus. Ce renversement a fait perdre tout son prestige à la femme. La société est devenue patrilinéaire. À partir du moment où l’homme transmet son nom, il est hanté par la crainte de le transmettre à quelqu’un qui n’est pas de son sang. Il faut donc s’assurer à tout prix la fidélité de la femme.
Quelles ont été, selon vous, les principales avancées du féminisme?
D’abord la transformation de l’arrière-plan théologique, politique liée à l’abolition de la monarchie, l’instauration d’un règne plus égalitaire. Puis la libération sexuelle qui a aussi profité aux hommes. Depuis les années 70, la femme se revendique comme sujet désirant. Ensuite l’accession aux carrières et aux pratiques sportives réservées aux hommes. Mais on est encore loin d’une égalité totale, par exemple sur le plan salarial. Les femmes ont de la peine à se projeter dans certains métiers. On s’applique les préjugés à soi-même. Et le coût énergétique requis pour s’imposer dans les métiers masculins incite à la retenue. Dans le cadre de la famille, on est passé d’un père omnipotent à des parents égaux.
Le mouvement #metoo m’apparaît comme un tournant anthropologique majeur qui a révélé l’ampleur du discrédit jeté sur la parole féminine, de la culpabilisation de la victime, de l’impunité des coupables, de la culture du silence.
Y a-t-il des domaines où la cause des femmes a reculé ?
En Italie par exemple, il y a des propagandes pro natalistes qui encouragent la femme à rester à la maison. La droite nationaliste américaine a aboli le droit à l’avortement dans certains États, y compris en cas d’inceste et de viol. En France aussi, la droite réactionnaire constitue une menace pour le droit des femmes. On régresse aussi sur l’homophobie (insultes, manif contre le mariage gay, etc.).
Y a-t-il selon vous des domaines où la femme est socialement privilégiée par rapport à l’homme (choix d’enfanter ou non, droit du divorce, dispense du service militaire)?
Totalement, il y a des bénéfices secondaires au sexisme (je ne porte pas ma valise, on m’invite au resto). Mais ça concerne surtout les femmes privilégiées. Dans le domaine de la procréation, les femmes ont inversé le rapport de force. Elles peuvent décider unilatéralement de mener ou non une grossesse à terme.
Il y a un féminisme qui consiste à minimiser la différence entre les genres et un autre qui consiste à l’appuyer. Vous penchez de quel côté?
C’est la question de l’universalisme et du différencialisme. Je penche plutôt pour le premier, mais ce qui m’intéresse davantage, c’est la question de la hiérarchie, la manière dont la société a transformé les différences naturelles en inégalités sociales.
Ce qui fait l’humanité c’est la diversité des comportements indépendamment du genre. Il faudrait réussir à dépasser la question du genre. La vraie libération c’est que le genre ne soit plus le premier déterminant. L’existence de centaines de milliers de transgenres nous invite d’ailleurs à questionner le genre à partir de ses marges, à en remettre en question la binarité.
Pensez-vous que la féminisation des noms serve la cause des femmes?
Sujet délicat. D’un certain point de vue, j’ai envie de dire oui, parce qu’il n’y a aucune raison que le masculin l’emporte et que les noms féminins existaient autrefois, mais certaines femmes estiment que ça dévalue la fonction. Il faut plutôt travailler sur les représentations. Si on fait confiance à la femme, le mot «doctoresse», ça ne sera plus le cas. Je suis plus réservée avec l’écriture inclusive. Les formules épicènes c’est bien, mais en intercalant par ex. des points dans les mots, on dessert la langue.
En termes d’égalité, y a-t-il des différences marquantes entre le Paris et la Suisse romande d’aujourd’hui?
Je l’ignore. Mais dans les pays protestants, les femmes ont obtenu plus précocement le droit à l’instruction, parce qu’on lisait la bible à la maison. Chez les protestants, la femme est pasteure, dans le catholicisme, elle est servante.
Pourquoi avoir dédicacé ce livre à votre père?
Parce qu’il a beaucoup souffert des injonctions à la virilité; il en a payé le prix fort. Il est mort avant la parution de mon premier livre, alors qu’il m’avait toujours dit: «Tu seras un écrivain, ma fille.»




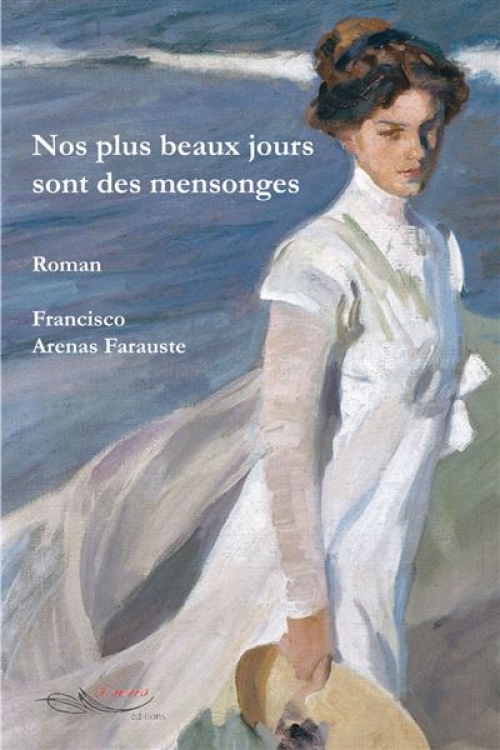



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire