Actuel / Pour en finir avec les certificats de travail
Ce document n’existe à peu près qu’en Suisse. Il est devenu inutile et ne crée que des malentendus. Il suffirait pourtant de changer quelques mots dans la loi pour revenir à des pratiques beaucoup plus saines.
C’est assez rare, mais il existe des salariés à plusieurs décennies de vie active derrière eux, une demi-douzaine d’employeurs au moins, et pas un seul certificat de travail vantant leurs petits exploits et grandes qualités. Ils ne s’en sont tout simplement jamais préoccupés. La loi donne droit au certificat de travail qualitatif pour celles et ceux qui le demandent, mais elle ne contraint nullement les entreprises et administrations non sollicitées.
Que pensent-elles alors, en tant que recruteuses cette fois, des dossiers de candidature sans le moindre certificat (forcément suspect de complaisance)? A vrai dire pas grand-chose. Quelle importance en effet si les candidats mentionnent des références? Une bonne discussion téléphonique ne vaut-elle pas toutes ces tartines alambiquées, souvent discutées âprement lors des démissions ou licenciements? Les salariés ne feraient-ils pas mieux de se contenter d’attestations portant sur les éléments les plus factuels du rapport de travail, dates, fonctions, promotions, formations continues?
A entendre les professionnels des ressources humaines à l’échelle internationale, la Suisse est à peu près seule en Europe – au monde peut-être – à connaître cette pratique des certificats de travail qualitatifs. Avec l’Allemagne il est vrai, qui va encore plus loin, recourant à des systèmes sophistiqués de notation. Les entreprises et leurs collaborateurs se contentent partout ailleurs d’attestations administratives de quelques lignes. Pour l’évaluation, ce sont vraiment les références qui comptent. Tout le monde ou presque le sait, mais tout se passe comme si personne n’osait s’engager à Berne sur le terrain politiquement miné d’une modification de l’article 330a du Code des obligations (dont l’esprit remonte au début du XXe siècle). Pour en finir une fois pour toutes avec ce qui est devenu une vraie bouffonnerie.
La bureaucratie est l’ennemi des entreprises et de l’emploi? Alors pourquoi ne pas commencer par celle-là? Parce que la gauche indignée viendrait rappeler que le certificat appréciatif est un droit, qu’il en va de la protection des travailleuses et travailleurs? Mais en quoi cette prose testimoniale à biais multiples les protège encore? «Ainsi que sur la qualité du travail et la conduite.» Aucun passage du Code des obligations ne génère autant de pesanteur par caractère que ces quelques mots ajoutés à l’article 330a donnant d’abord droit à une simple attestation factuelle. Tout part de là. La jurisprudence, les commentaires, les conseils, les clés plus ou moins fantaisistes ou paranoïaques de décodage, l’ensemble de la littérature juridique, administrative, linguistique issue de ce minuscule appendice a fini par remplir de vaines bibliothèques.
Authentique sans être dépréciatif?
Premier point, les certificats doivent être bienveillants. Ils ne peuvent rien contenir qui puisse nuire au futur ancien collaborateur. Ni termes péjoratifs, ni formulations inutilement dépréciatives. A charge pour le rédacteur de trouver l’expression utilement dépréciative sans être péjorative. Attention: elle ne pourra pas non plus être allusive ou ambiguë. Inutile de préciser que le document ne doit pas mentionner les raisons et circonstances de départ. Sauf si l’intéressé demande par exemple que l’on mentionne qu’il s’agit d’une inoffensive réduction d’effectif à caractère sobrement économique. Comme si les destinataires allaient penser que l’on s’était séparé des meilleurs parce qu’ils étaient aussi les moins chers.
Les certificats qualifiés doivent néanmoins respecter les principes de réalité, de vérité, de bonne foi. Leurs auteurs courent sinon le risque d’être poursuivis par de futurs employeurs assez naïfs pour s’y être fiés (genre de complication qui n’arrive paraît-il pas qu’aux autres). Les entreprises prudentes associeront donc ostensiblement le partant à la tâche, de manière à se couvrir quelque peu. N’a-t-il pas d’ailleurs un droit d’intervention? Il pourra même demander encore des modifications dix ans plus tard (début de la période de prescription). C’est dire si un bon certificat est un certificat bien négocié et bien accepté par l’intéressé.
Le document peut même jouer un rôle dans d’autres négociations. S’agissant des certificats intermédiaires en particulier, que l’on peut exiger à n’importe quel moment sans avoir démissionné. Ni en avoir l’intention. Il n’est même pas nécessaire de préciser l’usage que l’on veut en faire. L’employeur du moment est censé deviner qu’un propriétaire a par exemple demandé le document au candidat locataire pour s’assurer qu’il s’agissait aussi d’un bon collaborateur dans la vie professionnelle… Jusqu’au jour, quelques semaines plus tard, où l’intéressé démissionne vraiment pour un autre emploi. A moins que son discret plan de sortie n’ait pas fonctionné, ou qu’il s’agissait juste de mettre un peu de pression avant de demander une promotion ou une augmentation de salaire.
Triste hypocrisie réciproque
Non seulement les certificats de travail qualifiés produisent des montagnes d’absurdité et de malentendus. Ils sont aussi devenus à peu près inutiles. Plus personne ou presque ne les lit. Surtout attentivement. Tout juste les parcourt-on pour repérer d’éventuelles anomalies. Ou s’amuser de grossières maladresses. Avec d’inévitables effets pervers: les certificats trop appuyés dans l’éloge, et ils le sont souvent, inspirent aussitôt la méfiance. Un texte plus neutre suscite par opposition la curiosité. A moins que ce ne soit le contraire. Qui va avoir envie d’entrer plus avant dans ce jeu embrouillé au possible? Quel dirigeant d’entreprise ou directeur des ressources humaines voudra faire le détecteur de mensonges en se livrant à une explication de texte avec le candidat?
La finalisation de certificats de travail inutiles représente en plus un stress considérable pour bien des salariés. En général les plus fragiles. Le problème de fond, c’est évidemment qu’ils redoutent que ne pas en avoir demandé soit interprété par la suite comme le signe d’une expérience professionnelle non réussie. Et s’ils le demandent, le produit final agira une fois sur deux comme une frustration, la personne concernée ayant rarement l’impression que son travail a été pleinement reconnu. Les employés sont-ils d’ailleurs les mieux placés dans le choix des thèmes et des termes? Pour les suggérer, tenter de les imposer? Ne vont-ils pas se ridiculiser aux yeux de leur interlocuteur dans un triste numéro d’hypocrisie réciproque? Comment réagira ensuite celui-ci lorsqu’il sera contacté par un éventuel futur employeur qui voudra se faire une idée moins convenue? Autant de doutes en général sans fondement, mais qui incitent à commettre des erreurs. Autant de regrets programmés.
L’amendement de l’article 330a CO, abrogation salutaire de l’obligation de certifier l’incertifiable, n’équivaudrait évidemment pas à une interdiction. Comme partout ailleurs dans le monde, les entreprises auraient toujours la possibilité de faire des certificats qualifiés, spontanément ou sur demande. Elles auraient surtout la possibilité de refuser. Ce qui reviendrait en quelque sorte à revaloriser en Suisse une pratique universelle et vieille comme l’écriture: la lettre non contrainte de recommandation. Souvent adressée nommément, liée à une référence, demandée et réalisée a posteriori, avec le recul nécessaire dans le cadre d’une procédure de recrutement déjà avancée. Les lettres de recommandation ne seront jamais des garanties, mais elles n’ont en général pas le degré d’incrédibilité atteint en Suisse par les certificats de travail.




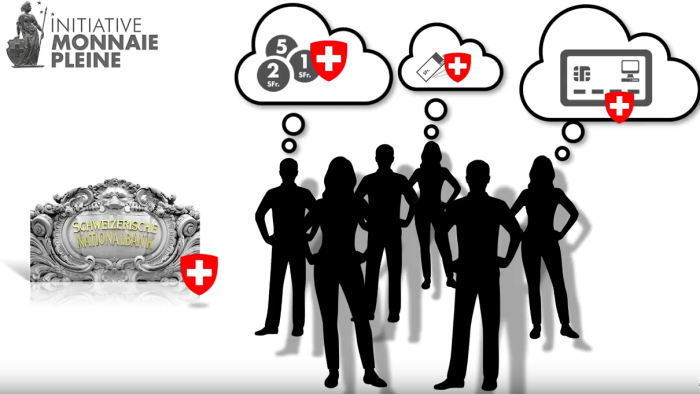


VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire