Actuel / Au pays de Viktor
Dans moins de deux mois, le premier ministre hongrois Viktor Orbán briguera un cinquième mandat, le quatrième consécutif. Bien décidée à le faire tomber cette fois, l’opposition s’est unie autour d’un candidat unique, Péter Márki-Zay. Diabolisé à l’Ouest et à Bruxelles, adoré dans la grande plaine, Orbán fait couler beaucoup d’encre. A l’image de cet ouvrage collectif indispensable pour s’y retrouver, dirigé par Corentin Léotard du «Courrier d’Europe centrale».
C’est ainsi que naissent les légendes. D’abord dans un dortoir d’université, autour de quelques copains dont les noms figurent encore dans les organigrammes du pouvoir hongrois (János Ader, László Kövér, József Szájer jusqu’à récemment...), Viktor Orbán fonde le Fidesz (acronyme d’Alliance des jeunes démocrates), qui sonne comme «foi» en latin et qui se dresse en opposant au régime communiste. En 1989, sur la place des Héros à Budapest, moustachu et chevelu, il prononce un discours brillant, réclamant le retrait des troupes du pacte de Varsovie. Un leader est né, une image de la pop culture hongroise aussi.
Trente-trois ans plus tard, il est «le dictateur», le pourfendeur du «lobby LGBT», le grand ennemi de la «nomenklatura» européenne, le chasseur de migrants, un modèle pour toutes les droites radicales du continent. Mais qu’est-ce que cela fait, aux Hongrois, de vivre dans la Hongrie de Viktor Orbán? C’est la question que nous, paisibles ouest-européens, nous posons rarement, et à laquelle répondent les auteurs de La Hongrie sous Orbán, une dizaine de journalistes basés à Budapest, pour la plupart magyarophones, cela aide.
«UE = URSS»
La série de reportages s’ouvre sur une manifestation quasi archétypale. Nous sommes en 2012, l’Union européenne veut conditionner le versement de fonds au respect de l’Etat de droit en Hongrie. «Viktor nous t’aimons», «UE = URSS» scandent les manifestants à la lueur de bougies. Dans le cortège, on s’insurge contre l’idée, parfois répandue à l’ouest de l’Europe, que les élections sont truquées. La réalité est plus complexe que les schémas avec lesquels nous avons l’habitude de jouer ici.
Ce livre est une galerie de portraits et de choses vues, de constats objectifs et d’opinions, lesquelles sous nos yeux de lecteurs paraissent parfois fantaisistes. Et cette impression de flou, d’ambivalence, est exactement ce qu’il faut retenir de la Hongrie de Viktor Orbán: ambivalente.
Prompt à s’attirer les foudres de la communauté européenne, ici en rechignant, et le mot est faible, à participer à l’effort d’accueil des migrants durant la crise de 2015, là en apposant son veto aux sanctions contre tel ou tel autocrate, le premier ministre hongrois ne prendra pourtant jamais le risque d’un «Huxit». La raison? Elle est donnée par le maire de Kübekháza, dans l’extrême sud du pays, qui explique que la petite ville ne doit son salut, son marché, sa crèche, ses panneaux solaires, qu’à l’argent européen. Par le maire de Borsodbóta, dernière localité communiste et ancien bastion minier et métallurgique, qui tient le même discours. C’est ce qui revient le plus souvent dans les provinces: sans l’argent européen, nous serions perdus.
Entrée dans l’UE en 2004, demeurée hors de la zone euro, la Hongrie, qui fut le deuxième pays le plus affecté par la crise bancaire de 2008-2009 après la Grèce, continue de vouloir l’Europe, mais une Europe économique, une Union de nations souveraines.
«Un Etat qui travaille»
On le constate à chaque élection, le pays est coupé en deux, entre capitale et province, entre villes et campagne, et il suffit de le traverser en train ou par la route pour constater les écarts immenses, palpables aux paysages, entre Budapest qui vote à gauche et les marges, frontalières de la Serbie ou de la Roumanie, qui votent Fidesz. Le clientélisme se pratique au grand jour.
94% des villages les plus pauvres ont voté en majorité Fidesz aux dernières élections, municipales, européennes ou législatives. Grâce à un levier très critiqué par les urbains mais salvateur pour les principaux intéressés: le közmunka, ou emplois subventionnés. Viktor Orbán se vante de tendre à remplacer l’Etat providence par un Etat du travail, aussi la durée des allocations chômage a-t-elle été réduite à trois mois. Au-delà, il est proposé aux sans-emplois, pour la moitié du salaire minimum, soit 150 euros, de balayer les rues, de creuser des canalisations, de défricher des terres arables, d’entretenir les massifs de fleurs. Et les concernés l’admettent: ce n’est pas grand-chose, mais c’est bien mieux que rien.
La manne étatique est aussi une bouée de sauvetage pour de nombreuses initiatives locales. En témoigne Magyardombegyház, surnommée le «village du fromage», une commune rurale étranglée par une dette de 80'000 euros, qui a choisi de se retrousser les manches pour rembourser et de se mettre au pied levé à fabriquer du fromage et des yaourts à partir de ce qu'elle avait sous la main: des chèvres et des vaches. Aujourd'hui, la fabrique attire touristes et commandes, et se félicite du soutien financier du ministère de l'Intérieur.
Souveraineté angoissée
En revanche, il est un sentiment qui domine aussi bien les pro que les anti Viktor: l’angoisse. Peur du migrant (là-dessus, même János Gulyás, le maire communiste rencontré par Joël Le Pavous, reconnaît approuver la politique migratoire du premier ministre), de l’étranger, de l’invasion pour les uns; crainte diffuse, parfois mal assumée, de voir disparaître la langue (unique) et la culture du pays, qui, avec un peu moins de 10 millions d’habitants, est en déclin démographique.
Peur, aussi, de perdre les acquis sociaux et économiques, en particulier les allocations accordées aux familles, cheval de bataille du parti au pouvoir. C’est un fait, tant les agriculteurs de la grande plaine que les employés budapestois du tertiaire disent vivre mieux sous Orbán, quels que soient leur désir ou leur capacité de démêler causes et conséquences, subventions de l’Etat ou de l’UE.
La gauche est maudite par l’expérience passée, celle de l’ancien premier ministre (2004-2009) Ferenc Gyurcsány, emporté par le scandale d'un enregistrement clandestin dans lequel il avouait avoir menti aux Hongrois sur la réalité de la crise financière qui frappait le pays. Puisque l’on vit «plutôt mieux» sous Orbán, beaucoup craignent de tenter autre chose.
Est aussi prégnante la peur de voir la Hongrie perdre sa souveraineté. Ce n’est pas qu’un fantasme d’une droite nationaliste enfermée dans une paranoïa obsidionale. Cela tient à l’Histoire. Il faut se rendre à l’évidence, nous n’avons pas la même histoire. Si celle de la Seconde guerre mondiale en Hongrie ressemble tristement à la collaboration française, la suite est bien différente: en fait de Libération et de Trente glorieuses, la Hongrie a eu droit à quatre décennies d’occupation soviétique. Cela laisse des traces que Français, Belges, Néerlandais ou ex-Allemands de l’Ouest pourraient s’efforcer de comprendre.
Orbán joue donc à l’extrême la corde de l’angoisse de la disparition. Qui passe par l’invention de mythologies identitaires, comme celle du touranisme, qui voudrait faire des Hongrois des descendants d’Attila et des Huns, un récit pratique pour rapprocher diplomatiquement la Hongrie de la Turquie et de l’Asie centrale. Qui passe aussi par une révision de l’histoire, dans laquelle la Hongrie est la victime innocente du nazisme et n’aurait pas pris part aux persécutions et à l’extermination de la communauté juive. Qui passe par l’entretien de querelles et de provocations au sujet du traité de Trianon (1920). Qui passe enfin par une sélection soigneuse du patrimoine culturel, comme le démontre le chapitre sur la photographie hongroise, à la glorieuse et mondiale postérité, un peu tiédie à l’intérieur des frontières.
«Moi j’emmerde le Fidesz»
Il y aurait pourtant de quoi, vu d'ici, souhaiter la défaite électorale du premier ministre. La loi dite «anti propagande LGBT» votée l'an dernier assimile de fait homosexualité et pédophilie, puisqu’il s’agit de «protéger les enfants» contre des représentations sortant du schéma de la famille traditionnelle (un homme et une femme, lequel schéma est inscrit dans la Constitution).
La mise au pas des médias, des universités, l’expulsion des ONG étrangères, l’aliénation de tous les contre-pouvoirs sont une réalité qui pèse lourd sur le paysage médiatique et culturel hongrois.
La frontière barbelée, renforcée de hauts parleurs, de projecteurs et de dispositifs répressifs, existe bel et bien entre la Hongrie et la Serbie; l’assimilation des migrants aux terroristes va bon train, surtout depuis que l’on a appris que des coupables des attaques du 13 novembre 2015 à Paris avaient transité par Budapest.
Le discours ambigu ou le laisser-faire devant les sentiments et les attaques (meurtrières de sinistre mémoire) anti-Roms, une minorité ethnique persécutée de longue date en Hongrie, permet à Orbán de maintenir un statu-quo et de siphonner les voix de l’extrême-droite.
La paix sociale est achetée, en somme, à coup de concentration des médias et des pouvoirs dans les mains amies du Fidesz, à coup de forints et d’euros. Dans le pays, soit on accepte en haussant les épaules, conscient que la marge de manœuvre de l’opposition, même réunie, est minime, soit, comme dans le cortège de 2012, on trouve cela normal, relevant du droit fondamental de la Hongrie à faire ce qui lui chante...
Mais que l’on ne se méprenne pas, l’opposition ferme et farouche à Viktor Orbán est présente et audible. La Hongrie sous Orbán, c’est aussi celle de Katalin Sommer, une survivante de la Shoah. Elle raconte le dégoût que lui inspire le révisionnisme historique, l’atténuation du rôle des Croix-Fléchées, le mouvement pro-nazi qui a semé la terreur et la mort dans Budapest à la fin 1944. Aussi lui est-il douloureux de voter pour la coalition d’opposition, qui compte dans ses rangs l’ancien parti d’extrême-droite raciste et xénophobe Jobbik, qui s’est recentré après une scission. Le prix à payer pour chasser «cette ordure d’Orbán».
La vraie et complexe histoire, ce sont les «enfants Gábor Sztehlo», du nom du pasteur qui les a recueillis et élevés dans «Gaudiopolis», la république des enfants, une parenthèse utopique et démocratique post-1945 que raconte Daniel Psenny. Aujourd’hui très âgés, ces orphelins de guerre fustigent l’intolérance et la brutalité du Fidesz.
En Hongrie sous Orbán vivent et travaillent certains des cinéastes les plus prometteurs et célébrés du moment, comme László Nemes (Sunset, Le Fils de Saul), Kornél Mundruczó (Pieces of a Woman) ou Dénes Nagy (Natural Light), précédés par Béla Tarr. Le milieu cinématographique et dramatique, très opposé au Fidesz pour ses velléités de contrôle des universités, reconnaît que la coalition en lice pour le scrutin de cette année est «une alliance digne d’un film de Louis de Funès», et que les subventions de l’Etat à l’industrie du cinéma ont sauvé techniciens, scénaristes et réalisateurs.
Face à la concentration des médias pro-gouvernement, prospère aussi, entre autres initiatives et alliances de journalistes d’investigation, la chaîne YouTube Partizán, un succès populaire à base de vlogs, d’interviews et débats politiques de haute tenue. L'absence de résignation et un sens aigu de l'adaptation – jamais très éloigné d'une ironie pointue – semblent être le dénominateur commun de tous les témoins rencontrés dans ce livre.
Malgré cela, le «système Orbán» demeure solide: face à une inflation explosive, il y a quelques semaines, Viktor Orbán a gelé les prix des denrées alimentaires de première nécessité. Le Fidesz devance toujours de quelques points la coalition d’opposition dans les sondages.





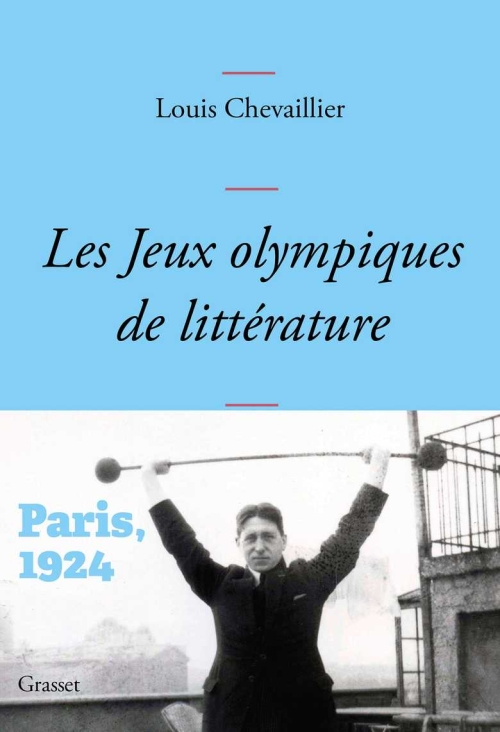



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
0 Commentaire