Science / Dépression: le mal des siècles?
La dépression, «cette souffrance de l’âme et du corps qui nous rappelle combien il est difficile de dire où s’arrête la première et où commence le second», tel est l’objet du dernier essai de l’historien des sciences et professeur d’histoire de la médecine Jonathan Sadowsky. Il en explore les spécificités et en dégage les principaux nœuds épistémologiques à travers l’histoire.
Dès l’introduction, l'auteur insiste sur l’une des clés de compréhension, et surtout d’incompréhension, de cette pathologie: la dualité et l’intrication corps/esprit. Et avance sa position sur cette problématique fondamentale, il choisit de ne pas choisir. La dépression, en l’occurence, a une dimension mentale, une dimension physique et une dimension politique, lesquelles se recouvrent, se complètent, mais ne s’annulent pas. Et, précise-t-il, c’est la nature multi factorielle et multi dimensionnelle de la dépression qui la rend si difficile à appréhender, et même, dans un premier temps, à définir. Car une maladie qui serait une souffrance en même temps de l’âme, du corps et de la société entre en collision directe avec notre acception communément admise des maladies, détectables par des symptômes, identifiables par une ou des lésions et traitées en accord avec ces présupposés.
Sadowsky évacue d’abord deux points cardinaux du raisonnement. Oui, la dépression a une dimension politique, mais cela n’est pas une caractéristique propre à cette pathologie. Toutes, en réalité, revêtent cette dimension. Et oui, surtout, la dépression est une maladie. Aucun doute n’est permis ni toléré par la science.
Cela étant posé, revenons à ce qui nous échappe, à ce qui butte et complexifie toujours davantage notre approche: l’écueil du dualisme. La distinction essentielle du corps et de l’esprit nous vient, grossièrement, de Descartes, qui a théorisé au XVIIème siècle l’idée que l’esprit était immatériel et non assimilable à la chair, c’est-à-dire au cerveau: au corps.
Sadowsky tend à élargir la focale, à inscrire la dépression dans le temps long, dans un universel géographique et culturel également. Le dualisme existe déjà dans les philosophies de l’Antiquité, notamment chez Platon et Aristote... ainsi que la dépression, conçue déjà comme un trouble de l’âme et du corps.
La médecine hippocratique et galénique identifie la dépression comme un excès de «bile noire», à l’origine de la mélancolie dans la théorie des humeurs, un excès qu’il faut purger, notamment avec des règles alimentaires et une hygiène de vie particulières. Déjà, la «thérapie» proposée allie des soins physiques et psychiques.
Au Moyen Age, la question de la morale et du péché est introduite dans la prise en charge de ce qu’on appelle plus volontiers l’acédie (du latin qui signifie «dégoût», «indifférence»). La mélancolie est alors associée à la paresse, un péché capital. Elle contrevient également au commandement chrétien d’être joyeux. Ce déséquilibre des humeurs est imputable alors à la seule responsabilité du patient. On parle de «démon», de «possession» et de «tentation», qu’il faut traiter par la pénitence et la confession, une fois encore donc, dans l’âme et le corps à la fois.
A la Renaissance, le terme de mélancolie reprend le pas. Martin Luther souligne que «les maladies de l’âme sont de vraies maladies», mais, fasciné par la folie, le réformateur trouve aussi du bon dans l’état dépressif. «Les personnes satisfaites sur le plan spirituel lui paraissaient suspectes. Pour lui, les conflits intérieurs étaient signes de vitalité mentale et de sagesse. Avoir le moral au plus bas témoignait que l’on savait combien l’état du monde et la condition humaine étaient viciés, et la tristesse était la manifestation d’un sens moral aigu.» Luther partage également avec Paracelse la conviction que la mélancolie peut être le résultat d’une possession démoniaque.
Après l’abandon définitif de la théorie des humeurs, le tableau clinique ne change pas. Freud insiste sur les notions de culpabilité et sur le rôle de la sexualité. Dans les années 1950, le statut de la dépression (considérée comme une humeur) et celui de la mélancolie (un syndrome clinique) sont inversés.
C’est seulement avec l’invention et surtout la démocratisation des médicaments anti dépresseurs, dans les années 1970 et 1980, que notre perspective sur la dépression se rétrécit considérablement. Effet d’une volonté de rationnaliser, d’éliminer la dimension d’histoire personnelle, ou anomalie d’un scientisme mal réfléchi? Toujours est-il que l’approche bio-psychiatrique ne considère plus que la dépression est du double ressort de l’âme (ou de l’esprit) et du corps. Puisque les anti dépresseurs agissent sur les processus chimiques à l’œuvre dans le cerveau – et produisent des résultats très satisfaisants sur l’humeur des patients – l’idée s’impose selon laquelle la dépression est un trouble de fonctionnement du cerveau. En 1985, les Etats-Unis autorisent la publicité pour les anti dépresseurs; deux ans plus tard, le Prozac obtient de la FDA l’autorisation de commercialisation. C’est alors un élément de langage publicitaire, plus qu’une expression à l’usage dans les milieux scientifiques, qui s’impose auprès du grand public: la dépression est un «déséquilibre chimique». Analogie est faite avec le diabète notamment. Et la logique est simple: en corrigeant ce déséquilibre par les médicaments, la dépression est traitée. Plus besoin de faire appel à nos traumatismes d’enfance, à notre histoire familiale, à nos angoisses et à nos colères, tout se joue à l’échelle moléculaire, dans la chimie organique.
Pourtant, l’enthousiasme que suscitent les différents types de médicaments anti dépresseurs se heurte rapidement à des limites de diverses natures.
Plus la science veut nommer, normaliser, quantifier, plus on s’éloigne de l’individu. Cela dans un double mouvement tout de même: la psychiatrie aussi connait des tâtonnements, le psychiatre ajuste, adapte les molécules et les dosages au patient, sans règle véritablement définie. La réponse thérapeutique et chimique n’est donc pas aussi rigoureuse que dans le cas du diabète.
Sur le plan théorique, cette position dominante pose aussi un problème. D’abord, le savoir médical se détourne de la considération des cas individuels pris dans leur singularité pour porter toute son attention sur les données chiffrées. Or, aussi loin que remontent les savoirs sur la dépression, la notion d’individualité n’en est jamais absente. L’hégémonie du modèle bio-psychiatrique relève du réductionnisme scientifique. «Le réductionnisme – qui consiste par exemple à rechercher la cause unique d’une maladie – est un des plus puissants instruments de la science. Cet instrument a permis des progrès considérables dans le cas des maladies infectieuses, une fois la théorie des germes validée. Mais la doctrine de la cause unique est un outil particulièrement tranchant qui opère aussi, parfois, des coupes trop nettes. Cet outil ne permet pas de rendre compte des origines sociales des maladies – or toutes les maladies en ont, y compris les maladies infectieuses.»
A la lumière des plus récentes avancées, y compris dans le domaine des thérapies psychologiques, on ne le répétera jamais assez, et Jonathan Sadowsky lui-même sacrifie à ce martèlement: «les modèles biologiques et psychologiques ne sont pas incompatibles, ils sont complémentaires». Les médicaments fonctionnent, les thérapies psychologiques fonctionnent. L’un ou l’autre, ou l’association des deux fonctionnent.
La dépression fait l’objet d’un double réductionnisme alors que sa double dimension, physique et psychologique, est factuelle et attestée. Pourquoi est-ce si difficile de nous en convaincre une fois pour toutes, questionne l’auteur?
La réponse semble en partie énoncée lorsque Sadowsky propose, à plusieurs reprises dans son essai, une démonstration selon laquelle les anti dépresseurs – et le modèle bio-psychiatrique qui les accompagne – sont à la fois scories et carburant du système capitaliste.
«L’industrie du bonheur», comme l’ont dénoncée des critiques du tout-psychiatrique dans les années 1980, en est le corollaire: le Prozac est un produit de consommation qui a été vendu comme un autre, répondant à un besoin plus ou moins préexistant. La tentation est grande, en effet, et même si l’on ne se sent pas particulièrement de souffrance psychologique, d’essayer d’être «mieux que bien» en avalant ces pilules magiques...
Dans un autre sens, on peut comprendre «l’épidémie» de dépressions de notre époque post-moderne comme la résultante du broyage des individualités par la machine capitaliste. Même si la notion d’épidémie de dépression est à fortement nuancer, et statistiquement peu valable. «Ce que le néolibéralisme, la postmodernité et la dépression clinique ont en commun, c’est l’absence d’espoir», explique l’auteur, ou la conviction que les choses ne peuvent pas, pour des raisons systémiques, s’améliorer.
Du côté des thérapies, il note que les exigences financières des assurances-maladie, quand elles existent, ou les contraintes budgétaires des ménages le cas échéant, poussent inexorablement à l’adoption d’un paradigme qui réduit à la plus faible part possible la complexité et la multi factorialité de la dépression. Dans ce cas, le temps coûte, les tâtonnements coûtent, il est donc tentant de se tourner vers un modèle thérapeutique simple: symptôme-traitement-guérison, c’est exactement ce que propose l’approche bio-psychiatrique.
En incise, l’auteur remarque que ce modèle est typiquement occidental. Considérant le dualisme cartésien comme un artefact culturel, et la domination des anti dépresseurs comme l’une de ses conséquences, il relève que cette manière d'envisager les choses a dû faire l’objet de véritables opérations d’exportation et de greffe dans d’autres sphères culturelles. La dépression n’est pas une maladie occidentale, l’étude des cas de détresse psychologique chez les esclaves aux Etats-Unis a notamment démenti les affirmations racistes selon lesquelles seuls les blancs étaient capables de ressentir de la mélancolie. En revanche, si la dépression est universellement répandue et ressentie, la notion de «déséquilibre chimique» n’est pas évidente partout. En Lettonie, par exemple, il a fallu se débarrasser de l’influence soviétique jusque dans la médecine: «la médecine soviétique avait (...) adopté une approche holistique qui intégrait les affects, le vécu corporel et les comportements». Depuis l’indépendance du pays, cette approche a été gommée, et si les médecins psychiatres et neurologues tiennent compte des conditions de vie de leurs patients, ces éléments sont simplement contextuels et il n’est pas question d’agir dessus. «Les colloques organisés par les grands groupes de l’industrie pharmaceutique ne se contentent pas de faire la promotion des médicaments: ils contribuent à acclimater les catégories diagnostiques – comme celle de la dépression – qui justifient leur prescription».
Le Prozac a également été introduit en Iran, et son essor coïncide avec une importance souffrance dans la population due à la guerre Iran-Irak dans les années 80. «Avant la révolution iranienne de 1979, les Iraniens évoquaient la souffrance psychique en termes poétiques et spirituels. Un certain degré de mélancolie était associé au fait d’avoir du caractère et de s’être affirmé sur le plan spirituel». Le traitement par les médicaments s’est imposé dans le pays, mais leur efficacité n’a pas permis de glissement complet du paradigme jusqu’à faire considérer la dépression comme «simplement chimique». Dans la culture iranienne se maintient l’idée que la dépression a d’abord des causes sociales – voire géopolitiques.
Examinant aussi le cas du Japon ou les témoignages d’immigrés aux Etats-Unis, l’auteur parle de «mondialisation des anti dépresseurs», dont la consommation est aujourd’hui aussi répandue que celle du Coca-Cola dans le monde.
Dans ce contexte, définir et mesurer la dépression de manière précise devient de plus en plus important et les solutions sont peu convaincantes. Un ressort important de l’argumentation de Sadowsky est la continuité sémiologique entre l’acédie médiévale et la dépression du XXIème siècle: nous parlons bel et bien de la même chose. Mais comment circonscrire cette «chose»? Et finalement, où se trouve, dans ce cas, la limite entre le normal et le pathologique? Qu’est-ce qu’une tristesse «normale» devant l’état du monde ou face à une contrariété personnelle, et à quel moment parle-t-on de tristesse «anormale», «excessive»? Dans quelle mesure une souffrance est-elle «tolérable» ou «invalidante»? La médecine ne saurait répondre à ces questions, et c’est là, malheureusement, l’angle mort de cet essai.
Peut-être aurait-il fallu le secours de Canguilhem (Le Normal et le Pathologique, 1943), dont la thèse est: «en matière de normes biologiques, c’est toujours à l’individu qu’il faut se référer», contre la systématisation des grilles diagnostiques. Réintroduire, donc, une dose d’individualité dans les processus de normalisation.
Certes, l’état actuel de la recherche et de la psychiatrie permet de s’appuyer sur des perspectives encourageantes – car plus nuancées. Mais force est d’admettre que depuis l’Antiquité, le tableau n’a pas fondamentalement changé. La dépression, aux multiples et déroutantes facettes qui ne se plient vraiment à aucun paradigme, reste un embarras pour la science, un fardeau pour les malades et la manifestation de l’irréductibilité coriace de l’esprit humain.





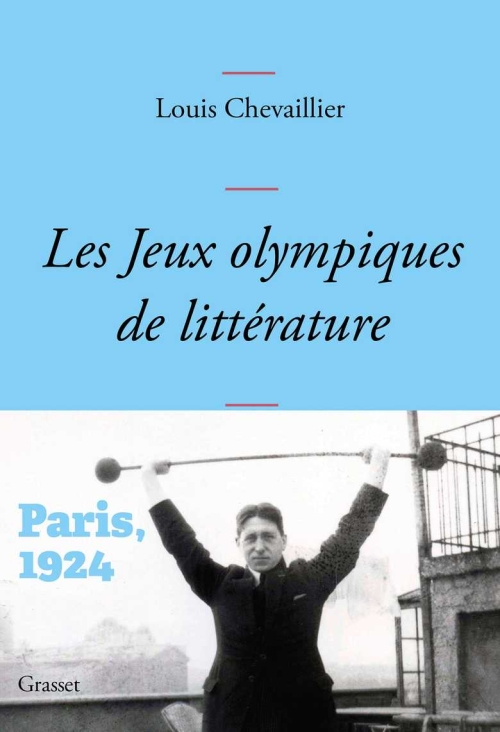



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
1 Commentaire
@stef 24.10.2022 | 17h38
«Article passionnant, merci !»