Culture / À quoi bon fréquenter les musées?
Que vient-on chercher dans une exposition, dans un musée, puisque «tout est sur internet» et le prix du billet d’entrée souvent prohibitif? On paie, de plus en plus souvent, une part de prestige social à étaler dans un dîner, à un rendez-vous amoureux; on fait la queue pendant des heures pour pouvoir instagrammer aussitôt, se montrer, se faire savoir, faire savoir que l’on sait où sont les choses qui en valent la peine. Cette généralisation abusive trouve des racines dans le vécu le plus proche. Je ne me suis pas rendue à l’exposition Basquiat-Schiele à la Fondation Louis Vuitton – parce que je connaissais les Schiele, vus à Vienne – en revanche, mes fils d’actualité sur les réseaux sociaux étaient saturés des mois durant de ces images.
À Londres, je me suis laissée prendre au jeu: l’idée est moins banale lorsqu’il s’agit d’un événement à l’étranger, plus excitante aussi pour mon Facebook et pour moi. Je voulais voir de mes yeux ce que les British feraient du French artist Pierre Bonnard.
Au tourisme de masse décrié ici et là par les Vénitiens et les habitants du quartier de Montmartre répond une certaine idée de la culture: pour tous, à la portée de tous, quasiment vendue en package avec le billet d’avion ou d’Eurostar. Il y avait foule à la Tate Modern ce samedi, malgré le vent glacial et la pluie qui faisaient tanguer le Millenium Bridge. Munie d’une entrée «presse», j’ai coupé la file tandis que d’autres visiteurs se faisaient littéralement refouler par une surveillante promue videur de boîte de nuit. Les treize salles d’exposition sont bondées. Il faut parfois faire la queue pour apercevoir les œuvres, dont la collection, empruntée au Musée d’Orsay, de tirages photographiques d’époque: des nus champêtres, charmants, mais minuscules.
Les Anglais ont vu les choses en grand: une centaine d’œuvres, dont beaucoup d’emprunts à des collections privées, un éclairage impeccable, un affichage net, en osmose avec les toiles. Il faut faire un effort, au milieu de cette foule cosmopolite et hétéroclite, pour se souvenir que Bonnard est un peintre de l’intime. Suffocant dans un manteau d’hiver trempé de pluie, je cède à cette terrible interrogation: faut-il vraiment se réjouir de cette affluence? Au nom de la sacro-sainte égalité des chances et d’accès à la culture?
Oui, cent fois oui.
La culture coûte cher, certes, mais une entrée pour l’expo Bonnard vaut 18 livres, un billet pour le London Eye et Madame Tussauds, le double. Nous sommes nombreux, certes, mais nous sommes nombreux à avoir choisi.
 Le Café, (1915) Pierre Bonnard © DR
Le Café, (1915) Pierre Bonnard © DR
Bonnard visité rétrospectivement apparaît torturé de l’intérieur par ses thèmes de prédilection: la lumière, la couleur, le temps, la photographie. Un peintre de nus et de baignoires, noté-je dans mon calepin en sortant. Non, il n’a pas plus mal vieilli que Picasso, Matisse et consorts. Il a des audaces de cadrages (gros plan sur les visages dans Le Café, 1915) et de dé-cadrage: la Tate Modern, conformément à la volonté du peintre, a retiré le cadre de cinq toiles: on ne voit plus qu’elles.
Bonnard n’est absolument pas le «peintre du Cannet»; il se déplace beaucoup en France, en Normandie, à Paris. Il n’est pas non plus hors du temps. Sans être un reporter de l’histoire, il l’intègre dans son système. En témoignent Un village en ruines près de Ham, 1917, et Quatorze juillet, 1918, peintures de la Grande Guerre.
L’artiste et sa muse et maîtresse, Marthe de Méligny, travaillent en collaboration avec l’outil photographique, pas en vue de copier l’instantané mais pour le traduire dans le langage qui leur est propre.
 Homme et Femme (1900), Pierre Bonnard © DR
Homme et Femme (1900), Pierre Bonnard © DR
Le temps s’arrête bel et bien devant beaucoup de ses compositions. Le Nu au bain (1936) pour la délicatesse du peintre peignant son modèle souffrant; Homme et Femme (1900), superbe affirmation rebelle de leur vie de bohème; La Toilette (1914) qui n’est pas sans rappeler le Nu provençal de Willy Ronis, et Nu à la fenêtre (c. 1922), intimité à mille lieues de l’obscène, irréelle et noble banalité du quotidien rêvé.
Pas parce que ses toiles sont «jolies», pas parce que ses portraits ou paysages sont «réussis», pour autre chose qui tient de l’alliance miraculeuse entre un peintre, un commissaire d’exposition et un public attentif, le miracle fonctionne.




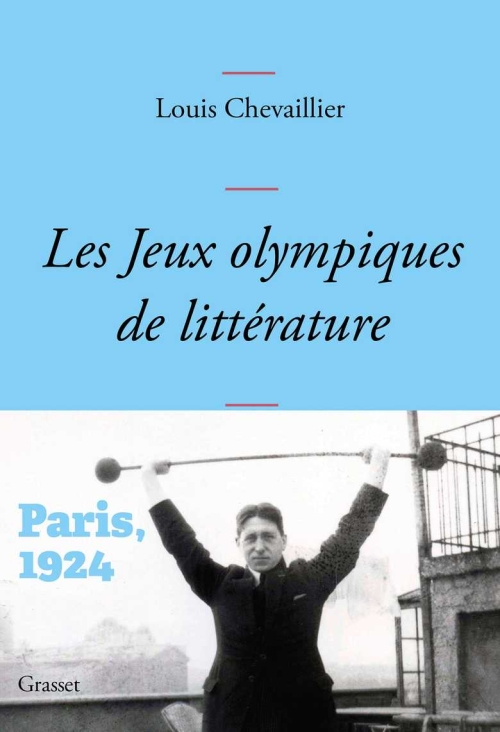



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
1 Commentaire
@virginia 15.04.2019 | 10h09
«Bel article, merci.»