Culture / A l'ombre de Staline
1933. Le journaliste Gareth Jones découvre la face cachée de l'URSS: le Holodomor, ou grande famine, en Ukraine. Le nouveau film d'Agnieszka Holland revient sur cet épisode, avec pour toile de fond la célébration du travail de reporter, son impartialité et son goût de la vérité.
«Un spectre hante l’Europe: le spectre du communisme». Ainsi commence le Manifeste du Parti Communiste de Karl Marx, texte qui a façonné l’histoire européenne du XXème siècle, tant le continent a cultivé et cultive son attraction et sa répulsion pour cette idée; et la formule, aujourd’hui, est encore chargée de sens. Un spectre hante, de la même manière, le nouveau film, co-produit par le Royaume-Uni, la Pologne et l'Ukraine, de la réalisatrice polonaise Agnieszka Holland, L’ombre de Staline — comme son titre français l’indique.
Intitulé Mr Jones à l’origine, le film se veut, en premier lieu, un biopic. Il raconte l’histoire de Gareth Jones, jeune journaliste gallois. Fort de son premier scoop — avoir été le premier, en 1933, à obtenir une interview du nouveau chancelier allemand Adolf Hitler — il porte toute son attention sur ce que l’opinion appelle alors «le miracle soviétique». Le monde, après la crise de 1929, est en pleine récession, mais l’URSS affiche une croissance économique insolente. Les correspondants étrangers présents sur place, à Moscou, décrivent un pays en plein décollage, où règne un enthousiasme populaire pour le nouveau système politique et économique.
Mais pour Jones, interprété par James Norton, quelque chose cloche. «Les chiffres ne collent pas» répète-t-il. D’où vient l’argent? D’où Moscou tient-elle sa prospérité?
Muni de son visa, Gareth Jones, parfaitement russophone, arrive dans la capitale et découvre un milieu de journalistes confinés, privés d’accès au reste du pays, surveillés, espionnés, suivis. Son principal indicateur est étrangement tué au cours d’un cambriolage. Les portes se ferment devant lui.
Quand il parvient à gagner l’Ukraine, il découvre que le «miracle» se fait au prix de millions de vies humaines.

© Condor distribution
Le Holodomor («extermination par la faim») est le nom donné à la grande famine ukrainienne qui a coûté la vie, en 1932 et 1933, à cinq millions de personnes, selon les estimations créditées de nos jours par les historiens. Pour accélérer la collectivisation des terres et la mise au pas des courants nationalistes «contre-révolutionnaires» ainsi que des paysans enrichis (les koulaks), Staline a organisé une pénurie alimentaire en Ukraine, «le grenier de la Russie». Toute la production est réquisitionnée et envoyée à Moscou ou écoulée à l’étranger pour remplir les caisses. Il ne reste rien aux habitants. Ceux qui ne meurent pas de faim sont terrassés par le typhus ou punis de mort pour «vol de la propriété socialiste», voire pour cannibalisme.
Le 31 mars 1933, dès son retour d’URSS, Gareth Jones signe dans le London Evening Standard un article à charge, «La Russie sous le joug de la famine», où il livre les résultats de son enquête.
S'ensuit une violente campagne de dénégation, de la part de ses confrères en poste à Moscou, notamment le chef du bureau du New York Times et prix Pulitzer Walter Duranty (Peter Sasgaard). Gareth Jones est assassiné lors d’un reportage en Mongolie deux ans plus tard, très probablement par le NKVD.
L’interprétation sobre et engagée de James Norton fait de L’ombre de Staline un film incarné, charnel. Jones jette une pelure d’orange dans un crachoir et aussitôt des silhouettes décharnées et en haillons se précipitent pour la ramasser, sans se défaire pour autant de leur dignité. Il traverse des paysages désolés, des villages déserts, rencontre des orphelins contraints au pire pour se nourrir, écoute leurs comptines et leurs chansons. Il court dans des plaines enneigées pour échapper à la police, a faim, froid, halète, dévore des écorces d'arbre gelées, chute, se relève, et le spectateur avec lui. Il se mêle aux habitants, interroge, photographie. Partout, les corps épuisés ont des regards profonds, résignés.
L’expérience ukrainienne, qui donne l’impression d’être tournée en noir et blanc, tant il n’y a d’autre horizon que la mort et le silence, contraste avec les soirées moscovites. Chez Walter Duranty, l’alcool, la drogue et la débauche occupent journalistes et diplomates désœuvrés, prisonniers des cages dorées de leurs bureaux somptueux et du non moins somptueux Hotel Metropol.

Scène de rue prise à Kharkov (Ukraine) en 1932 par l'ingénieur autrichien Alexander Wienerberger, seul à avoir apporté des preuves photographiques de l'Holodomor. © A. Wienerberger
Ce parti pris esthétique de la réalisatrice sert son message même s’il est moins manichéen qu’il n’y parait. Le film a plusieurs niveaux de lecture. Documentaire linéaire sur la découverte de Gareth Jones et l’URSS du début des années 1930, réquisitoire contre les crimes de Staline, il s’agit aussi d’une histoire du journalisme et d’une célébration du métier, autant que du travail des lanceurs d’alerte, contre «la lâcheté des gouvernements et l’indifférence des gens».
On n’y trouve pourtant pas d'un côté les «bons», de l'autre les «mauvais». Une idée est souvent répétée: l’homme doit s’effacer devant ce qui le dépasse, et légitimer tout ce qui en émane, chaque camp, chaque entité poursuivant son propre agenda. Gareth Jones, épaulé par le personnage fictif de la journaliste Ada Brooks (Vanessa Kirby), se veut du côté de la vérité. Pour les soviétiques, la famine est un «dommage collatéral» de la révolution prolétarienne, qui doit être menée coûte que coûte, en dépit des résistances. Walter Duranty, lui, travaille pour son gouvernement. Son travail de propagande, sa dénégation de l'existence d'une famine quelconque, est récompensé par la reconnaissance officielle de l’URSS par les Etats-Unis, une manne commerciale considérable.
Il n’y a ni troisième voie, ni bonne solution. La poursuite de la vérité ne change pas le monde si d’autres intérêts sont en jeu: après les révélations de Gareth Jones, personne n’est intervenu pour faire stopper l’hécatombe. Personne ne gagne, il n’y a pas de «happy end».
Peut-être faut-il considérer que la position adoptée par George Orwell dans La Ferme des animaux (roman allégorique critique de la révolution russe et du stalinisme, publié en 1945 et qui aurait été inspiré par l’expérience de Gareth Jones), est la «moins pire». Le héros du roman s'appelle, d'ailleurs, Mr Jones... L’auteur et La Ferme des animaux apparaissent en fil rouge dans le film. Dès l’incipit, Orwell invite à «lire entre les lignes», un procédé d'écriture auquel ne se résout pas Jones, quoiqu’il en coûte.
D’autres références émaillent le film: les scènes tournées dans le train en compagnie des paysans ukrainiens sont un hommage à Sergei Eisenstein, les inserts très rapides de photos en noir et blanc célèbrent le constructivisme russe et son plus prestigieux représentant, Alexandre Rodtchenko.
Attaquer Staline mais célébrer le génie russe, telle est la position d’Agnieszka Holland. La réalisatrice, née en 1948 à Varsovie, arrêtée et emprisonnée en République Tchèque alors qu’elle participait au Printemps de Prague, en 1968, moment où elle aurait choisi d’être «une artiste plutôt qu’une agitatrice» signe ici un acte politique qui dépasse son cadre historique: réaffirmer la valeur des faits contre la manipulation de l’information.
Jusqu’à l’ouverture des archives soviétiques, en 1989, l'Holodomor était officiellement nié par l’URSS et les partis communistes à travers le monde. Depuis 2006, l’Ukraine, suivie par une dizaine de pays, principalement de l'ancien Bloc de l’Est, considère cet épisode comme un génocide. En 2008, le Parlement européen a adopté par résolution le qualificatif de crime contre l’humanité.
Prévu pour sortir le 18 mars dernier en France, retardé pour cause de pandémie, L’ombre de Staline arrive sur les écrans au moment où le monde s’écharpe autour du déboulonnage des statues célébrant les aspects les moins reluisants de notre passé. Agnieszka Holland participe, comme avant elle les dénonciateurs du Holodomor et des crimes soviétiques, à déboulonner l’utopie communiste dans ce qu’elle a produit de plus totalitaire.
Au même moment, à Gelsenkirchen, dans l’ouest de l’Allemagne, un parti d’extrême-gauche vient d’installer une statue haute de deux mètres de Lénine. De très jeunes comme de moins jeunes militants considérent que ce dernier «était un penseur en avance sur son temps d’une importance historique mondiale». Toujours, un spectre hante l’Europe.




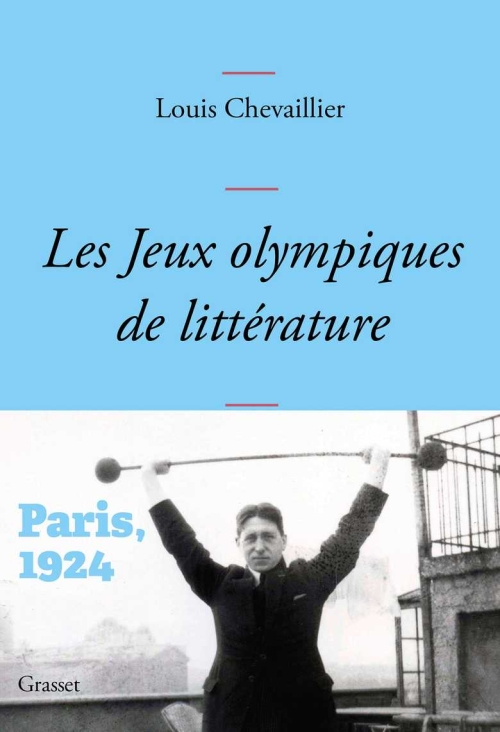



VOS RÉACTIONS SUR LE SUJET
2 Commentaires
@stef 26.07.2020 | 18h19
«Ne pas confondre Staline et Lénine.
Staline était un malade mental assoiffé de pouvoir, dont le communisme n'était qu'un prétexte pour l'asservissement !
Alors que Lénine voyait le communisme comme un idéal humain. Mais est-il applicable ? C'est LA question !»
@Aka 21.09.2020 | 11h27
«Stef, Lénine, qui voyait le communisme comme un idéal humain selon vous, voulait SA révolution. Applicable au prix de l'élimination de ses détracteurs ! Pas très angélique, le monsieur...»